#les barbelés de la pensée
Explore tagged Tumblr posts
Text
Parc national d’Ugam-Chatkal (UZ) – 26.12.23
Je regarde défiler les plaines de boue et de neige par la vitre du taxi. Plus loin, il y a le chrome éblouissant de grosses usines avec leurs hautes cheminées et leurs volutes blanches dans le ciel blanc. Encore plus loin se dessinent les montagnes que je prends pour les contreforts de l’Himalaya - c’est en vérité le début de la chaîne du Tian Shan qui finit en Chine.
On me dépose devant les grilles d’une imposante structure bien neuve et propre, avec des plates-bandes à peine germées. C’est le poste de la police des touristes. Je veux m’assurer d’une chose avant mon escapade dans le parc national d’Ugam-Chatka : y a-t-il des ours ? Je ne sais pas pourquoi c’est le seul doute que m’inspire mon organisation bancale. L’agent qui vient à ma rencontre avec une énergique poignée de main et un large sourire ne comprend pas bien non plus. Il a, quant à lui, beaucoup d’autres préoccupations à mon égard. Un touriste qui s’est mis en tête d’aller crapahuter seul dans les montagnes en plein hiver, ce n’est pas de son goût. Il me confirme cependant que je n’ai rien à craindre du côté des grizzlys. Malgré ses injonctions et sa proposition d’aller plutôt faire du ski dans une des stations à proximité, je m’obstine, comme à mon habitude.
Je monte à droite d’un barrage hydraulique en suivant une route en lacet jusqu’à une crête d'où l'on peut admirer un panorama à couper le souffle : un lac aux eaux turquoise enserré de falaises. Le soleil tombe rapidement derrière moi. Arrivé en haut, je ne trouve nulle vue grandiose de paysages éblouissants, mais un haut mur de ciment coiffé de barbelés. Dépité, je continue le chemin sur le bas-côté jonché de déchets, en longeant cette horreur.
Après une bonne heure de marche, une trouée se présente. Je peux enfin admirer l'eau bleue les falaises et le reste, baignés dans la lumière rasante du coucher de soleil. J’avise à l’extrémité du lac des plages de sable qui pourraient être parfaites pour bivouaquer. Je les atteins quand la nuit est tombée. Malheureusement, ici aussi des barrières et des barbelés m’en interdisent l’accès. Cette partie du pourtour est accaparée par une rangée de spas luxueux qui dressent leurs frontières avec des clôtures et des gardiens et des chiens, pour s’assurer que les plages restent bien désertes, même si les établissements sont fermés pour la saison. J’entre plus loin dans un village. On m’observe passer sans rien dire. Là encore, l’accès au lac est privatisé. Des panneaux avec les prix à l’heure et à la journée décorent les grilles. Je ne me sens pas en forme. J’ai le cafard en repensant aux paroles de l’agent qui m’avait prévenu que le lac était fermé. Comment peut-on fermer un lac, avais-je pensé alors ? Les regards que je sens sur moi depuis les fenêtres en bernes me poussent à m’enfoncer plus loin vers les hauteurs, dans les champs labourés, pour y planter ma tente.
Je dors mal cette nuit-là. Je suis en train de couler dans une masse d’eau sombre. Je vois au travers de la surface des gens passer. Des amis, ma famille ; je les vois aller et venir sans me remarquer, sans réaliser que je m’enfonce toujours plus profondément dans l’eau noire et glacée.
Je me réveille avec dans la tête une voix trop lointaine pour que je discerne ce qu’elle dit. Puis j’émerge complètement et me rends compte que cette voix ne fait pas partie de mon rêve et qu’elle n’est pas distante, qu’elle est même très proche, à moins d’un mètre de mon abri. Pris de panique, je m’habille en hâte et passe la tête dehors. À ce moment, je comprends d’où me venait cette sensation de froid dans mon rêve. Les températures ont drastiquement chuté pendant la nuit. Il a neigé. Le champ est recouvert d’un épais manteau blanc, et une carapace de glace enserre la toile de ma tente. Juste derrière le fil électrique se trouve un homme. Il ne parle plus, il se contente de lever les sourcils en me dévisageant. J'esquisse un bonjour de la main, plus universel que les mots. Il se remet à parler sans que je puisse comprendre quoi que ce soit. Je m’excuse en anglais et en russe. Il se tait à nouveau, fait un geste du bras qui peut tout aussi bien dire « viens, suis-moi », que « va au diable », et repart.
Je m’empresse de lever le camp. J’ai du mal à rempaqueter tellement mes doigts sont engourdis. Plus loin sur le chemin je tombe sur un conteneur aménagé en cabane avec des fenêtres et une porte taillées dans la tôle. Je tente ma chance et toque. Pas de réponse. Du ciel gris commencent à tomber de gros flocons. Je reste encore un peu sans trop savoir quoi faire. L’eau s’infiltre dans mes vêtements, troués depuis l’épisode du feu de bois dans la réserve de Ponichala en Géorgie. Mes chaussures ne sont pas mieux, fatiguées de ces trois mois de périple, les coutures s’effilochent. Le blizzard s’intensifie, je ne vois plus les montagnes autour, ni les champs enneigés. Il n’y a plus que moi, le froid et cette maisonnette… vide.
Le retour se fait à tâtons dans un néant blanc hypnotique et silencieux. Je ne reverrais pas le lac, ni même les grilles des spas et leurs gardes, cachés par le rideau cotonneux qui tombe, toujours plus dense. Vers midi, l’agent de la police des touristes m’appelle (on avait convenu qu’il prendrait de mes nouvelles tous les jours de mon trek pour s’assurer que je vais bien). Il est soulagé d’apprendre que je serais de retour aussi vite, et me dit en rigolant qu’il a reçu quelques appels au sujet d’un grand type avec un gros sac à dos qui errait dans la région.
De retour au pied du barrage, je prends un téléphérique pour visiter les hauteurs. Un truc à faire absolument d’après l’agent. Le temps s’est dégagé. En haut, je trouve une petite esplanade déserte avec des jeux pour enfant et des stands fermés. Je trouve l’endroit lugubre et n’y reste pas longtemps. Dans la cabine me ramenant en bas, je contemple la courbe bétonnée du barrage, le quadrillage de la ville, la rangée de dents blanches des montagnes. Je me sens vide. La solitude et les désillusions s'installent, à l'aise, dans mon spleen. Pour la première fois depuis que je suis parti avec Francine dans les rues désertes de Nantes, le silence me dérange. Je vois le sol venir à moi, lentement, et je sens sur mes joues rouler mes larmes.
3 notes
·
View notes
Text
Hmm, je pense que les posts qui ont disparu étaient trop lourds ... (Somehow)
Du coup, je vais éviter de rajouter une vidéo dans celui là ! Le post de las cajas était celui du 24/08 (si je ne dis pas de bêtises), et celui ci concerne Vilcabamba, le 25.
Touille va donc vous raconter, très simplement, comment transformer une petite rando en bataille contre les esprits de la nature. (Mais non, pas le gentil petit papillon posé sur ma tête, lui il était mignon)

Pour cela, plusieurs étapes. D'abord, décider d'aller escalader le mont Mandango : à l'Office de tourisme, on m'explique que j'en ai pour 3 petites heures pour faire l'aller retour, nickel !

Ensuite, commencer par se transformer en flaque de sueur sous le soleil écrasant qui est réfléchi par la poussière du chemin, et grimper jusqu'au sommet.Vive la crème solaire !

Ensuite, une fois arrivé en haut, profiter du paysage ! Jusque là, tout va bien.

Penser a prendre des bâtons de marche, check. Mettre la crème pour ne pzs se transformer en homard, check. Lire un peu au sommet en se sentant reine du monde, check... C'est ensuite que ça se gâte !

En effet, il suffit d'une indication de maps.me pour m'entraîner sur le terrain de la guerre ... L'application m'indique que je peux faire une jolie boucle plutôt que de retourner sur mes pas. C'est parfait non? Ha. (Ceci est un Ha de dépit profond, avec une touche de désespoir et d'autodérision)

Ça commence pourtant bien, avec une route le long des crêtes très étroite qui n'est certes pas très rassurante, mais qui est splendide ! Touille enclenche le mode "concentration", et c'est parti, je profite de la vue et de la tranquillité, les autres touristes étant restés sur le premier sommet.

... moui, sauf que vous vous en doutez, ça finit moins bien ! Le chemin de redescente dans la vallée n'existe en fait presque pas, la première centaine de mètres est là juste pour m'appater, puis il disparaît dans un champ aux herbes immenses... Et ça ne fait qu'empirer !

Voilà, je vous laisse donc suivre ce mode d'emploi très simple si vous souhaitez finir votre journée par 2h30 de bataille au milieu des herbes folles, puis de la forêt, des branches/ronces/aubépines diverses, barbelés, vaches, lits de rivière à sec et petits ravins attenants. Ah, avec des petites blagues des locaux, comme par exemple une route qui termine sur une FALAISE, ou un grillage en fer forgé doublé de barbelé au milieu de nulle part pour vous bloquer le passage.
J'ai plus de peau des jambes (épilation gratuite \o/), et la prochaine fois je vérifierai sur un autre site avant de suivre les propositions de cette appli hein ><
Note : vous ne m'en voudrez pas, je n'ai pas pensé à prendre la forêt des enfers en photo, j'étais trop occupée à grogner et à m'insulter pour y penser🥰
3 notes
·
View notes
Text
Mon corps décharné
Mon corps, décharné. Mon corps, blême et fiévreux. Sinon rose, comme une pivoine. Ce corps porte les stigmates du temps morcelé entre un abîme et un autre. Combien d’aller-retours entre ici et ailleurs ? À briser sa coque sur les récifs. Lagons bleus, trainée d’écume et derrière les arbres des cascades vertigineuses. Combien a-t-il supporté ? Mais je ne me plains pas car je suis mon pire ennemi. Mon âme en sait quelque chose. Mon esprit et ma pensée sont liés, imbriqués plutôt, ils avancent en rythme dans un désert d’horreurs et de merveilles. Je suis mon pire ennemi et souvent je ne me reconnais pas. Sur la corde je tiens mon équilibre vital. D’un abîme à l’autre, d’une falaise à une autre. Le vent, la pluie, le désordre total. Des gens qui errent. Ils errent remplis d’effroi, tenant leur âme sous le bras. Ils cherchent le bureau de la rémission des péchés. Laver son âme comme on se lave les mains, regardant la crasse être engloutie par le siphon. S’il était si simple de se purifier l’horreur serait peut-être plus démente encore. C’est un fil barbelé qui relie la famine et la paresse. C’est un fil barbelé qui relie la vanité aux limbes. C’est un fil barbelé qui fait le pont entre le néant et le tout. Et c’est les mains couvertes de sang que l’on s’abreuve en connaissance, en expérience. Chaque médaille a son revers. Tout doit revenir à sa place. Les morts iront tous avec les morts et la joie sera toujours encouragée par la joie. Au jugement dernier, tout nous sera révélé.
J’ai pris la route ce matin. Possédé. Il était tôt et on voyait les lumières des maisons s’éclairer une à une. Juste sous le brouillard qui coiffe le vallon. Ma tête semblait claire mais que dire de tous ces assauts, de toutes ces questions. Chemin faisant je goûtais au plaisir de l’abandon, au soulagement de l’acceptation. Je n’aurai jamais les réponses. Non pas qu’on me les refuse mais on ne trouve pas quelque chose qui n’existe pas. On peut en rêver, croire le toucher, se l’approprier mais jamais le posséder ou le vivre. Et alors... il y a la vie, laissons les rêves à leur place. Il y a ces visages, tous semblables, avec un sourire faux qui paraît avoir été tracé au cutter. Au cutter dans la chair de ces parvenus. De ces escrocs de la joie. Militant du bonheur à emporter. Sur ma route, en rang. Les mêmes yeux vides. Extase du vice. C’est sans issue. Plié depuis dix millénaires ou plus.
J’avance. Le jour a dévoré la pureté de l’aube. J’acquiesce. Demain sera une nouvelle aube. C’est le mythe de Sisyphe. Une beauté diaphane aux couleurs de coquillages qui se débat et perd à tous les coups. J’avance. Avec mon corps décharné, blême et fiévreux. La noyade. J’y pense comme ceux qui meurent en mer. La noyade. La dernière fois qu’on a pris la mer… La houle, le noir, le fracas et puis plus rien que de l’eau. Du menton à la gorge. Elle s’infiltre. Se répand et noie. Je préférerais voir surgir des cieux les quatre Cavaliers de l’Apocalypse. Mais il n’y a que de l’eau. Du sel et de l’eau. Pour les braves qui ont voulu toucher un horizon sans espoir, sans mirage, sans rien d’autre qu’une ligne inatteignable. Tendue comme la dernière chance. Seule au bout du regard effaré l’espoir entre les dents. L’horizon, cruel artifice, vers qui tous les regards se tournent. Horizon implacable aux allures de couperet. Je me suis arrêté dans un petit village de pêcheurs, la chaleur étouffante gronde. Il est l’heure de la sieste et j’erre dans le port. Du sang macule le sol de la jetée de pierre, la vente du matin est terminé. Des mouettes s’arrachent les derniers déchets pendant que le sang sèche. Demain ce sera la même ritournelle, pêcheurs et acheteurs, sous le ciel cru, blanc tant il est chaud. Du haut des remparts je vois l’horizon, je le voyais aussi depuis je jetée. Ici, il semble y avoir une dissonance. Une divergence, un détachement. Comme une rupture soudaine. Dissonance entre cet horizon qui porte toujours le même visage et mes pas errants sur les remparts chauds. Dissonance entre mes espoirs vains et la réalité brûlante. Mes bras sont pleins d’une candeur invincible. D’une cotonneuse soif. Et je laisse ma main glisser le long des remparts, je caresse le temps.
Temps qui s’effiloche comme un collant filé. Néons noirs, yeux de velours. Sidération. Derrière c’est un abîme qui se creuse, les souvenirs en fosse commune. Les peut-être et autres hésitations disparaissent comme une trainée de poudre. Le temps laboure. Le temps moissonne et régurgite. Je ferme les yeux, menton levé vers l’immensité bleue. A qui appartiennent toutes ces secondes ? Menton levé, je n’ai que faire de vos balbutiements. Ce sera toujours la rage. La rage au ventre. Une rage qui transpire, conquérante, une soif carnassière envers les merveilles de l’instant. Se dresse alors devant moi la tour aux huit faces. Sur chaque face, une tête d’ange à six yeux. Et sous chaque ange sommeille une vertu. Je l’observe, elle est immense… Elle tourne sur elle-même dans un silence de cathédrale. Elle est là, à mes pieds, monolithique et fastueuse. En son sommet trône, sur un piédestal, la clef de la vie. Inutile. Je ne veux pas savoir. C’est la seule nourriture de l’essence que d’ignorer son lendemain tout en se forgeant avec.
J’ai tracé avec mon doigt, un cœur, entre tes omoplates, de la plus appliquée des façons. Tu as senti sur ta peau les vertiges de la douceur et les appels saccadés de la concupiscence. Concupiscence rougeoyante qui brûle les yeux. J’ai tracé une ligne qui va de ta hanche à ton épaule. J’y ai semé de l’or miettes. J’ai également tracé une ligne allant du bout de ton index jusque ton oreille. Oreille tapie dans tes cheveux défaits. Je t’ai recouverte de lignes imaginaires, de lignes du toucher, fugaces et hurlantes. Maintenant le jour peut mourir. Encore quelques minutes. Et je glisse mon corps meurtri sous le drap de fleurs, j’attends la caresse de ton éternité. Les yeux fermés, l’incertitude au ventre. Et tes lèvres me baisent, doucement et chaudes, dans le cou. Frisson et profonde respiration pour ce corps qui porte les stigmates du temps morcelé entre un abîme et un autre. La nuit fredonne un air… je le connais mais n’arrive plus à m’en souvenir… cette trompette, seule d’abord… puis les percussions. Accords mineurs. Et tout l’orchestre, grave… Je sais, Do dièse mineur. Mahler cinq. Trauermarsch… Je m’endors. Demain un autre voyage. Lancer de nouveaux ponts par-dessus l’impossible sous les yeux médusés de l’éternel. Avec mon corps de navigateur, mon corps hésitant. Mais plus rien ne m’effraie, les échecs m’ont appris l’inexorable va-et-vient des désirs et des cœurs en fleurs. Comme une marée ils labourent la grève. Rien ne m’effraie plus car j’ai appris à souffrir. Et j’ai aussi appris à rire pour de vrai. Comme lorsqu’on est mort de soif et qu’enfin une fontaine se présente. Je laisse à chacun ses traumatismes. Moi je dors dessus. Et tendre est la nuit pour ceux qui n’attendent plus rien. Plus rien car tout est là, à nos pieds.
2 notes
·
View notes
Text
À la veille de ses dix huit ans, Seth se préparait comme à son habitude à recevoir sa sœur adoptive. Il s’habilla d’une petite blouse au style goth mais rose qui rappelait le monde douceureux de l’enfance, nouée par un noeud lavaliere en satin noir. Le pantalon flare qui allait parfaitement avec avait été cousu main et finissait par de jolis petits détails roses et noir. Le rose et le noir était la couleur qui lui sciait le mieux. Ça rehaussait sa joliesse enfantine et sa beauté sombre, romantique, contrastée. Il lui fit cadeau d’une bague, c’était stupide du genre de celles qu’on trouve dans ces boules surprises dans les années y2k, genre une bague en plastique bien kitsch. C’était un cœur, et il était brisé et Seth avait gardée l’autre moitié, il était encerclé d’un léger fil barbelée. C’était la première fois que Seth opérait un rapprochement franc envers sa sœur et même si c’était symbolique, il se demanda si il était capable d’aller plus loin.
Lo avait du mal à se dire que ce cadeau était insignifiant, la plus jeune de 3 ans sa cadette, à Seize ans donc, se demandait si elle n’avait pas commencer à éprouver un trouble envers son frère.
Seth : « Ne pensez vous pas, ma sœur, que l’on peut avoir des sentiments amoureux l’un envers l’autre?
c’est dégoûtant. »
Il rit jaune. Cela le surprenait pas tant que ça, lui même y avait penser, que c’était des cochonneries et que ça ferait naître un capharnaüm. Mais ce n’était pas dans ses plans. Aussi, ressentait il plus qu’une simple relation fraternelle, de plus la fille étant fondamentalement née homme, il se dit que c’était loin d être une personne fermée d’esprit, il fut donc partagé par la réponse.
« Nous ne sommes que frère et sœur de manière officielle. Il n’y a pas de lien du sang.
Je… ne ressens rien de telle.
N’importe qui pourrait voir qu’il y’a plus entre nous qu’un simple lien familial.
Je ne veux pas. À quoi tu joues ?
À rien. »
La jeune fille devait bien l’admettre, elle crevait d’envie d’embrasser Seth. C’était arrivé avec la puberté et la prise d’hormone féminine n’arrangeait pas l’affaire. Elle qui avait cru que ça ferait baisser sa libido, elle ne s’attendait pas à ça. Elle avait beaucoup attendue, mais depuis qu’elle avait 11 ans en fait, et qu’elle avait été adoptée, elle pensait à ses lèvres anémiées et à son regard obscur et hagard.
Voyant la jeune fille pensive, Seth plongea dans sa chevelure, puis il la plaqua contre le bureau, l’embrassant. La jeune fille, surprise par cette intromission entre ses levres, protesta d’abord.
« Je répète : à quoi tu joues ? »
Seth ne sut que répondre si ce n’est avec un rire mi gêne mi sarcasme. La jeune fille avait les joues cramoisies, sans réfléchir, elle porta à son visage consterné la bague rouge en plastique qu’il venait de lui offrir, inconsciemment se rappelant l’innocence de leur relation d’il y a à peine une minute. Seth trouva ce geste adorable, et compatis à son trouble bien qu’il était décider à ne plus jouer à ces gamineries et à cette relation platonique mal vécue.
« Je pensais qu’officialiser notre amour par cette bague que vous portez en ce moment, vous permettrez d’admettre vos sentiments pour moi.
tu te trompes, je ne suis pas ce genre de fille. En plus c’est… je sais pas c’est.
Mal ?»
Voulant vérifier ses dires, et n’ayant jamais été aussi proches l’un de l’autre, Seth et Lo se regardaient longuement, perdus dans le regard l’un de l’autre, la jeune fille contre le mur semblait s être assombrie, et ses sourcils fronçés venaient mentir à ses joues rouges et ses yeux brûlants de désir. Pour tester, Seth vint coller sa main à sa cuisse quelle avait pour la première fois découverte en ce mois d’été, pas tout à fait une jupe mais un short quand même qui était noir et sobre.
« Tu sens l’opium
ce n’est qu’une cigarette.
C’est ça. »
Seth tira sur la dite cigarette et fit goûter à lo qui toussa d’abord puis y prit plaisir, cela soignera peut être ses pensées troublées, ses questionnements et surtout sa depression saisonnière. Prise de vertige, la petite fille aux yeux de poupée sentit sa bave parfumée au thé d’eau de rose se mélanger à celle de café de son vis à vis. Puis Seth la mena dans leur lit plutôt luxueux pour plonger ses doigts dans le dos de la maigre fille. Les os étaient comme des invitations et la peau de la main de Seth était plus douce qu’elle ne l’aurait cru. La jeune fille était très excitée, et en sentant cette main dans son dos elle eu un frisson, elle décida de finalement répondre au jeu dangereux qui frôlait l’inceste, sans se poser de question, en embrassant son geôlier. Seth n’en fut pas mécontent bien que pas habitué alors il se frotta un peu à elle, elle repondit par un soupir d’aise et quelques gémissements. Puis le baiser s’arrêta simplement par manque de souffle. Seth regarda l’état de la plus jeune. Elle transpirait et son trouble se lisait à son visage. Il s’arrêta quelques instants pour sentir son cœur, ça tambourinait dans sa poitrine et l’on pouvait lire la rage et le désarroi dans ce battement inhabituel.
« continues. Tu avais l’air de t’amuser.
je ne pense pas que vous y survivrez.
Tu te trompes. Je suis résistante, au moins autant que toi. »
Seth ne voulu pas démentir sa sœur avec qui il avait une relation paradoxale d’anorexie successive depuis l’enfance, et décida de simplement lui accorder ce plaisir. Leur salives chaudes se mêlèrent lune à l’autre et la soie de leur vêtements crissèrent tandis que la main dans celle de la plus jeune, il allait la casser en deux.
Pour se calmer, Lo’ pensait à rien, en fait elle y prenait même du plaisir, ayant eu très peu de succès depuis sa transition, malgré une beauté à couper le souffle, d’ailleurs rares étaient ceux qui ne tomber pas amoureux d’elle, populaire jeune fille, bien que peu encline à se fondre dans la masse, étant plutôt d’un genre d’aristocratie à être ni tout à fait à la marge, ni tout à fait dans le cadre. Seth partageait cette éducation tout simplement parce que d’une certaine manière ils étaient formés à la même enseigne.
« on est marriés maintenant
tais toi… »
Elle ferma les yeux et il s’empressa de faire des va et viens à sa toute petite verge. Celle ci était si mignonne, si peu en adéquation avec le reste de sa beauté féminine et pourtant Seth l’intégrait parce que c’était sa sœur. Ils passèrent une nuit torride, alors qu’il éteignait la bougie qui sentait le métal. Et la cigarette par la même occasion.
Le lendemain, Lo se réveilla avec un trou de mémoire, comme si quelque chose manquait. Mais elle avait de vagues souvenirs malgré tout, elle pensait sans cesse à Seth ces temps ci. Si elle, poursuivait les études, lui ne faisait rien d’autre que se consacrer à l’art et la procrastination, elle voulait le suivre dans cette voix mais c’était clairement pas le moment pour lui faire une déclaration, elle était en pleine transition là. Le mal de crâne lui fit se demander si elle n’avait pas goûter une fois de plus le goût sucré de l opium de son frère, de plus le temps s était comme ralentis, avec l’impression de gravir une montagne elle vérifia la preuve d’amour. Elle hoqueta de surprise, la bague d’enfant était bien là.
que penser ? Elle ne savait pas. Mais elle avait sans doute aimer cela… un peu trop d’ailleurs.
0 notes
Text
174/200 Stalag IIB
Parce que tu t’écroules soudain dans mes bras, et que je te rejoins dans ta chute, et qu’une litière de paille nous enfouit quelques minutes, au revers d’une porte, et qu’alors j’oublie la guerre, la peur de mourir, leurs barbelés, l’odeur de moisi, les canons des mitrailleuses, le claquement des bottes, le métal des uniformes. Parce que tes yeux bleus, parce que ton drôle d’accent. Parce que tu me regardes et que tu joues avec moi. Parce que tu es légère et que je reconnais ton pas sur la neige.
Et aussi : j’ai peur.
J’ai peur toute la journée. Je sent la peur la nuit, le matin, l’après-midi et le soir, quand je m’habille, quand je marche, et quand je mange, et quand j’attends le courrier de Vendée. J’ai presque toujours peur. Ma peur fait une grande flaque de graisse tiède et collante et je vis dedans : elle imprègne mes vêtements, mes cheveux, mes regards, ma respiration, mes pensées. Je m’attends à ce qu’ils viennent me chercher. A ce qu’ils m’accusent de quelque chose.
Je n’ai plus peur quand tu me regardes. Ton regard est clair, certain, ferme, ouvert comme le ciel certains jours de juin sur la grande plage des Sables d’Olonne que je reverrai peut-être un jour. Alors j’ai de l’espoir. Je me dis que tout cela va s’arrêter. Que je retournerai chez moi. Qu’ils vont nous renvoyer saufs. Que le Stalag IIB va s’ouvrir. La guerre va finir. Tu viens à moi, je viens à toi. Nos bouches se reconnaissent, tout chavire, je suis vivant. Nos corps cherchent à s’approcher le plus possible. Tous les moyens sont bons. Tu as 20 ans, tu es si belle. Je veux me presser contre toi, tu souffles à mon oreille, tu dis mon prénom, tu le dis mal, tu le dis avec ton accent, j’adore quand tu dis mon prénom, je vis. Je suis ici, avec toi.
Les Kappos du Stalag ont été clairs : on vous envoie dans les fermes, il y a des pommes de terre à ramasser. Toi le paysan, suis nous. Mais si vous touchez aux filles, « tacatacatac », Verstanden ? Ils montrent leurs Sturmgewehr 44. J’ai peur. La grande flaque de la peur.
Sauf qu’il y a de la vie partout. C’est ainsi. Des fois, une plante vivace pousse dans le bitume. La vie se fraie toujours un chemin vers la vie. Et dans cette ferme de Poméranie, à la frontière de la Pologne, loin, très loin vers l’Est, à des jours de marche de mon bocage, il y a tes yeux, et tes bras, et notre jeunesse, et nos peurs à tous les deux, nos vides, et nos soifs qui se reconnaissent aussitôt et s’attirent l’une l’autre.
Tu viens me donner un coup de main.
Tu as tricoté des gants de grosse laine pour nous. Tu es venue seule derrière la grange à betteraves. Tu m’a montré les gants en souriant. Tu as pris mes mains et tu m’as enfilé mes gants. Je t’ai laissée faire. J’ai senti ton odeur, j’ai regardé ta tête penchée sur mes mains. Tu étais appliquée. J’ai senti ce contact de tes doigts sur ma peau. Tu as les main chaudes. Tu a pris ton temps. Je t’entendais respirer fort.
Tu as relevé la tête vers moi.
Mes mains gantées de laine dans tes petites mains chaudes. Ton regard franc. La beauté de ta bouche, délicate comme praire. Tu es allemande, je suis français, nous sommes en 1941, tu t’avilis en embrassant un soldat ennemi, je risque ma vie en te regardant, et nous allons l’un à l’autre avec toute l’avidité, toute l’évidence, tout le soulagement de laisser jaillir en nous la force de vivre.
A partir de maintenant tu es la vie. Tu es l’espoir de chaque jour. A partir de maintenant, je tremble qu’on vienne me traîner devant un peloton d’exécution pour t’avoir aimé. Quand ils frappent à la porte le matin pour nous amener aux champs, quand ils font l’appel pour distribuer le courrier ou les colis de la croix rouge. A partir de maintenant, j’aime l’ordonnancement des outils dans cette ferme d’Allemagne. Je trouve beau ce grand ciel de l’Est qui semble se perdre au loin sur des champs de neige. Tu me montres comment vous coupez les betteraves fourragères, comment elles fermentent tout simplement ainsi, dans une espèce de cave aménagée pour cela, et comme les vaches s’en régalent. Tu me montres comment ton corps se love au mien, comme nous nous devinons sur des lits de paille avec un sac en toile de jute posé dessus.
J’apprends à dire ton prénom, tu apprends à dire le mien. Avec nos accents étranges qui nous font rire. Ta cousine fait le guet quand ils sont partis. A partir de maintenant, parfois, je n’ai pas peur. Et à partir de maintenant, il y a en moi une alerte permanente. Ne pas être pris. Quelque chose se cache en moi. Mon espoir. Mon désir. Toi. La femme interdite. Mon secret, celui qui me tient en vie et celui qui me condamnerait. Vie et mort, désir et peur s’affrontent dans le plus grand secret de mon cœur.
- Florent Barbeau ? Kommen.
Tout le monde me regarde dans le baraquement. Ils sont inquiets. Je me lève, je suis vide. Je pense à toi. Le kappo me montre mes affaires, et mon sac. Il me demande de faire mon paquetage.
- Schnell
J’ai mon cœur dans la gorge. Je respire avec peine. Je ne veux pas montrer ma peur. Je ne veux rien leur montrer. Je met mes affaire dans le sac de paquetage qu’ils m’ont donné. Un porte feuilles, deux lettres de ma ma mère. Les gars me tapent sur l’épaule. Me serrent la main.
Dehors il y a un camion bâché, et d’autres prisonniers déjà sur la remorque. On me tend un bras. Je me hisse en prenant appui sur le marche pied. Je reconnais deux visages. Il y a des sourires. On chuchote.
- On s’en va Barbeau. T’as de la chance. On rentre.
- Quoi ?
- Ils ont besoin de bras pour les récoltes en France. Les paysans comme nous on rentre à la ferme.
Le camion démarre. Le camion démarre et le baraquement s’en va. La ferme s’en va. La grise Allemagne s’en va. La gare. Les wagons. Les kilomètres qui défilent. Des collines, des forêts inconnues, des uniformes, des villes encore, des citernes, des entrepôts en briques, parfois des tanks, des sacs de sable, des mitrailleuses, 1942, trois ans de captivité qui s’en vont. Tes mains s’en vont. Ta bouche s’en va, ton odeur, tes cheveux, ton attente. Tout, s’en va.
Je ne t’ai pas dit Adieu. Une chose plus grande que la tristesse vient de se recroqueviller quelque-part dans ma poitrine et mon cou, une tristesse qui ne pourra jamais être dite, à personne, une femme interdite, un amour interdit, une boche, un secret.
- T’as pas l’air content Barbeau !
Si, je suis content, je rentre chez moi, je vais retrouver le goût du beurre salé, les légumes du jardin de mon père, le vin rouge qu’on partage à la cave au cul de la barrique, mes sœurs, ma mère, un lit propre avec des draps. J’irai voir l’Océan. Et je pense à toi. Ton visage, comment est-il déjà ? Je voudrais retenir ton souvenir. La vérité s’impose : tu es passée. C’est fini. Le camp, la peur et toi. Ton sourire et les mitrailleuses. Les punaises et les poux, les gants de laine. Nos rendez-vous, le lit de paille, ton odeur, l’appel et la soupe de choux dégueulasse.
Comme tu étais belle Clara, et comme tu m’as sauvé de la folie et de la tristesse, et comme tu m’as aidé à tenir et à vivre.
Je fais le serment de te garder là. Intacte. Fraîche et lumineuse comme l’hiver de Pologne. La guerre nous a jetés l’un sur l’autre, la guerre nous sépare à jamais sans doute, et tu auras 20 ans pour toujours.
0 notes
Text
La corruption financière au plus haut 5
La corruption financière au plus haut 5
Les affaires gagneraient à être transparentes et non pas opaques ! (more…)
View On WordPress
#Alexandre Goldfarb#argent#économie#Daniel Desurvire#desinformation#finances#français#France#goldfarb#gouvernement#l&039;Expert le Spécialiste l&039;Observateur et le Témoin#l&039;observatoire#la connaissance#La corruption financière au plus haut#La corruption financière au plus haut 5#la semaine du mensonge#les barbelés de la pensée#les marionnettistes#les polititocards#les socialo-menteurs#medias#mensonge#Minute du MENSONGE#Observatoire du MENSONGE#politique#President#socialiste#télévision#tribune libre#TV
1 note
·
View note
Text
Il y a toujours ce moment pendant le shift où je peux prendre 5 minutes, m'asseoir dans le coin métallique entre les bouteilles à moitié vidés et la porte. Cet endroit m’offre une vue particulière sur le bar, je vois la quasi-totalité de la pièce, mais je ne sais pourquoi, les multiples conversations ne m’atteignent pas si frontalement. Honnêtement, je hais mon job. Je dois prendre des commandes à longueur de soirée, remplir des verres, nettoyer des verres, encaisser, recommencer. Je déteste ce moment où le client, les deux coudes sur le bar, m’attrape pour me balbutier sa commande. En fait, ce qui me dégoûte c’est le contact visuel entre eux et moi. J’ai quelque chose qui les transperce toujours. Je le vois dans leurs yeux, ils ressemblent à des enfants tristes d’un coup. Mais moi, ce que je vois c’est le vide, le vrai. Ils sont noyés dans les degrés de whiskey bon marché, ils semblent tous sans vie, sans but. Comme les zombies dans les séries Netflix, ils ont été arrachés à leurs pensées, et tout ce qu’ils expriment c’est la peur de remonter à la surface. Retrouver le chemin barbelé de leur vie monotone qu’ils cherchent à fuir par le vide. L’ambiance est sombre, immanquablement. Leurs angoisses se déposent sur les murs et dégoulinent sur le sol, c’est poisseux, c’est hideux, ça me colle à la peau.
5 notes
·
View notes
Text
Un agenda fané
L’amant : « Tu as coupé tout chemin menant à ton jardin. Comment puis-je cueillir tes roses préférées ?
Comment puis-je être près de toi et te caresser?
Comment puis-je t’embrasser? Comment puis-je t’offrir des fleurs du paradis de notre amour et les fils barbelés l’entourent ».
L’amante :« Tes épines m’envahissent et mangent mes tiges, ta froideur englobe mon arôme et ton absence expulse mes couleurs. Ton manque d’intérêt a cassé la plupart mes calices et a fait flétrir le reste.
Quant aux feuilles, elles ont été envahies par le gris et elles sont jaunies.
J’ai perdu le désir… de tout et de toi aussi. Je n’attends rien de ce que tu peux me donner ou de m’offrir ».
L’amant: « Comment puis-je t’écrire ? Et mon stylo n’est plus à l’aise dans les paumes de mes mains. Comment puis-je te décrire ? Et mes pensées ont abandonné mon esprit et mes sentiments ont voyagé loin de mon cœur.
Tu m’as amputé mes doigts, l’un après l’autre ».
Le blâme ne profitera jamais aux deux parties.
Cela augmentera l’étouffement des roses jusqu’à ce qu’elles se fanent et meurent. Il établira aussi le manque de fraîcheur du désir entre nous jusqu’à ce qu’il disparaisse entre les plis de l’oubli.
©️Sæbïr_Lâhm

32 notes
·
View notes
Photo
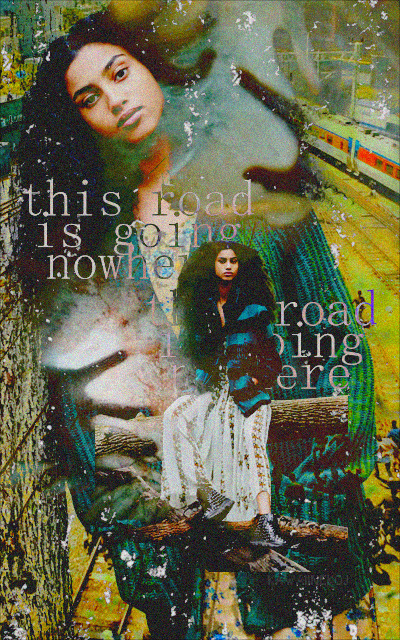
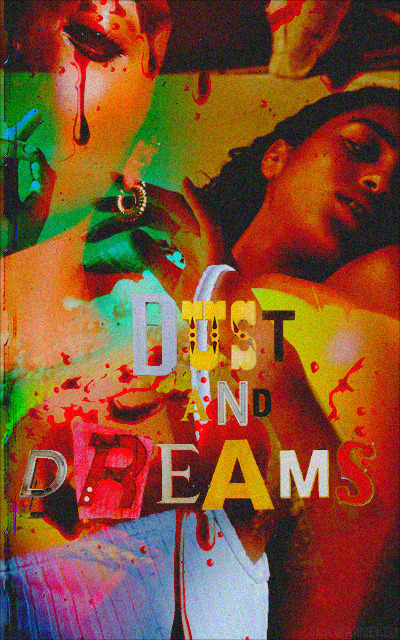

🌺 bon vu que vs me connaissez pas mal, que je radote bcp sur mes ocs préférés, ben j’ai décidé de ne feature QUE des perso kleenex, que vous avez probablement jamais connu, mais que j’aime tout autant! 🌺
6 PERSOS CHALLENGE - par @mysterious-corvidae @corvidae-challenge
(PERSO 2) ZINEB FOXX 🔪🌾🚧 ; (…) EDIT: dc j’ai oublié d’écrire mon petit ressenti sur le perso avant de poster mdrrrrrr génial. zineb j’la trimballe tristement dans mes bagages pcq je tenais tlmnt à la jouer, à exploiter son potentiel, ses traumatismes, son passé à l’écrit mais jsp, jcrois elle était trop inadaptée aux autres (ou bien cst moi qui l’était tout autant, un peu des deux j’imagine), que j’ai fini par rapidement baisser les bras à son sujet. i guess cst la vie :/
✨ zineb + she, her + encore humaine, en vie en dedans ça c’est encore à vérifier + 22 ans + américaine, franco-marocaine + sexualité pas vraiment questionnée + célibataire + fidèle à elle-même + survivante. ✨
+ charactère: introvertie, spontanée, hasardeuse, brave, décousue, tendre, maladroite, endurante, alerte.
+ keywords: texas, post-apo, communauté, que de bonnes intentions, ptsd, biche égarée, en construction, déni de grossesse / tw: white supremacy, esclavage, meurtre, viol.
+ playlist: plus qu’un chien fou qui garde la maison 💀🧱🍃
⬇des petits extraits de fiche pour celleux qui veulent dans le déroulé!⬇
( entrailles ) profil psychologique
secrète, cachottière- zineb qui n'est pas toujours franche, zineb qui n'est pas toujours indiscrète, zineb qui garde souvent les choses pour elle. par oubli, pour oublier. toi qui d'habitude crie le fond de tes pensées, voilà longtemps que tu as appris à tout planquer en dessous du tapis. tu as même fini par adopter l'idée que les bons côtés de l'existence ne se trouvent plus que dans tes rêves éveillés, là, quelque part, coincés dans un coin de ton crâne, et que tu devrais avoir honte de partager ce que tu peux bien voir ou savoir. audacieuse, hasardeuse- zineb qui n'est pas toujours prévisible, zineb qui n'est pas toujours passive, zineb qui s'écarte par moment des sentiers battus. par changement, pour changer. toi qui d'habitude suis le mouvement avec des œillères, voilà qu'il t'arrive de débloquer. tu redeviens cet étalon sans brides, poussé par l'adrénaline, agissant par instinct. les souhaits hâtifs qui deviennent des plans furieux, les banales futilités qui se transforment en réels dangers. confuse, tumultueuse- zineb qui ne parle pas beaucoup, zineb qui n'est pas limpide, zineb qui s'embarrasse seule. par nervosité, pour énerver. les pensées qui prennent racine comme de vulgaires pissenlits à la dernière averse, et qui poussent, se bousculent, s'entrechoquent, s'emmêlent, fusent ensemble, et se bouffent pour au final ne rien donner. des amas d'idées, qui s’amoncellent, tanguent, flanchent, s'écrasent dans un silence mortel. les bégaiements informes, les phrases partielles, la confiance défectueuse, les malaises par centaines. douce, tendre- zineb qui ne sait pas être un mur, zineb qui n'a jamais levé la main sur autrui, zineb qui ne peut être qu'affection. par amour, pour aimer. ton aura chaleureuse qui te rattrape à chaque fois, qu'importe les déceptions et les colères. les gens qui prennent tes résolutions et tes menaces difficilement au sérieux car incapable d'haïr et de rejeter. la vérité, c'est que ta foi t'en détourne, que ton cœur ne peut en supporter les tensions. gauche, empotée- zineb qui ne contrôle rien, zineb qui ne sait pas être à deux endroits en même temps, zineb qui laisse tout filer. par distraction, pour distraire. tu es de ceux qui se gamellent à cause de leurs propres pieds, réagissent sans réfléchir sous stress, font de leur mieux pour être le plus utile possible, et mieux se foirer au final. comme si le karma te pointait du doigt à chaque fois, et pourtant, et pourtant tu es là. abîmée certes, mais toujours entière. endurante, tenace- zineb qui ne quitte pas facilement le navire, zineb qui ne délègue pas tout aux autres, zineb qui encaisse la douleur. par espoir, pour espérer. les canines qui s'enfoncent dans la chair, les larmes furieuses qui s'écoulent le long des joues, les cris silencieux qui répondent aux précédents, étouffés plus tôt. pour certains une qualité, admirable comme excitante, pour d'autres un fléau exécrable, provocateur. si les secrets et les maux sont avec toi bien gardés, quitte à te lacérer les tripes de l'intérieur, la peur et les plaies finissent parfois par obtenir quelques aveux de tes poumons à bout de souffle. sensible, délicate- zineb qui n'est pas toujours inutile, zineb qui n'est pas toujours rigoureuse, zineb qui ressent instantanément, profondément. par survie, pour survivre. paranoïaque ou simplement sur le qui-vive, tu n'as jamais été des loups mais plutôt des chiens qui gardent la maison. un bruissement, un décalage, et tu sais que quelque chose ne va pas. souvent prise pour une rabat-joie asociale et coincée, tu te réfères pas mal à ces notes sur internet qui disaient toujours se fier à ses instincts.
( squelette ) parcours
avant.
avant tout ça y'avait maman y'avait papa. y'avait maman pour te rappeler de sortir les poubelles en gueulant ton nom, y'avait papa pour te klaxonner de la rue pour te réveiller et t'inciter à bouger ton cul, y'avait jadzia pour cogner le mur d'à côté du pied t'ordonnant de baisser le son de ta télé. avant tu pouvais rester en ligne pendant des heures, chanter à tue-tête avec ta soeur quand les parents n'étaient pas là, aller au ciné avec ton trio de potes le samedi quand t'étais d'humeur à t'habiller. avant t'habitais à new york, dans les lotissements où seuls les résidents sont appréciés, puis un été la famille vous a invités, et vous vous êtes retrouvés en plein sud, amarillo, histoire de vous faire les roues sur la célèbre 66.
avant que les médias ne s'affolent,
avant qu'on ne vous vole,
avant que vous ne vous retrouviez avec un mort au sol.
avant tout ça y'avait maman y'avait jadzia. y'avait maman pour te rappeler combien tu te devais d'être forte, y'avait jadzia pour cogner le mur d'à côté du poing t'ordonnant de garder toute ta tête pour elle. avant vous aviez tous plié bagages pour déménager dans une réserve aux traditions archaïques, de plus en plus peuplée par d'autres pairs ricains. avant tu n'avais jamais vraiment vu de marcheur de près; t'avais à peine dix-huit ans, tout ce que tu savait faire c'était puiser de l'eau pour ton peuple, occuper les mioches et les vieux, cuisiner tout ce que les hommes pouvaient récupérer de leurs expéditions.
avant que papa ne revienne pas,
avant que jadzia ne se fasse amputer le bras,
avant que la réserve ne meure sous les balles dans un fracas.
après.
après tout ça il y a eu la nuit noire, pendant longtemps. trop longtemps. les plus forts, massacrés. les plus fiers, écrasés. hommes, femmes, enfants, tous furent récoltés, attachés, rabaissés. les infirmes, rectifiés. les plus âgés, effacés. vous étiez plus nombreux qu'eux, et pourtant sans armes, sans âme. la volonté de lutter n'était plus; il fallait marcher, continuer, qu'importe les pertes, qu'importe les pleurs. pieds et poings liés, assoiffés, affamés, les chevaux ont fini par s'arrêter au pied de champs, non loin de fermes et de granges. et le cauchemar a continué. renommés, catalogués, répartis tels de vulgaires objets, vous étiez bien loin de deviner ce qui allait vous arriver.
la mère et le fils, reine régente et fils auto-couronné du nouvel ordre, qu'importe si le dit territoire se limitait à des tôles et des fils barbelés. dans ce camp de radicaux, tu n'étais plus zineb, mais dallas foxx - non seulement parce qu'il s'agissait du nom de son ancienne fiancée, retrouvée avec le colt dans la gorge, mais aussi parce qu'un esclave se doit d'adopter le nom de famille de son propriétaire, comme un simple code barre sur l'oreille d'un bovin. l'entretien de la maison, de la famille, du leader, encore et encore et encore. la nuit noire fut longue, à force de fermer les yeux, de craquer, de prier, de céder.
après les humiliations à répétition,
après une journée dans le four,
après que maman ait succombé au fouet.
après tout ça il y a eu une étincelle. les ténèbres devaient cesser. à cinq, vous aviez assez de fougue pour dire que c'en était assez. et cette nuit-là fut sûrement la plus belle de toutes, éclairée par le feu gourmand, criminel, qui, comme par magie, ne se délectait que de la maison de tes bourreaux. si les flammes s'étaient propagées aux autres habitations, si les flammes s'étaient avérées meurtrières, si les flammes avaient permis la fuite d'autrui, tu étais maintenant trop loin pour le deviner. vous aviez pourtant dit tous vous retrouver au 4x4 avec provisions et de quoi vous défendre, mais seule l'une d'entre eux se pointa, empressée d'user de votre unique billet de sortie, de peur d'y rester malgré les efforts et les coups bas.
vous étiez libres à nouveau, humaines à nouveau.
le monde pourtant n'avait pas changer. impossible de dire s'il était plus cruel et plus dangereux, mais la poisse elle vous suivait à la trace. les hauts-le-cœur matinaux, les marcheurs, les pneus défectueux, la faim grandissante.. on t'ordonne de te ménager, de ne pas prendre de risques inutiles, de te reposer autant que possible, de faire attention à ta santé, sans que tu ne veuilles réellement comprendre la situation.
encore aujourd'hui tu t'obstines à ne pas y penser. c'est impossible. tu n'en veux pas. pas de lui, pas comme ça, pas maintenant ; toi qui pensais t'être débarrasser des foxx à jamais, ton corps te hurlait que c'était loin d'être le cas.
après qu'elle ne soit pas revenue de l'hypermarché,
après tout ce qui était arrivé.
la nuit noire venait de se prolonger.
#kawaiinekoj#6persoschallenge#challenge#november challenge#imaan hammam#my ocs do not steal#my oc edits#my oc art#mb#moodboard#oc#original character#autumn#french rpg#rpg#rp#roleplay#post apocalyptic#my edits#tw blood#zombie apocalypse
15 notes
·
View notes
Text
ĒĿĒĊŤŖ⨀ĊĦ⨀Ċ
Pétard ! C’est la merde. Les yeux de Bambi, immenses comme ceux d’un hibou, lui sortent de sa tête défractée. Elle sue des grosses gouttes de peur. Son eyeliner dégouline, ça lui fait des cils impossiblement longs qui lui donnent un air de harpie ahurie. Elle est juste habillée d’une robe rose trop petite qui lui taille le haut des cuisses parce qu’elle a de grandes jambes et qu’elle fait de grands pas, et des Mary Jane à talon, seules fringues qu’elle a pu gratter avant de gicler de la clinique. Les gens qu’elle croise la matent sans comprendre. Ils s’écartent devant la Barbie zombie qui trisse en rasant les murs. Bambi en peut plus. Il lui faut une dose sinon elle crève. Son cœur cogne si fort qu’elle en a mal aux seins. Elle avait vraiment pas le choix. Quand t’es casé à Pampalon pour plus de deux semaines, tu peux être sûre d’en ressortir cramée foutue. Pétard ! Tout le monde sait ça... Au-dessus de tout, le ciel gris dégueulasse se met à pisser dans les rues. En un moment, les cheveux de Bambi se ramollissent. Ils passent du bouquet de paille en pagaille à une Iggy Pop en plus crade encore. Bambi allonge la foulée. Elle enjambe les grandes flaques maronnasses qui poussent dans les creux du bitume. Sa caboche de tox morte de trouille swing à droite à gauche pour essayer de lire les panneaux qu’elle capte à peine. Les rues c’est juste de grands couloirs d’hôpitaux pour elle. Tous les mêmes, interminables, avec des foutus néons de chaque côté. Elle reconnaît rien alors elle fait ça à l’instinct. Dans le brouillon de ses pensées, il y a les clebs de la Pampa qui lui mordent les fesses, qui lui lâchent de la bave partout et qui la cassent en deux avec leurs barres électriques. Ça la fait tenir même si elle en peut plus. Se tailler en oblique, gicler du centre, atteindre la ZI. Pétard elle y retournera pas ! Elle croit entendre des mâchoires claquer quand ses talons tapent le bitume mouillé, alors elle se met à sauter à chaque pas. Elle a tellement la frousse qui monte, qui monte, qui inonde tout, qu’elle croit sentir des dents ripper sur ses mollets. Alors elle se met à courir pour de bon. Autour d’elle, les maisons baissent. 3, 2, 1 étage ; elle s’écarte des boulevards, prend les ribines. Puis c’est les petits jardins avec plein de bordel tellement qu’on voit plus la pelouse. Et enfin, les grandes taules des entrepôts, les tas de grands machins en ciments, les petits champs de ronces entourés de grillages défoncés. Elle s’arrête qu’après que les trottoirs ne sont plus que des morceaux de goudrons pleins d’herbes. Là, elle s’appuie à un caddie renversé et commence à vider son estomac entre les roues. Ça lui brûle tout le long de la gorge jusqu’au derrière des dents. Elle a rien dans le bide à part les pilz de la Pampa, du coup c’est dur à sortir. Il pleut toujours. Bambi s’essuie la bouche et mate autour d’elle. Son cerveau analyse rien, elle bug, n’arrive pas à séparer le ciel des bâtiments. Elle se met à longer les hangars qu’elle touche de la main pour être sûre. Après quelques tours il y a un détail qui revient. Ça connecte juste assez pour qu’elle passe en mode automatique. Elle suit un chemin de broussailles aplaties entre des buissons d’ajoncs plus grands qu’elle, passe derrière des poubelles qui cachent un trou dans une clôture avec des barbelés au-dessus, traverse un terrain vague qu’était un parking avant, et arrive enfin devant un grand bâtiment abandonné. La façade est toute lisse à part pour une porte encerclée de rouille calée en plein milieu. Bambi l’agrippe à deux mains et tire. Sa robe craque dans le dos. Elle sent qu’un nouveau filet de bile remonte de son bide. La porte bouge avec un grincement de métal froissé. Elle l’entrouvre à peine, puis elle attend. C’est la règle. Avec le vent qui perce entre les mailles de sa fringue et son manque, elle commence à claquer du dentier. Elle a l’idée de s’accroupir pour être moins vu. Ça la fait pisser direct. Bambi regarde la petite flaque d’urine s’étaler entre les graviers et ça lui donne envie de chialer parce que ça la renvoie 20 ans en arrière, quand elle s’appelait pas encore Bambi. Elle a à peine le temps de finir que la porte s’ouvre carrément.
2 notes
·
View notes
Text
"Avec le recul, j'ai compris ce qui a donné à cette séparation son caractère outrageant, et qui l'a rendue si insoutenable, c'est qu'elle est intervenue entre deux personnes qui s'aimaient. Devant ce paradoxe, la raison ne peut échouer, laisser place à un seul sentiment d'arbitraire qui déboussole plus sûrement que n'importe quoi. Qui tient le couteau, qui décide du sacrifice, qui a tord et qui a raison ? Jusqu'où peut-on poser sa souffrance au milieu de l'histoire comme un fil de fer barbelé, en faisant comme si l'autre n'existait pas ? Il aurait fallu que j'apprenne à mépriser et à haïr l'homme qui ne savait plus, mais cela, je n'ai pas pu. Il est resté là, en moi, fiché d'abord comme une écharde, ensuite irriguant mon sang, ma peau, ma conscience, par les mille et un réseaux de la mémoire, par la somme d'empreintes qu'il avait déposé en moi. Il est resté tout près de mon cœur et de mon souffle, et il a, à sa manière, refusé de me quitter. Longtemps, j'ai pensé que quelque chose de définitif était mort en moi après son départ ; aujourd'hui, je ne serais plus aussi affirmative. C'est comme s'il s'était installé ailleurs, beaucoup plus profondément, comme si une part de lui s'était mêlée à moi, une part qui avait toujours été là depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, ce jour où nous n'avons rien choisi, car il arrive, et l'on n'y peut rien, que la vie choisisse à notre place. Ce sont les effort que j'avais faits pour le combattre qui m'avaient montré que ce qui nous liait était de l'ordre de l'essentiel."
Hélène Gestern - Un vertige
17 notes
·
View notes
Text
Au coeur d’identités: Le Palais des orties de Marie Nimier, Fille de Camille Laurens

Il y a vingt ans, c’était en 2000, Henriette Zoughebi, alors directrice du Salon du livre de jeunesse, et le CPLJ-93 organisaient un colloque portant le titre “Féminin-Masculin, voyage au coeur des identités”, présenté de la manière suivante: “La différence des sexes, l’identique et le différent, structurent la pensée, la relation humaine, la culture. La relation à l’autre nous définit. Emprunter ensemble les chemins qui façonnent les comportements de chacun, sa relation à l’autre sexe, comprendre les jeux de la sexuation et de la mixité, les logiques d’identification familiales, culturelles, sociales, croiser les cheminements individuels et collectifs, s’aventurer plus avant sur ce territoire intime, sensible, vivant: telle est la proposition de ce périple au coeur des identités. »
A ce colloque s’étaient succédés Arlette Farge, Geneviève Fraisse, Michel Surya, Geneviève Morel, Christophe Honoré, Lydie Salvayre, Patrick Ben Soussan, Maryse Vaillant, Marie Nimier, Fethi Benslama, Philippe Alonzo, Camille Laurens, Thierry Guichard, Claire Simon et d’autres encore. Les deux journées avaient été closes par Julia Kristeva. Bien que n’ pas novice, j’avais été impressionnée par la qualité des interventions et la notoriété des intervenants. Je prenais et apprenais. A l’époque je n’avais encore lu ni Marie Nimier, ni Camille Laurens.
Le 20 août 2020, la Fondation Jan Michalski, à Montricher, invite Marie Nimier à parler de son nouveau roman, « Le Palais des orties », qui sort le jour même. Je l’ai lu et me réjouis de la réentendre. Quant à Camille Laurens, elle est présidente d’honneur du Livre sur les quais, à Morges, début septembre, et présente elle aussi son nouveau roman, « Fille ». L’une comme l’autre continuent à se questionner sur les identités, sur la femme.

Marie Nimier. Fondation Jan Michalski © Wiktoria Bosc
Le Palais des orties
Dans la ferme familiale dont Simon, le mari de Nora, a hérité et où le couple élève deux enfants adolescents, on cultive l’ortie. La transition vers cette plante s’est effectuée au décès des parents de Fred. Ce choix, qui pourrait sembler écologique ou farfelu branché, a été induit par la nécessité de vivre, pour ne pas dire de survivre. L’ortie pousse abondante et prolifère autour et bien au-delà du cocon familial, au gré des années qui filent, rythmées par le travail et les enfants à élever. Le fils, Noé, est un gentil garçon de treize ans, encore dans son monde, mais très manuel et toujours prêt à rendre service. Anaïs, sa sœur, dreadlocks et sarouel, sort tranquillement de l’adolescence. A dix-sept ans, les pieds sur terre, elle s’intéresse au monde, très à l’aise sur les réseaux de communication. Depuis peu, elle est interne dans un lycée agricole, mais continue à distance à participer à la vie familiale, voire à diriger la ferme, et souhaite développer la petite entreprise. La récolte des orties approche et les bras manquent. Anaïs a l’idée de brancher ses parents sur le woofing : contre le gîte et le couvert, un jeune offre ses forces de travail. Cette pratique permet de financer un voyage, par exemple, ou de découvrir la vie dans une ferme. C’est ainsi qu’un jour arrive Frederica d’on ne sait où, ni pourquoi.
Si Marie Nimier avait prévu d’écrire une histoire d’amour, elle s’est laissé entraîner sans trop s’en rendre compte à écrire sur le travail à la ferme et l’environnement familial, de sorte que, selon elle, le roman ne commence que bien plus tard. Pourtant, ces cent-cinquante premières pages sont un régal. En rendant son manuscrit à son éditeur, Marie lui a demandé de beaucoup élaguer le début – de désherber les mauvaises herbes ? - Lequel lui a répondu qu’il ne fallait surtout pas y toucher.
Fred débarque dans les premières pages et déjà l’équilibre de la famille s’en trouve bouleversé.
L’arrivée de Fred marque le début d’un cycle nouveau. Une page se tourne. Il devient important de se souvenir.
Après tout, c’est normal ! Jusqu’ici ils ont vécu entre eux. Le couple est fort, lié par l’enfance compliquée de l’un et l’autre. Simon est un taiseux, Nora semble très maternelle. On comprend que s’ils vivent là, cela n’a pas toujours été le cas et que c’est par la force des choses qu’ils se sont installés à la ferme du vivant des parents et y ont développé des racines, sans doute plus encore après la mort de ces derniers. Ils vivent de débrouille, dans leur réalité, même si, plus tard dans le roman, ils iront vers une forme d’utopie amenée par les idées de Fred et de leur fille Anaïs.
Nora observe, avertit le lecteur. Ce dernier se demande sur qui la foudre va tomber, du couple, des enfants, des voisins, du village…
Qu’elle s’en aille, je me dis. Trop belle pour travailler dans les orties.
Mais voilà… Nous n’avions pas les moyens de renvoyer une bénévole sous prétexte qu’elle était arrivée vingt-quatre heures en avance et que ses chevilles étaient plus fines que les pattes du chien.
Fred, la sans racines, reste et s’installe ; elle est travailleuse et a besoin d’être appréciée, aimée. Nora est sur la réserve. On la sent jalouse, mais de qui, de quoi ? Pourtant les rapports entre les deux femmes vont se tisser doucement dans les interstices du travail quotidien, y ouvrant des échancrures.
L’ortie, plante rudérale - elle pousse sur les décombre – et envahissante, migre et se moque des territoires, des frontières, des barbelés, du sang et de la poussière que l’on retrouve dans le roman. Les orties piquent, on ne les aime pas et on les arrache. Elles ont pourtant des propriétés intéressantes, bénéfiques. Tout comme Fred. C’est dans la chaleur et le vert de ses orties que Nora, la narratrice, réveille nos sens ; ses mots portent des images, des sensations. Sa sensibilité est contagieuse quand elle nous conte les semaines qui vont suivre, jusqu’au lendemain blafard. Le livre se referme sur la famille et le lecteur sait déjà qu’il en conservera des images fortes et sensuelles, cinématographiques.
Fille
Laurence Barraqué grandit avec sa sœur dans les années 1960 à Rouen. « Vous avez des enfants ? demande-t-on à son père. – Non, j’ai deux filles », répond-il. Naître garçon aurait sans doute facilité les choses. Un garçon, c’est toujours mieux qu’une garce. Puis Laurence devient mère dans les années 1990. Être une fille, avoir une fille : comment faire ? Que transmettre ? Quittons la quatrième de couverture et entrons dans l’histoire de cette fille qui, presque dès sa naissance dans les années soixante, réalise qu’elle n’a pas la même valeur qu’un garçon. Il n’est que se pencher sur la langue française pour le comprendre, ce que fait abondamment, de façon chirurgicale et avec délectation, Camille Laurens au début de son roman qu’on sait – pour partie du moins – autobiographique. Que ce soit au niveau de l’éducation, du couple, de la place dans la société, tout est à faire. Et de rêver que dans sa chair, la femme ne soit plus blessée, que certains mots tels règles douloureuses, avortements, abus, accouchements difficiles, sexualité non consentie sortent, d’une certaine manière, du dictionnaire. Même si l’écriture et le ton sont très différents, on se souvient des romans d’Anne Ernaux dont le témoignage nous a appris et continue de nous apprendre à être femme.
Son roman, Camille Laurens le dédicace à sa merveilleuse fille. Tout au long de sa lecture, il faudra s’en rappeler car l’auteure n’épargne pas son lecteur, sa lectrice. « Fille » gratte où ça fait mal. Les jeux sur les mots s’enchaînent, ironiques. On aimerait rire jaune, prendre du recul et trouver l’apaisement. Elle, Laurence, le trouvera en apprenant petit à s’affranchir et à être mère de sa fille. Cela ne se fera pas tout seul et il lui faudra du temps pour se défaire de l’angoisse liée à cette enfant, au doux prénom d’Alice, qui, jusqu’à l’adolescence, voudra être un garçon. On pense alors au fils perdu à la naissance, celui de Laurence, de Camille, au trou béant qu’Alice peut-être a voulu combler. Mais foin de psychologie pour nous pencher sur le système narratif magistral utilisé par l’auteure.
Le premier chapitre relate la naissance de Laurence : « C’est une fille. » L’auteure, comme si elle se penchait au-dessus du berceau, y utilise le tutoiement qui la mène jusqu’aux trois ans de la petite et à cette dernière phrase du chapitre : « C’est quoi, tes souvenirs de fille ? » Laurence a trois ans, elle sait maintenant parler et va pouvoir répondre dès le second chapitre, égrainant ses souvenirs d’enfant, ses hontes, ses questionnements. Elle laisse la place, trop vite, dès les premières lignes du chapitre quatre, à l’auteure Camille Laurens : Je la vois, dis-je. À travers le temps, je me reconnais en cette enfant comme dans un miroir, mais c’est à une autre que les choses arrivent, sinon je ne peux pas. Elle sort de la baraque aux lapins, elle vient de leur glisser des fanes de carottes à travers le grillage du clapier. Elle porte un short en vichy et une chemisette roses. Je ne sais pas exactement quel âge elle a, je dirais qu’elle va sur ses neuf ans : C’est le premier été à La Chaux sans son papy Maurice, et cela n’aurait pas pu avoir lieu avant, quand il était vivant, personne n’aurait osé. Ce n’est pas arrivé plus tard non plus parce que l’année de ses dix ans elle sera tout le temps malade, c’est l’année où sa peau se plaint, où son corps porte plainte.
Lui, c’est le frère aîné de son grand-père […]
Le « Je » ne pourra réapparaître que des années plus tard lorsqu’Alice découvrira le désir, lorsque Camille Laurens la sentira prête :
Tu te souviens d’elle, de cette fille-là, de l’irruption fracassante du désir dans sa vie ? Oui, je m’en souviens.
Qui dit désir, dit sexe. Pas forcément bon. Puis un avortement. Fin de la première partie et de l’adolescence. Alice est adulte quand s’ouvre la seconde partie du roman. Elle accouche de son premier enfant, un garçon :
Tu n’en reviens pas, tu as un « garçon » à l’intérieur de toi. Ce mot est ton triomphe. […] C’est ton père qui va être content, tout de suite tu penses à lui, à son espoir que tu réalises enfin, le décalant seulement d’un rang : à défaut d’être le père, il sera le grand-père d’un garçon ; […] Tu vas rendre ton père heureux – pas trop tôt.
L’accouchement, catastrophique, est mené par un obstétricien incompétent recommandé par le père de Laurence, une alliance mondaine dira cette dernière. Le petit Tristan n’y survit pas. Camille Laurens est revenue au «Tu». Elle le conservera durant l’entier de la seconde partie du récit. Et si les mots sont empreints de dérision, c’est sans doute parce que l’auteure a déjà écrit auparavant sur « Philippe » (1995), « Cet absent-là » (2004).
Puis un jour naît Alice. Avec son arrivée, Laurence va apprendre à être mère, elle parvient désormais à tenir sa vie dans ses propres mains. Le lecteur lui en est reconnaissant. Il avait besoin de ce « Je » qu’il lui souhaite définitif.
Le Palais des orties, Marie Nimier, Gallimard, 2020 Fille, Camille Laurens, Gallimard, 2020

Au moment de prendre en photo les couvertures des livres sur le balcon, la lumière d’automne illumine les arbres, le ciel, les montagnes et un échantillon du lac. Dans la réalité, les couleurs sont plus vives, plus chaudes, les nuages se teintent de rose.
3 notes
·
View notes
Text
La fuite

A l’autre bout de la ville, on trouvait une usine particulièrement étrange. Personne ne sut ce qu’on y fabriquait. On vit de nombreux camions entrer et sortir sous la surveillance extrême de gardes bizarrement armés. De même, tout le monde put voir les moyens high-tech utilisés concernant la sécurité du site. Les véhicules qui avaient le droit d’y circuler, étaient matriculés à l’image des voitures diplomatiques. En fait, personne habitant la ville n’y travailla. Les employés vivaient dans une mini-ville au sein de l’entreprise. Leurs enfants eurent leur propre école, il y avait même une clinique privée. Parfois, le Président Directeur Général se montrait durant les soirées officielles mais il restait toujours évasif quant à la fabrication des produits de l’usine. Officiellement, c’était une entreprise de colorants et produits dangereux ; suffisant pour être classé SEVESO. Seulement, une autre usine de ce genre existe aussi. Elle contribue à faire vivre la cité en employant plusieurs centaines d’habitants contrairement à cette étrange usine.
Les gens s’habituaient à sa présence quand tout arriva soudainement. Les alarmes résonnèrent durant la nuit, jamais l’usine n’était autant éclairée. Elle flashait, illuminant le ciel au point d’inquiéter la population. Déjà que sa réputation n’était pas terrible, mais cette nuit, les fans des théories du complot eurent de quoi écrire sur les réseaux sociaux : Explosion ou fuite radioactive, mutation liée à des expériences chimiques ou médicales, évasion d’un extra-terrestre qui en avait marre de se faire charcuter, révolte de prisonniers type Guantanamo… Enfin toutes les théories les plus farfelues furent émises.
Deux jours après, je ressentis encore cette étrange peur dans la région. Les policiers avaient eu ordre de visiter chaque maison voisine, chaque lieu isolé et d’arrêter les voitures sans donner la moindre explication aux médias. Ils cherchaient quelque-chose c’est tout ce que je savais. Juste après une fouille du coffre de ma voiture ainsi que de sous le siège arrière, je repartis et me dirigeai vers l’ancien collège. Abandonné depuis longtemps, il avait été prévu de le réhabiliter. Alors, j’avais été sollicité pour vérifier s’il était possible de le restaurer en différents services municipaux. J’avais la clé, toutefois, comme la porte était ouverte, je n’eus pas besoin de l’utiliser. J’entrai vérifiant l’état de chaque mur dont la peinture s’effritait; les salles vides semblèrent tristes. De plus, j’entendis les échos de mes pas tellement le bâtiment était démeublé. Il n’y avait rien à part des toiles d’araignées. Je marchai tranquillement, observant, prélevant quelques échantillons par endroits afin de connaitre le taux d’amiante lorsque j’entendis tousser. « Il y a quelqu’un ? » criai-je. Sans réponse, et me souvenant de la porte d’entrée fracturée, je pensai immédiatement à un SDF. Dès lors, je préférai me taire ni bouger afin de discerner s’il y avait un possible danger. Même le silence semblait triste. Je marchai doucement, cherchant à ne pas effrayer l’intrus, ou plutôt à le surprendre. Mais rien ne se fit entendre. Alors, je continuai mon enquête concernant l’amiante et la vétusté du lieu.
A peine cinq minutes après, un toussotement retentit de nouveau. Cette fois, j’avais repéré son origine. Prenant mon courage à deux mains, je me précipitai dans ce qui fut le centre de documentation. J’entrai précipitamment, montrant mon plus mauvais regard quand je les aperçus. Elles étaient assises, adossées contre un des nombreux piliers de la pièce. Elles essayèrent d’abord de se cacher puis en me voyant, elles décampèrent, courant d’une étrange façon, comme si elles n’avaient jamais couru. Leur longue robe blanche rappelait les hospices psychiatriques du XIXe siècle. Leurs cheveux longs pourtant bien coiffés laissaient à penser qu’elles étaient jumelles. Toutefois, il y avait une énorme différence dans la forme de leur visage. Elles courraient ; seulement pieds nus, elles ne purent aller loin avant que je les rattrape.
J’avais réussi à empoigner la première qui allait sortir de la bibliothèque empêchant en même temps la seconde de fuir. Elle se mit à courir dans tous les sens dans l’immense salle telle une malade, tandis que je calmai et raisonnai sa compagne. Cette dernière criait comme un animal sauvage. Je pus toutefois la rassurer en la lâchant et simplement avec un ‘chut’ dont je découvris son effet apaisant. Elle me regarda de ses yeux noirs. Son visage semblait comme neuf, loin d’être abîmé par la vie. Même ses mains ne contenaient aucune ride d’usure. Je me présentai. Elle me regarda, continuant à écarquiller les yeux. Je compris qu’elle ne parlait pas français ; ni anglais, ni espagnol, ni aucune langue dont j’avais quelques bribes. Pendant ce temps, son amie arrêta de courir. Epuisée, elle se laissa tomber le long du mur sous la fenêtre. Je crus l’entendre pleurer. D’un geste lent pour ne pas les effrayer, je sortis de mon sac une bouteille d’eau et proposai à la plus proche de boire. Elle me dévisagea sans comprendre. Je portais la bouteille à mes lèvres et bus une gorgée, puis je tendis la bouteille qu’elle prit. Seulement, elle ne comprit pas le principe et laissa couler la moitié de l’eau contre son menton. Toutefois, je vis un léger sourire sur son visage après avoir bu. Elle tourna la tête vers sa copine et l’appela en utilisant une espèce d’onomatopée. Apparemment, elles étaient muettes puisque l’autre répondit de la même façon pendant qu’elle se relevait et s’approchait de nous. Elle prit à son tour la bouteille et laissa couler l’eau tout en lapant du bout de sa langue tendue. En voyant sa façon boire, j’ai pensé à des enfants sauvages.
Il a fallu plusieurs minutes pour me faire comprendre. Elles acceptèrent de me suivre. J’abandonnai mon travail et les emmenai à l’hôpital afin de les soigner et les aider. Durant le trajet, je remarquai leur totale ignorance des voitures. Déjà, l’une d’elle vomit une sorte de bile blanche. Je constatai ainsi qu’elles n’avaient rien mangé. Je profitai donc d’un arrêt pour leur offrir mon repas, deux sandwichs très vites dévorés ainsi que quelques mandarines. Je fus stupéfait de le voir croquer dans la peau du fruit ; elles n’avaient jamais mangé de mandarine auparavant. Je conduisis la voiture ensuite vers l’hôpital. En passant devant l’usine, elles eurent un sursaut. L’une d’elle paniqua, criant des mots incompréhensibles. La seconde fit de même. Elles pleurèrent, sautant, hurlant, vociférant telles des malades en pleine crise d’hystérie. Soudain, elles se calmèrent aussi vite dès que nous quittâmes l’endroit. Elles continuèrent à regarder l’immense bâtiment sinistre clôturé de barbelés. L’une d’elle soupira, posant sa tête sur l’épaule de son amie. Cette dernière lui caressa les cheveux tout en essuyant ses joues mouillées par quelques larmes. Je roulai sans difficulté, sans rencontrer de barrage, jusqu’à l’hôpital. Là, je les accompagnai aux urgences, expliquant la situation. L’hôtesse d’accueil pensa avoir affaire à des migrants clandestins. Toutefois, elle prit mon nom, me donna un numéro, et me fit patienter avec les deux jeunes femmes. Nous attendîmes une bonne heure. En découvrant un distributeur, j’offris quelques barres chocolatées qu’elles dévorèrent sans difficulté. J’attendis quand un jeune interne appela mon nom.
Il remonta ses lunettes à plusieurs reprises, signe qu’il était perplexe. Il inspecta chacune des filles, leurs jambes, leur dos, leur pouls. Il m’utilisa pour expliquer comment ouvrir et tirer la langue. Il ne savait que dire. Puis, il me prit à l’écart : « Vous les avez trouvez ou ? » « Dans l’ancien collège » répétai-je. Il semblait perdu avant de dire : « Elles sont en très bonne santé. Mais, avez-vous vu leurs pieds et leurs mains ? On croirait des peaux de bébé comme si elles n’avaient jamais marché ». Je restai muet ne sachant quoi exprimer. « Et c’est pareil, c’est quoi cette tenue ? Elles sortent d’où ?» ajouta-t-il. Il nous abandonna, préférant un autre diagnostique. Je restai avec les miss ; leurs manières étaient tracassantes car elles se comportaient comme des filles de six ans malgré un physique de vingt ans. Alors, je les rassurai par moment en leur faisant des grimaces ou m’amusant à loucher. Je me suis même amusé à chantonner « le soleil brille ». Cela fonctionna puisque leurs yeux s’illuminèrent, irradiant en même temps leur minois d’un large sourire. Je constatai pour la première fois leurs dents blanches et soignées. Nous n’attendîmes pas longtemps avant que le médecin revienne avec un collègue plus vieux. Il observa les deux filles, discuta avec son confrère puis il me posa les mêmes questions. Je n’eus pas fini de répondre qu’un groupe de policiers fit irruption dans la salle, entrant sans ménagement pour les autres patients ni pour le personnel. La tête des deux filles fut immédiatement recouverte d’un sac en toile noire, un agent plaqua au sol l’interne qui voulait s’interposer tandis qu’un autre m’empoigna par le col, menaçant d’utiliser son arme si je tentais quelque-chose. Je pus voir que leur uniforme de gendarme quoique semblable n’avait rien d’officiel. D’ailleurs, ayant affaire avec les policiers de la ville, je n’en connaissais aucun présent à ce moment. Le groupe disparut aussi vite, emportant avec eux les filles dont les cris étaient étouffés.
Quelques jours après, il se produisit un événement étrange dans l’usine. Les voisins constatèrent d’énormes feux, tel des brasiers au milieu de la cour. Certains témoignèrent avoir entendu des chants, comme si des milliers de personnes fredonnaient « le soleil brille ». Et puis, il y a une odeur insupportable. Malgré les plaintes, la police ne put intervenir ni entrer. Cela dura deux jours, puis plus rien. L’usine fut abandonnée, tout le matériel déménagé en une nuit, laissant place à des légendes. La plus connue reste celle racontée par des amateurs d’exploration urbaine : Ils auraient découverts des ossements humains carbonisés ainsi que du matériel de chirurgie. Quant à moi, j’ai mon idée. Surtout après avoir reconnu à la télévision l’une des deux filles. Elle raconta comment, après quelques greffes, elle survécut à un cancer généralisé faisant l’apologie d’une entreprise dont le logo est encore visible à l’entrée de l’usine. Son langage était très clair et n’avait rien des interjections utilisés par son clone…vraiment rien !
Alex@r60 – janvier 2020
Photo : Ihon Gouldin ?
12 notes
·
View notes
Link
« On ne sait par où commencer, tant là aussi la désolation est totale. Il y aurait en effet énormément de choses à dire sur l’état de la liberté d’informer en France depuis l’élection du petit Prince du CAC 40, où en deux ans et demi, ce ne sont pas moins de trois lois liberticides touchant directement l’exercice de la profession qui auront désormais été présentées au Parlement français.
La « loi sur le secret des affaires » tout d’abord, entrée en vigueur dès l’été 2018, transposition d’une directive européenne visant à protéger les deals avouables ou inavouables des grandes entreprises et autres banques contre la curiosité des enquêteurs et des lanceurs d’alerte. La loi dite sur « les fake news », adoptée en catimini juste avant Noël 2018, alors que la France était dans un climat quasi insurrectionnel, et que tous les regards étaient anxieusement tournés ailleurs, vers l’Arc de Triomphe et les autres ronds-points de France. Et bien sûr la Loi Avia dite « loi contre les contenus haineux sur internet », en seconde lecture à l’Assemblée, objet en ce moment même d’une bataille acharnée du Sénat, mais qui sera néanmoins très probablement adoptée, l’Assemblée nationale n’étant plus, on le sait, qu’une chambre d’enregistrement des exigences présidentielles, et au-delà, européennes.
Il y aurait énormément de choses à dire donc, on concentrera néanmoins ce propos sur les répercussions sur la profession de journaliste du plus grand soulèvement populaire connu par la France depuis au moins cinquante ans, à savoir le mouvement des Gilets jaunes. Depuis ce surgissement inattendu, proprement miraculeux en termes de réveil de l’intelligence collective, de remise en marche de l’Histoire, autant que de révélation de la dégénérescence terminale d’un système, notre métier s’est vu en effet soumis à une remise en question publique d’une profondeur inédite.
On croyait pourtant que tout avait été dit, depuis des années, en termes de critique de médias. Et d’une certaine façon, tout avait été dit, sur les journalistes devenus simples agents gouvernementaux, toutous du capital, domestiques posant aux héros du monde libre. Seulement voilà, et c’est là la grande nouveauté, ce qui se disait à bas bruit, sur des sites de bourdieusiens revêches et de complotistes radicalisés – c’est comme ça qu’ils nous voient et nous ont longtemps dépeints – a commencé à se dire partout. Dans la rue. Sur des groupes Facebook de centaines de milliers de personnes. Jusqu’aux pieds des locaux de groupes de médias, devant les immeubles de la télévision nationale parfois, où ont pu se regrouper des manifestants certains samedis depuis fin 2018.
Ainsi des pans entiers de la population, jusqu’ici tenus éloignés de ces questions sulfureuses, objets d’un déni massif de la part des professionnels du secteur, ont commencé à parler couramment de « médias du CAC 40 », de « médias mainstream », par opposition aux médias indépendants, de « Charte de Munich », autant de références qui, il y a trois ans encore, valaient mise au ban professionnelle, et quasi procès en psychiatrie – nous sommes quelques-uns à pouvoir en témoigner. Désormais le roi est nu. Plus personne ne peut nier, sans se discréditer intellectuellement, la toxicité d’un système médiatique où les journalistes, supposés gardiens de la vérité, sont salariés par les oligarques les plus puissants du pays, les maîtres des télécoms et autres Goliaths du luxe, qui ont un intérêt direct à ce que celle-ci ne soit jamais dite. Il aura fallu toute l’innocence d’un peuple soulevé pour rendre à nos constats leur évidence, en même temps qu’une consistance irrécusable – désormais acquise, c’est là le point.
Les conséquences de cette déflagration sont multiples. La valeur de la sacro-sainte carte de presse – brevet actant en quelque sorte votre appartenance irrécusable à la profession – s’en est trouvée fortement chahutée. Comment aurait-il pu en aller autrement ? Si le sens du métier, si sa morale même, est de chercher la vérité et de la dire, quoiqu’il en coûte, comment les reporters en première ligne auraient-ils pu ne pas être soudainement considérés comme tout aussi journalistes que les poussahs des plateaux télé grassement payés pour déjeuner avec des attachées de presse ? Comment les plumes engagées ne seraient-elles pas désormais plus soutenues par la ferveur populaire que les plantes vertes télévisées servant de simple relai à la parole ministérielle ?
On a ainsi vu pousser sur le pavé ou sur les réseaux des dizaines de nouveaux journalistes. Des agences de presse obscures, ou jusqu’ici marginales, sont devenues plus scrutées certains week-ends que l’AFP elle-même. Des titres jusqu’ici nains ont parfois plus pesé sur le cours des événements depuis deux ans que des géants subventionnés à coups de millions d’euros par l’argent public et les subventions des GAFAS. Des noms de journalistes inconnus ont surgi sur les bandeaux de BFM. Des titres jusqu’ici confidentiels ont pris une ampleur inattendue, ou sont sortis de terre en à peine quelques mois.
Cette situation a bien sûr suscité un certain affolement dans les étages directoriaux des grands médias, où on a ainsi pu observer plusieurs types de réactions.
La première d’entre elle, quand on était encore dans le vif de l’événement, fut une tentative d’adaptation sauvage. Ainsi a-t-on vu au cours de l’hiver 2018-2019, un des présentateurs de la première chaîne française d’information française en continu, Thomas Misrachi, citer à l’antenne « Le Nombre jaune », instance autonome de comptage des manifestants, comme une source d’information crédible face aux chiffres du Ministère de l’Intérieur. Le temps a suspendu son vol quelques minutes sur l’antenne de BFMTV lors de ce magnifique et terrible hiver. On a pu même avoir parfois l’impression d’être passé dans un univers parallèle. Durant quelques semaines en effet, les plus zélés des serviteurs de l’ordre se sont en effet eux aussi aperçu que le fait de se borner à donner les chiffres d’un gouvernement éborgneur, pouvait les ranger dans le camp des bourreaux, suscitant un puissant malaise. Ces moments de pur vertige – qui prouvent d’ailleurs au passage les effets pédagogiques de la peur – n’ont toutefois guère duré. Rapidement on est revenu à la routine de la place Beauvau, ultime arbitre des chiffres et du discours.
Le second type de réaction fut bien sûr la disqualification et les ricanements. Des journalistes qu’on n’avait pas vu sur le terrain depuis des années – si on les y avait jamais vu un jour –, ont ironisé lourdement sur ces nouveaux venus s’imaginant qu’une GoPro tenait lieu de sauf-conduit professionnel. Policiers et éditorialistes, main dans la main, se sont alors transformés en vigiles pour déterminer qui avait le droit ou non de rendre compte de la réalité du terrain.
Parmi d’innombrables exemples possibles, on n’en prendra qu’un, très récent. Le 19 janvier 2020, le fameux correspondant du quotidien Libération à Bruxelles, Jean Quatremer, connu pour ses opinions européistes et macronistes vindicatives, écrivait sur le réseau social Twitter: « Le goût d’une partie de la profession pour le suicide est fascinant : affirmer que n’importe qui peut se proclamer journaliste, c’est tuer notre raison d’être, c’est affirmer que la profession n’a aucune valeur ajoutée. »
Ce faisant, l’éditorialiste ne faisait d’ailleurs que paraphraser, comme souvent, les propos d’Emmanuel Macron, lui-même, dont les vœux à la presse de début 2020 furent entièrement articulés autour d’une obsession phare : « L’information est une affaire de professionnels. » Ainsi la carte de presse serait une sorte de Jockey club. Ce qui tuerait la raison d’être du journalisme, ce ne serait pas sa soumission aux puissances d’argent ou au pouvoir politique, pour reprendre les mots mêmes du CNR dans les ordonnances de 1944 sur la presse, mais l’autorisation donnée à des manants de chasser sur des terres jusqu’ici soigneusement protégées de barbelés.
Cerise sur le gâteau, ce tweet de Jean Quatremer a aussitôt été brandi offensivement par un certain Denis Olivennes, factotum d’un des oligarques nouveaux venus dans la presse française, Daniel Kretinsky, magnat tchèque de l’énergie fossile. Après avoir racheté le journal Marianne, ce dernier est devenu un puissant actionnaire du groupe Le Monde aux côtés de Xavier Niel, et continue désormais son marché dans le domaine des médias français. Récemment il a pu ainsi entrer au capital de Polony TV, une de ces web télés qui se faisait fort de réinventer un paysage médiatique détruit par la pensée unique, et finit donc à la même mangeoire que tous.
Après avoir présidé la FNAC, Air France, puis le groupe L’Obs, et enfin le groupe de médias d’Arnaud Lagardère, les mauvais résultats de la station Europe 1 l’en ayant prématurément chassé, Denis Olivennes se retrouve aujourd’hui bombardé directeur opérationnel des médias dudit milliardaire Kretinsky. Rien ne se perd, tout se recycle au royaume des oligarques. Et voici ce que cet « ex » de la Fondation Saint-Simon, couvert de stock-options et de parachutes dorés, se permet aujourd’hui d’écrire : « Le journalisme militant est absolument contraire à la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes (Charte de Munich) qui impose notamment de « ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui de propagandiste ». Si ce n’était simplement dérisoire, ce serait d’une rare perversité. Une des incarnations les plus décomplexées du pouvoir oligarchique dans les médias, Denis Olivennes, se réclamant aujourd’hui de la Charte de Munich, c’est El Chapo brandissant le Code Pénal, ou Gabriel Matzneff, citant Au pays de Candy.
Qu’est-ce que la Charte de Munich, en effet ? Une déclaration de 1971, adoptée par la Fédération européenne des journalistes, non contraignante hélas, et bien évidemment. L’une des seules protections, purement indicative donc, que les journalistes puissent mettre en avant contre leurs actionnaires. Un des seuls remparts qu’ils puissent brandir face à leurs maîtres.
À la ligne 3 de la Charte de Munich, on lit la puissante phrase suivante : « La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l’égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics ».
Quelle plus belle perspective que d’autoriser le journaliste à brandir la souveraineté du simple citoyen face à celle des propriétaires de médias, et face aux intérêts nationaux ? Il y a donc de quoi ressentir un certain vague à l’âme à voir Denis Olivennes, un de ces personnages dont l’unique raison d’être, où qu’ils soient parachutés, est de faire régner inflexiblement la loi des actionnaires, tenter de détourner à son profit la fameuse Charte.
Ainsi les plus cyniques des médiacrates, les véritables Stormtroopers du capital, loin de prendre la mesure de la gravité de la crise des médias en cours, ont-ils au contraire tenté de pousser le désastre à leur avantage, en mettant toujours plus de vigiles à l’entrée du night club de la presse, plutôt que d’accompagner son indispensable réforme. Fort heureusement, certains signaux sont plus prometteurs, voire annonciateurs de grands bouleversements dans notre métier.
Un seul exemple là encore. Les services de fact checking, qui servaient jusqu’ici très souvent de simple alibi commode aux médias mainstream, se sont, eux aussi, trouvés pris dans la bourrasque de l’Histoire. Leur cas est particulièrement intéressant.
Ces îlots de vérification au sein des rédactions, très à la mode depuis les années 2010, étaient littéralement en train de transformer le métier de journaliste en celui de simple garde-barrière des petites vérités factuelles. Le fact checking permettait en effet de cantonner le journalisme à l’exercice d’une apparente neutralité, de ne surtout jamais aborder la vérité autrement que par petits bouts disparates, sans jamais s’intéresser au tableau d’ensemble. Nul hasard à cet égard si les GAFAS en sont venu à les rémunérer au sein des médias à coups de millions d’euros, et à nouer des accords avec eux pour patrouiller sur les réseaux sociaux, afin de séparer le bon grain du journalisme de préfecture, de l’ivraie des sites séditieux.
Pourtant, même ces services modèles de l’information pasteurisée, et globalement inoffensive, se sont eux aussi retrouvés piégés par ces temps nouveaux. Face à l’afflux de nouvelles affolantes venues de la rue durant le grand hiver des Gilets jaunes, les fact-checkeurs ont dans un premier temps appliqué les vieilles méthodes, celles qu’on leur avait inculqué en écoles. Ils ont recalculé la taille de la casquette du préfet Lallement, pas si énorme qu’on le disait sur les-réseaux-sociaux. Ils ont ergoté sur le véritable prix d’une bouteille que s’était un jour offert le clan Macron au pied des remonte-pentes, pas si chère qu’on le disait sur les-réseaux-sociaux. Rien que des exemples authentiques là-dedans hélas.
Et puis, au bout d’un moment, sous la pression des sollicitations multiples venues de leurs lecteurs, ils se sont mis à faire vraiment le job. Et là, les résultats ont été ravageurs. La vérité est un maître tyrannique quand on commence à la prendre au sérieux. Les fact-checkeurs se sont ainsi vus obligés de confirmer des censures, de démentir des communiqués ministériels, de reconnaître des violences commises contre les citoyens. Durant quelques mois, on les a vus au pied du mur, dans l’obligation littérale de contredire les pouvoirs qu’ils servaient jusqu’ici avec bonne conscience.
Il y aurait encore énormément de choses à dire encore sur la façon dont ce métier a été percuté par l’Histoire depuis la fin de l’année 2018. Finissons toutefois par une touche optimiste. La situation est sinistre, la France est en position toujours aussi peu reluisante dans le classement de la liberté de la presse mondiale, l’étau des oligarques ne cesse de se resserrer sur les grands titres nationaux. Mais répétons-le : la vérité est un maître tyrannique quand on commence à la prendre au sérieux. Quand les temps deviennent violents et injustes, la simple honnêteté factuelle, le simple constat, la froide observation, deviennent en effet tout aussi dangereux pour le pouvoir que le plus enflammé des tracts. Le pouvoir macroniste aura réussi à refaire des journalistes dans leur ensemble une corporation dangereuse. Chapeau l’artiste, ce n’était pas gagné.
#gallomancy#quartier général#aude lancelin#éditorial#presse libre#le média libre#liberté d'expression#liberté de la presse#réseaux sociaux#journalisme#politique française#société française#charte de munich#éthique
5 notes
·
View notes
Text
dans mon ombre, la fuite
Voilà. Le mal est fait, j'ai encore fui. La mécanique est bien huilée, les déclics se produisent sans bruit, de plus en plus rapidement. Je ne tiens plus sur la longueur et l’ambiguïté me terrasse désormais en quelques heures. Impression de ramper comme une proie maladroite au milieu d'un champ de pièges à loups, je m'échappe dans un sursaut de terreur, me lacérant la chair contre des barbelés enroulés autour de mes pensées.
1 note
·
View note
Text
La corruption financière au plus haut
La corruption financière au plus haut
La cession d’Alstom masque une corruption économique et financière privée étendue au monde politique que protège la concussion et le népotisme de l’oligarchie française. (more…)
View On WordPress
#Alexandre Goldfarb#alstom#économie#concussion#Daniel Desurvire#desinformation#finances#français#France#goldfarb#gouvernement#L&039;affaire Alstom#l&039;Expert le Spécialiste l&039;Observateur et le Témoin#l&039;observatoire#la connaissance#La corruption financière au plus haut#la semaine du mensonge#les barbelés de la pensée#les polititocards#les socialo-menteurs#medias#mensonge#Minute du MENSONGE#népotisme#Observatoire du MENSONGE#politique#President#question de temps#socialiste#télévision
1 note
·
View note