#style iranien
Explore tagged Tumblr posts
Text
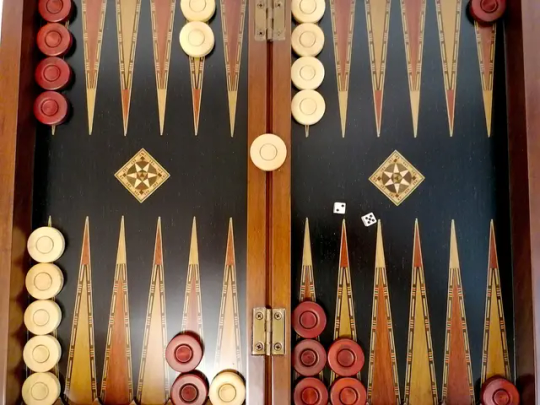


Tavla turc style iranien - Plateau d'échecs/ dames
8 notes
·
View notes
Text
Culture / Iran, le jour et la nuit

"Les Nuits de Mashhad". © Metropolitan FilmExport
NORBERT CREUTZ Édition du 9 septembre 2022
Le cinéma iranien se porte bien, à en croire l'arrivée de deux nouveau films sur nos écrans, «The Apple Day» de Mahmoud Ghaffari et «Les Nuits de Mashhad» d'Ali Abbasi. A y regarder de plus près pourtant, la réalité est bien plus complexe, entre censure d'Etat renforcée et contestation venue de l'étranger.
On avait quitté le cinéma iranien l'an dernier en apparent regain de forme avec Le Diable n'existe pas/There Is No Evil, puissant réquisitoire contre la peine de mort de Mohammad Rasoulof et Un héros, le dernier «thriller moral» d'Asghar Farhadi. Depuis est arrivé Hit the Road, premier essai relativement prometteur de Panah Panahi, et surtout, est tombée en juillet la nouvelle d'un nouveau tour de vis du pouvoir islamique, qui a renvoyé ses bêtes noires Rasoulof et Jafar Panahi (père de Panah) à la case prison. Ceci alors même que ce dernier a son dernier opus, No Bears, présenté à la Mostra de Venise... Mais que se passe-t-il donc dans ce pays placé sur la carte du cinéma mondial dans les années 1990 par les films d'Abbas Kiarostami et de Mohsen Makhmalbaf? Les deux films iraniens qui sortent ces jours, à une semaine d'intervalle, apportent un éclairage, à défaut de réponse claire.
Néo-réalisme dépassé
Premier arrivé, sous la bannière Trigon-Film, The Apple Day de Mahmoud Ghaffari est strictement du menu fretin. Un petit film de style néo-réaliste – le cinquième d'un auteur ayant milité en compétition au Festival de Fribourg – qui nous renvoie trente ans en arrière, lorsqu'il suffisait de montrer un gamin courant après des pommes pour attirer l'attention d'une critique mondiale prête à lire du sous-texte partout. Entendons-nous: ce style a eu son heure et ce nouvel exemple n'a rien de honteux. C'est juste qu'on n'y croit plus aussi facilement et qu'on a aujourd'hui plutôt l'impression de deviner un immense hors-champ.
L'histoire est donc celle d'un modeste vendeur de pommes en bordure de route qui se fait voler sa camionnette et de son fils aîné qui essaie de l'aider tout en rassemblant le panier de pommes (hebdomadaire?) que la maîtresse a demandé en guise de paiement. Cela se passe en banlieue pauvre de Téhéran et les seules échappées sont des souvenirs du père, gagné par la nostalgie de la campagne. On suit tout ceci d'un œil un peu distrait, en guettant quelque propos plus ciblé. En vain. Tout le monde reste désespérément lisse et gentil dans cette chronique dont les maladresses finissent par agacer. Entre la déploration d'un nouveau quartier de tours où la famille n'habite même pas, une course-poursuite entre garçons jamais crédible, un retour à la ferme inexpliqué et des scènes de classe lénifiantes, sans oublier ce deus ex machinafinal qui résoud tout (Madame, qui lavait du linge, a apparemment été promue entretemps), on ne voit pas vraiment l'intérêt. Plutôt l'œuvre d'un cinéaste excessivement prudent, qui se plie à tous les interdits en appliquant sagement une vieille recette.
Une nouvelle frontalité
Les Nuits de Mashhad (alias Holy Spider) d'Ali Abbasi est l'exact contraire: un véritable brûlot, qui attaque l'hypocrisie de la société iranienne avec une frontalité inédite. L'explication de ce «miracle» est que son auteur est un Iranien émigré en Suède à l'âge de vingt ans (révélé en 2018 par Border, fable sur la différence à base de trolls), qui a pu financer son film en Europe avant de le tourner en Jordanie. Le résultat était en compétition au dernier Festival de Cannes, où son actrice Zar Amir-Ebrahimi, une autre exilée, a remporté un Prix d'interprétation féminine très politique. Il faut reconnaître qu'à partir de l'histoire vraie d'un serial killer qui a sévi au début des années 2000 dans la ville sainte de Mashhad, le quadragénaire Abbasi en dit plus long et plus fort sur l'asservissement des femmes au pays des mollahs que tous les films iraniens vus à ce jour.
Ici, après avoir assisté avant le générique à l'assassinat sordide d'une prostituée, on suit une journaliste, Rahimi, qui débarque dans la ville pour enquêter sur cette quinzaine de féminicides qui laisse la police apparemment perplexe. Son seul soutien est un collègue local. En parallèle, le cinéaste nous fait suivre le quotidien du tueur, un vétéran de la guerre contre l'Irak devenu maçon, pilier de mosquée et brave père de famille. Frustré d'un destin plus glorieux, il s'est mis en tête de «purifier» la ville de ses péchés en la nettoyant de ses «femmes de mauvaise vie». Après avoir mesuré l'absence totale de soutien envers ces pauvres filles tombées dans la misère, Rahimi ne voit plus d'autre solution que de servir elle-même d'appât pour provoquer l'arrestation du criminel. Elle s'en tirera de justesse, mais le film ne se termine pas là, Ali Abbasi embrayant ensuite sur la réaction effarante de la famille et de toute une société complice à l'occasion du procès, véritable parodie de justice. Une hypocrisie instituée en système va même jusqu'à se retourner contre celui qui est salué par la foule comme un héros...
Vers un autre cinéma iranien
Des deux films, celui-ci est incontestablement le plus important. Mais il ne satisfait pas pleinement pour autant, tant sa forme donne à mesurer un écart culturel. Ici, c'est adieu la finesse de la tradition persane, bonjour le sensationnalisme à l'occidentale! Réalisé comme un thriller doublé d'un pamphlet, le film est certes prenant et efficace, mais la complaisance dans le glauque (plus Abel Ferrara à ses débuts que Brian De Palma), le manque de précision dans les plans (déjà une limite de Border) et le montage à la truelle des scènes de tribunal gâchent l'expérience. D'accord, c'est pour la bonne cause; et les comédiens, eux, sont au moins excellents. Reste à savoir si un tel film pourra être vu, même sous le manteau, dans «son» pays ou s'il ne servira in fine qu'à renforcer nos préjugés contre une nation qui mérite forcément mieux...
Peut-être est-ce d'ailleurs l'ensemble du cinéma iranien qui se trouve aujourd'hui à un tournant. Bien sûr, comme dans tout art sous contrôle, l'immense majorité de la production actuelle est insignifiante. Mais pour le haut du panier qui nous concerne, derrière le minimaliste Panahi et l'habile Farhadi se profilent déjà les noms de Vahid Jalilvand (Beyond the Wall, un troisième opus en compétition à Venise) et surtout de Saeed Roustayi (Life and a Day, La Loi de Téhéran, Leila et ses frères). Des jeunes auteurs apparemment audacieux, qu'il nous tarde de découvrir. A moins bien sûr que nos distributeurs, de plus en plus frileux devant la nouveauté venue d'ailleurs, aient déjà laissé tomber?
youtube
« The Apple Day », de Mahmoud Ghaffari (Iran, 2022), avec Arian Rastkar, Mahdi Pourmoosa. 1h18
youtube
« Les Nuits de Mashhad (Holy Spider) » d'Ali Abbasi (Danemark-Allemagne-Suède-France, 2022), avec Zar Amir-Ebrahimi, Mehdi Bajestani. 1h56
#Cinéma#Iran#The Apple Day#Mahmoud Ghaffari#Les Nuits de Mashhad#Ali Abbasi#Le Diable n'existe pas/There Is No Evil#Mohammad Rasoulof#Jafar Panahi#Abbas Kiarostami#'Festival de Cannes#Brian De Palm#]#Youtube
0 notes
Photo

Ce motif vous parle ? C’est normal, on le retrouve sur les fameux bandanas. Les motifs paisley, également appelés motifs cachemire, sont des motifs iraniens fabriqués à partir de tissu de Perse. Son nom vient de la ville écossaise de Paisley. Le paisley est identifié au style psychédélique au milieu et à la fin des années 1960. L'influence du groupe britannique The Beatles est particulièrement importante !
2 notes
·
View notes
Text
Notre Histoire au jour le jour - ( III ) : retour aux ''fondamentaux'' (suite & fin).
Pour la (n + unième) fois, je vais rappeler le ''credo'' qui sous-tend la démarche de ce Blog : ''seul un vrai retour aux fondamentaux du christianisme en Occident peut encore sauver la planète, via le sauvetage de notre civilisation'', car personne, jamais, n'est arrivé à proposer une alternative heureuse (on dit ''un nouveau paradigme'') à ce mouvement des esprits qui a transformé le monde dans un sens qui fut si longtemps le meilleur possible... jusqu'à sa dissolution récente dans un corpus d'idées mortifères qui ne sont que mensonges et solutions à rien du tout.
Le danger est immense, absolu. Et pourtant beaucoup, en lisant cet appel au secours à civilisation en danger, vont éprouver la tentation de regarder ailleurs, vers une de ces pseudo-évidences dont l'apparente rationalité, répétée ad nauseam, détruit tout ce qu'elle effleure (comme si redire dans cesse le même mensonge pouvait en faire une vérité !), alors que le plus inquiétant, c’est ce ''silence des pantoufles'' dont Martin Niemöller disait qu'il est ''plus dangereux que le bruit des bottes'', reprenant une idée de Einstein : ''Le monde est dangereux non pas tant à cause de ceux qui font le mal, qu’à cause de ceux qui regardent et laissent faire''.
Comme beaucoup, je ne vis pas bien les reculades de notre civilisation devant la barbarie ou devant d'autres civilisations, dont l'islam que des ''leaders'' qui ne méritent pas notre confiance décrivent comme en position de s'imposer à nous, ce qui est faux : il est en piteux état, sans doute plus que nous. En outre, les mesures prises récemment ''sans moufeter'' devant la montée du coronavirus m'ont attristé : nos ''Monsignori'' auraient pu livrer un ''baroud d'honneur'' avant de mettre (par prudence) Dieu sous la coupe de César... et du stérilisant ''principe de précaution''.
Dans le long processus de déchristianisation de l'Europe (seul continent à se suicider ainsi : les autres n'ont pas le même besoin masochiste de se renier et de se couper de tout ce qui peut encore les sauver), Il paraît qu’il n’y aurait plus que 2 % de catholiques résiduels qui vont à la messe, A la décharge, des autres, il faut reconnaître que l'église catholique (je parle de ce que je connais bien. Mais les églises réformées ne font guère mieux. Seuls les orthodoxes restent... dans l'ortho-doxa, la bonne règle !) se donne bien du mal pour ressembler à une soupe indigeste sans beauté, sans profondeur et sans la raison d'être de ce catholicisme dont les restes culturels s'effilochent l'un après l'autre : les prénoms ne sont plus ''ceux du calendrier'', les mariages se transforment en ''pacs'' ou en dérives extravagantes, Noël est ridiculisé : une orgie, les''fêtes de fin d'année''... et les journalistes, déculturés à en être décérébrés, mettent religions, confessions, sagesses et cultes dans un ''fourre-tout'' pour attardés mentaux... Sauf l'Islam...
Les valeurs typiquement chrétiennes (l'amour du prochain, l'espérance du salut selon ses actes, l'importance du remords et du pardon, le partage des pouvoirs entre Dieu et César (source exclusive de cette ''séparation'' dont la République est si fière), étaient si bonnes pour l'humanité que tout le monde les a copiées sans le reconnaître, en changeant simplement l'ordre et quelques mots. Ce serait déjà triste, mais... vu de l'intérieur de l'Eglise, le bilan n'est guère meilleur : deux mille ans d'églises romanes, de cathédrales flamboyantes, de merveilles baroques, de primitifs flamands, de Raphaël, de Bernin, de Michel-Ange... pour aboutir à ces offices sans relief, où le célébrant crachouille dans des micros mal réglés des textes barbants et stéréotypés, sur des autels qui ressemblent à des tables Ikéa, avec des crèches en papier-crépon remplies de personnages émaciés qui font peur, devant des fidèles munis de ''feuilles paroissiales'' ronéotées et illustrées (?) dans le style pseudo-enfantin d'une ''Anaïs-Duchmin-qui-dessine-si-bien''...
Et s'il n'y avait que ça ! Mais il y a les musiques, hélas ! Dans un désir inexplicable de minimalisme misérabiliste, on a remplacé par une guitare Monteverdi, Mozart ou Bach, nos belles chorales et nos grandes orgues (''rien n'est trop beau pour le service de Dieu'', disait-on...), tandis qu'une brave dadame à la voix approximative et trop métallique bat mal et mollement une mesure dont personne n'a besoin, en accélérant à certains mots (''Alléluia'' en est un : pour montrer l'allégresse, on en remet un coup : ''alélou, allélou, allélouia'' (sic !). Ces cantilènes improbables, à la musicalité douteuse et aux rimes approximatives, me rendent souvent très triste (une exception : dans ma grande église paroissiale, une dame fort jolie dont le ''toucher'' pianistique vaut le déplacement vient de temps en temps, trop rarement, éclairer la platitude. (NB : j'essaye de rester honnête : quand c'est bien, on dit ''c'est bien''... Mais quand c'est moche... il faut savoir reconnaître que c'est moche !)
Je ne me permets pas de juger la foi des participants. Cependant, on sait qu'il n'est pas possible de séparer le fond de la forme, et donc la Foi du Rite... Comme nous le répétait mon vieux prof de philo, ''prenez une bouteille de vin, et séparez la forme du fond : il n'y a plus qu'une grosse tache sur le tapis'' ! Il ne se peut pas que, sur le long terme, ces sermons le plus souvent inintéressants n'aient pas un effet pervers sur l'assistance dominicale : il s'agit du même texte, pour toutes les églises, pour tous les publics et tous les âges, en général écrit à Paray-le-Monial par des professionnels du texte au kilomètre. Exception : hier matin (22 mars 2020) dans l'émission ''Le Jour du Seigneur'', un jeune dominicain, le frère Yves Combeau, a été brillant, et cela m'a interpellé : depuis combien de temps n'avais-je pas entendu un vrai sermon, improvisé par un officiant qui jette toute sa foi et tout son cœur dans un acte dont on sort comme transformé par la Grâce ? Comment les églises pourraient-elles être remplies --même en célébrant dans une paroisse sur 4 ou 5 pour regrouper des fidèles qui, malgré cet artifice, vont s'amenuisant ? Comment s'étonner que les enfants s'y ennuient (c'est un grand débat quotidien dans ''La Croix'') ? (NDLR : je ne me souviens pas de m'être ennuyé dans une église, enfant : c’était beau, c’était intéressant, on savait tous les chants, et on avait l'impression de participer à une chose plus grande que nous !).
Dans les grandes vérités éternelles que Vatican II a oubliées, il y a celle-ci : la beauté d'un office tient aussi à son mystère, ''à sa pompe'' et à des rituels (peut-être étranges, mais justement !). Chez les orthodoxes, à la Synagogue, les chants sont profonds et beaux et ne changent pas tout le temps, les ministres du culte suivent des cours de chant, de ''parole'', d'harmonie, de ''microphonie''. Le Muezzin de la grande mosquée d'Istanbul, la Süleymaniye Çamii, est sélectionné sur sa voix. Et là où les catholiques ont abandonné tout usage du latin (devenu synonyme de rébellion ! C'est ridicule !), on est bien obligé de constater que le succès de l'islam tient largement à l'utilisation d'une langue vétéro-arabe incompréhensible des indonésiens, des iraniens, des malais, des bosniaques, de mes amis ''chleuhs'', qui parlent t'Amazight... mais même d’une majorité des arabophones d'aujourd'hui...
En ces temps où l'obscurantisme progressiste tient inexplicablement le haut du pavé en Europe, on constate que ‘‘les Ecritures’’ restent le meilleur moyen de comprendre ce qui se passe ''pour de vrai'' : elles seules intègrent la diversité et la fragilité de l'âme humaine dans la description du ''réel''. Leur (re-) lecture permet de découvrir des rapports insoupçonnés entre les crises économiques, la montée d'un islam guerrier, l'explosion de pandémies incontrôlables ou l'épuisement de la Planète que nous n'avons pas su gérer comme la Genèse nous recommandait de le faire (dès le verset 2 du premier chapitre... Nous en reparlerons). Alors qu'il serait si simple et si facile de ''corriger le tir'', nous tournons le dos à notre futur...
H-Cl.
1 note
·
View note
Text
Les cris de « vengeance » s'élèvent d’Iran
Les cris de « vengeance » s’élèvent d’Iran
Les autorités iraniennes ont menacé les États-Unis, promettant de venger le général Soleimani.
Le général iranien Qasem Soleimani, tué vendredi, à Bagdad, dans une frappe aérienne des États-Unis, devrait être enterré mardi, en Iran, dans sa ville natale de Kerman, à l’issue de trois jours de deuil.
Selon le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), la dépouille du général de la…
View On WordPress
1 note
·
View note
Photo

[AVANT-PREMIÈRE CINÉ] UN HÉROS d’Asghar Farhadi Pour son neuvième film, l’iranien Asghar Farhadi retourne dans son pays natal avec le tendu ‘Un héros’ sous forme de chronique sociale autour d’un protagoniste en plein dilemme moral. Servi par un scénario retors, une prestation exemplaire et une mise en scène au cordeau, le long-métrage a été distingué par le Grand Prix au Festival de Cannes. Un film peut-être un peu trop fidèle à la filmographie du réalisateur, mais qui témoigne également d’une certaine forme d’aboutissement de son art. Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une permission de deux jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le versement d’une partie de la somme. Mais les choses ne se passent pas comme prévu… Comme très souvent chez Asghar Farhadi, le film s’ancre autour d’un événement initial qui va être dûment remis en question, analysé sous différents angles et qui fera ressurgir non seulement des traits caractéristiques de la société iranienne mais également des éléments enfouis dans le passé du/des protagoniste.s. Dans la filmographie du réalisateur, cet événement matriciel a notamment été une rupture (‘Une séparation’, ‘Le Passé’) ou une disparition (‘A propos d’Elly’, ‘Le Client’, ‘Nobody Knows’). C’est à nouveau un événement du registre du fait divers qui est à l'œuvre ici et qui, par une imbrication implacable, lèvera le voile sur un système en forme de machine à broyer l’être humain. Un système pernicieux à tous les niveaux : judiciaire (peine de mort, libération des détenus au bon vouloir de ceux qui ont porté la plainte), carcéral (le masquage des suicides en prison, la maigreur des détenus) ou sociétal (qui demande qu’on se justifie pour tout, qui est terni par la méfiance de l’autre et la mauvaise foi). On pense au sublime ‘Une vie cachée’ (2019) de Terrence Malick qui exposait lui aussi un être humain dont la conviction se heurtait à ce même type de machine infernale, avec une conclusion similaire, aux différences près que chez Asghar Farhadi les motivations des uns et des autres sont plus nuancées (le doute instauré par l’intrigue, les raisons exposées du créancier ne faisant aucunement de lui un méchant manichéen) et surtout que, comme le titre de chacun des deux films l’indique, les deux protagonistes ont des niveaux d’exposition radicalement opposés. Dans ‘Un héros’, Rahim sort de l’anonymat, semble-t-il contre son souhait, du fait des médias. La télévision (contrôlée par le gouvernement) et les réseaux sociaux (contrôlés par les individus) ont pour point commun de ne pas représenter la complexité des situations (que ce soit volontairement ou par manque de temps) et d’avoir une influence considérable sur le principe de “réputation” encore extrêmement prépondérant dans la société iranienne. Ces éléments sont très bien mis en avant par le scénario retors du film. Fidèle à son style, Asghar Farhadi propose une mise en scène discrète dans un souci de réalisme poussé. La captivité du protagoniste, qu’on ne voit presque jamais au sein de la prison mais qui est bien uniquement en “permission” de sortie, est soulignée par le fait qu’il soit souvent filmé dans des endroits clos et derrière des vitres (en voiture, dans la boutique). Le réalisateur iranien utilise à nouveau le registre du thriller pour susciter l’attention du / de la tension chez le spectateur, avec un étau de plus en plus serré sur le protagoniste. Le récit implacable aurait pu étouffer l’émotion, mais il n’en est rien et celle-ci se révèle dans le dernier quart saisissant du film (la scène de l’enregistrement, le plan final glaçant). On pourrait pointer du doigts quelques éléments un peu “faciles” dramatisant le récit (l’enfant bègue, le condamné à mort dont les circonstances peuvent être déterminées par le choix de Rahim). L’acteur Amir Jadidi, peu connu en dehors de l’Iran, est une vraie révélation et aurait pu prétendre au prix d’interprétation à Cannes (qu’a finalement remporté Caleb Landry Jones dans le décevant ‘Nitram’). L’acteur iranien au regard perçant (sur l’affiche on peut d’ailleurs même voir distinctement le caméraman en reflet de son œil !) interprète avec nuance ce protagoniste au sourire omniprésent, tour à tour réconfortant, malicieux jusqu’à en devenir ambigu. Un rôle pas simple d’un personnage faussement naïf. ‘Un héros’ est un thriller très bien maîtrisé avec un engagement politique fort en lien avec la société iranienne et le fonctionnement des institutions à l’ère actuelle marquée par le numérique. Un film implacable qui laisse part à l’émotion sans tomber dans le pathos. On espère néanmoins que le réalisateur iranien se dirigera sur des territoires (qu’ils soient physiques ou thématiques) où on l’attend moins les prochaines fois. Bande-annonce : https://bit.ly/3lBJqaz Date de sortie en salles : Mercredi 15 décembre 2021 A&B
0 notes
Link
Le prêcheur chiite australien, autoproclamé “imam de la paix” sur Twitter (@imamofpeace), est à la pointe du combat contre les extrémistes islamistes et leurs complices gauchistes, qui veulent détruire l'Occident. Il a répondu aux questions de Valeurs actuelles, qui lui consacre aussi un portrait dans son numéro du jeudi 19 juillet.
Quel a été votre parcours personnel, familial et religieux avant d’arriver en Australie ? Je représente la troisième génération d’imams musulmans. De ce fait, j’ai été élevé au sein d’une famille et d’une communauté très conservatrices et religieuses. J’ai fait mes études dans des écoles musulmanes privées, des universités musulmanes chiites et sunnites en Australie, et en 2006, je me suis rendu en Iran pour poursuivre à un niveau supérieur mes études islamiques. J’ai été ordonné publiquement imam en 2010 et suis resté actif depuis. J’apprécie de construire des ponts entre différentes communautés et groupes religieux, et répandre la paix partout où je voyage.
Vous avez qualifié la Palestine de “nation de menteurs et de terroristes” et vous défendez Israël. D’où tenez-vous ces opinions anticonformistes ? Cela n’a rien à voir avec Israël. C’est lié aux droits du peuple juif, et il y a une différence significative entre Israël en tant que pays et le peuple juif en tant que nation religieuse. Je suis une figure religieuse, donc j’étudie les situations avec les lunettes de ma religion et l’histoire des religions abrahamiques. La nation juive (les Israélites) a existé dans la région palestinienne et à Jérusalem avant les musulmans. Je ne peux pas nier le fait que nos califes musulmans ont envahi la région et conquis leur terre. Je crois que le peuple juif a le droit d’exister et d’avoir un pays. De nombreux juifs, dont j'ai défendu les droits, sont opposés à Israël. Cela n’a rien à voir avec Israël et la Palestine mais avec le droit fondamental d’exister.
Des musulmans vous ont surnommé le “faux cheikh” d’Australie. D’autres vous accusent d’avoir des “opinions anti-musulmanes” et même de mener un double jeu. Quelle est votre réaction à ces attaques ? Comment expliquez-vous ces critiques ? Aucun leader de la communauté musulmane ne m’a accusé d’être un imposteur. Ceux qui m’accusent appartiennent au régime iranien ou aux Frères musulmans, qui sont tous les deux considérés comme terroristes par de nombreuses agences gouvernementales. Donc cela ne me gêne pas. J’apprécie les solides relations que j’entretiens avec des centaines d’officiels gouvernementaux à travers le monde, et je suis régulièrement impliqué dans des activités gouvernementales ou parlementaires aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, etc.
Une université, gouvernée par le régime iranien, a publié un communiqué affirmant que je m’étais retiré en 2012. C’est vrai. C’est parce qu’ils voulaient faire de moi un combattant du Hezbollah. J’étais alors déjà ordonné érudit en 2010 avant d’entrer à l’université pour poursuivre mes études. Aussi, lors de mon séjour en Iran, j’ai développé une relation solide avec de hauts officiels gouvernementaux comme Hassan Khomeini. Je ne suis pas responsable de ce dont m’accusent les gens, c’est à eux d’en apporter les preuves. Une enquête a été menée par l’Institut royal australien pour vérifier mes références, et elle a démontré que toutes les rumeurs sur moi sont fausses, même si les médias les ont rapportées. Elles ne reposent sur rien du tout. Toutes les preuves sont sur mon site.
Par ailleurs, je n’ai pas d’opinions anti-musulmanes mais anti-extrémistes. Je défends des frontières plus sûres et moins de mosquées extrémistes. Je pense que c’est rationnel plutôt qu’anti-musulman. Je soutiens aussi les communautés musulmanes pacifiques et visite de nombreuses communautés musulmanes dans le monde.
Craignez-vous pour votre sécurité ? Quelles mesures de protection avez-vous prises ? Avant, j’avais peur. Maintenant, j’ai accepté le fait d’être tué à tout moment. Au cours des années précédentes, j’ai récolté des dons pour renforcer la sécurité autour de ma maison. Cependant, j’ai aujourd’hui une puissante équipe qui assure ma sécurité. Des centaines de personnes font toujours des dons pour financer ma sécurité parce qu’ils croient dans la valeur de mon activisme. Je leur suis très reconnaissant.
Vous avez écrit sur Twitter : “Avant que le terroriste adopte un gilet explosif, il adopte une idéologie explosive.” Pensez-vous que l’islam soit une religion violente ? L’islam est une religion. Toutes les religions peuvent être utilisées de façon violente. Toutefois, le problème avec l’islam est que la majorité de ses fidèles suivent des enseignements violents. Selon moi, des livres sacrés comme le Sahih d’al-Bukhari et les nombreux autres publiés par le Hezbollah et le régime iranien contiennent des enseignements dangereux. Ils sont disponibles dans toutes les mosquées et suivis par la majorité des musulmans. Cela doit changer.
En France, nombreux sont ceux qui demeurent attachés à leurs racines chrétiennes et redoutent l’influence grandissante de l’islam et de ses signes les plus visibles (hidjab, burkini, halal, prières de rues…). Comprenez-vous cette peur existentielle ? Ces signes visibles sont des symboles de pouvoir. Prier dans la rue est inacceptable. Selon la jurisprudence islamique, les musulmans ne peuvent pas prier sur une terre qui n’est pas la leur ou sur laquelle ils ont la permission de prier. Je comprends la peur de la majorité de Français, et je pense que vous avez besoin d’un gouvernement qui comprenne les inquiétudes du peuple. Je travaille à chasser les extrémistes de la communauté musulmane, mais je ne peux pas les chasser du pays. C’est au gouvernement de le faire.
Vous êtes l’une des principales voix qui militent pour réformer votre religion. Quelle est votre vision d’un islam moderne et comment y parvenir ? Je promeus ce qui suit : vivre et laissez vivre, respecter la vie humaine, croire dans vos croyances et permettre aux autres de croire dans leurs croyances, maintenir la paix et l’entente entre tous, et affirmer le concept de coexistence.
Que pensez-vous du concept d’islamophobie ? L’islamophobie n’existe pas. S’il y avait de l’islamophobie, alors nous les musulmans serions islamophobes. Nous avons tué la famille du prophète Mahomet et nous avons fui les pays musulmans pour venir et vivre en Occident. Cela ne ressemble-t-il pas à de l’islamophobie ?
Quelles relations entretenez-vous avec les chrétiens ? J’ai une très forte relation avec de nombreuses communautés chrétiennes. Je vis à côté d’une église et je laisse les fidèles utiliser mon allée pour garer leurs voitures le dimanche. L’archevêque m’embrasse quand il me voit, il m’appelle “mon Fils” et je l’appelle “mon Père”.
Vous défendez le décret anti-immigration et le courage de Donald Trump, et critiquez le progressisme et la naïveté de Justin Trudeau. Vous considérez-vous comme un conservateur ? Oui, je suis un conservateur. La vie m’a fait conservateur. Les membres de ma famille ont été exécutés, brûlés vivants et bannis par les gouvernements islamistes et Daech. Je suis né réfugié de guerre sans aucun papier. J’espère que cela clarifie pourquoi j’ai des convictions fermes sur l’immigration et l’extrémisme islamiste.
Trump a fait des erreurs et il n’est pas un saint, mais il a raison sur les frontières et l’extrémisme islamique. D’un autre côté, je ne crois pas que Trudeau soit qualifié pour être Premier ministre, mais pour être assistant d’un député ou sénateur. Il a ramené au Canada des combattants de l’Etat islamique et a accordé des droits à des terroristes islamiques condamnés. Même l’Arabie saoudite ne fait pas cela. Trudeau est très confus et ses priorités sont désordonnées. Il se soucie plus d’être “gentil” que d’être “juste”.
Pensez-vous que le politiquement correct soit un mal pour la liberté d’expression ? Le politiquement correct ne fait taire que le faible. Il ne peut pas nous faire taire tous et il ne peut pas durer éternellement. L’Occident est constitué de personnes hautement éduquées et conscientes qui admettent les faits. Le politiquement correct peut avoir tué la liberté d’expression dans certaines parties de l’Occident, mais la question est : l’Occident est-il devenu faible, ou les extrémistes islamiques sont-ils devenus plus forts ?
Vous êtes populaire, franc et même drôle sur Twitter. Votre style est d’ailleurs très inhabituel pour un imam. Etes-vous un provocateur ? Je ne suis pas un provocateur. J’utilise le sarcasme et l’humour de temps en temps, parce que j’ai un public en ligne d’environ 300 000 personnes. Tous viennent d’origines, de cultures, de religions et de pays différents. J’ai donc besoin de faire passer mon message à tous. L’humour est une arme pacifique mais létale pour faire honte aux djihadistes. Nous devons les dépouiller de leurs boucliers sacrés et les exposer pour ce qu’ils sont vraiment. La meilleure façon de détruire une communauté corrompue, qui agit au nom de Dieu, est de la ridiculiser. Je suis musulman et je sais comment ma tribu pense.
Etes-vous déjà venu en France ? Lors de l’attentat de Nice, j’ai rencontré l’ambassadeur français en Australie et fait parvenir mes condoléances à la nation française. J’ai également signé une déclaration de paix à remettre au maire de Nice par l’intermédiaire du consulat honoraire français d’Australie du Sud. J’ai même été en France en février dernier. J’aime la France !

3 notes
·
View notes
Text
Désorientale

Titre : Désorientale
Autrice : Négar Djavadi
Autobiographie romancée
Maison d’édition : Editions Liana Levi
Disponible en version numérique, papier et audio - Nombre de pages : 352
Âge conseillé : adulte
Résumé
Si nous étions en Iran, cette salle d'attente d'hôpital ressemblerait à un caravansérail, songe Kimiâ. Un joyeux foutoir où s'enchaînerait bavardages, confidences et anecdotes en cascade. Née à Téhéran, exilée à Paris depuis ses dix ans, Kimiâ a toujours essayé de tenir à distance son pays, sa culture, sa famille. Mais les djinns échappés du passé la rattrapent pour faire défiler l'étourdissant diaporama de l'histoire des Sadr sur trois générations : les tribulations des ancêtres, une décennie de révolution politique, les chemins de traverse de l'adolescence, l'ivresse du rock, le sourire voyou d'une bassiste blonde …
Une fresque flamboyante sur la mémoire et l'identité ; un grand roman sur l'Iran d'hier et la France d'aujourd'hui.
Identités représentées :
Lesbiennes (le personnage principal, sa copine), gay (un personnage secondaire), racisée (toute une famille iranienne, sur des générations, dont une partie, celle de l'héroïne, émigre et immigre en France)
Thématiques présentes :
Homosexualité féminine, identité iranienne et irano-francaise, exil et immigration, amour, homophobie, homoparentalité, révolution iranienne, militantisme, répression politique et dictature, PMA, placard, coming-out, famille, acceptation de soi, crise d'identité, enfance, adolescence, âgé adulte…
L'homosexualité de l'héroïne et son identité irano-francaise, l'histoire de sa famille (ses parents sont des ex dissidents politiques iraniens réfugiés en France, et sur le temps plus long, un de ses oncles d'Iran adore se faire le conteur -à la fiabilité variable- de la riche histoire de la famille) sont tout aussi importantes dans le roman. Donc les deux thématiques sont centrales, ou alors aucune, ça dépend comment on le formule…
TW :
Dictature politique avec ses horreurs : répression, prison, torture (pas décrite très détail/graphiquement je crois, mais évoquée plein de fois quand même car c'est important dans l'histoire), syndrome post traumatique.
Homophobie (elle n'est pas niée mais livre très positif, pas homophobe)
Avis de Camille
En lisant ce livre, on se retrouve plongé.e dans les pensées de la narratrice. On parcourt, de manière chaotique, son histoire et celle de sa famille. Elle montre à voir la construction de son identité à travers un parcours de vie semé d'embuches (répression en Iran, fuite vers la France) mais aussi basée sur des ressources culturelles et familiales riches. On apprend beaucoup sur l'Iran, sur la politique, sur le deuil d'un pays, sur l'acceptation de la mort et puis sur des relations familiales complexes. L'orientation sexuelle de l'héroïne est abordée de manière juste et réaliste. Elle ne prend pas tout l'espace permettant d'entrevoir un personnage tout en complexité mais n'est à aucun moment niée, elle reste au coeur de l'histoire.
Avis de chateauxdesable
Immense coup de coeur. Un tourbillon. Magistral. Merveilleux.
Les mots me manquent. L'histoire est très bien construite, le style… tellement beau, j'en ai recopié des passages dans des carnets et je bois du petit lait rien que de repenser à ce roman et à l'idée de le relire. Vis-à-vis de l'homosexualité c'est très positif sans effacer l'homophobie. J'ai beaucoup aimé l'histoire d'amour de l'héroïne (comme tout ou presque dans ce livre). C'est un premier roman je crois mais on ne dirait pas, l'écrivaine Négar Djavadi semble une conteuse-née. C'est plutôt long, un pavé, mais si bon que ça m'a plutôt semblé trop court, et j'avais eu un vide une fois le bouquin refermé. Je recommande mille fois, attention cependant aux tw.
#coming out#gay#orientation sexuelle#lesbienne#Homosexualité féminine#LGBTphobies#Désorientale#racisé#famille#Négar Djavadi#autobiographie romancée#contemporain#roman adulte#Iran#iranienne#métissage#amour#homophobie#immigration#homoparentalité#Liana Levi#parentalité#PMA#répression politique#dictature#révolution iranienne#identité#prison
19 notes
·
View notes
Photo

2013 : Palais du Golestan. Iran
Le somptueux palais du Golestan est un chef d’œuvre de l’ère kadjare qui illustre l’introduction réussie d’artisanats persans traditionnels et de formes architecturales de périodes antérieures avec des influences occidentales. Le palais ceint de murs, l’un des plus anciens ensembles de Téhéran, fut choisi comme siège du gouvernement par la famille dirigeante kadjare, arrivée au pouvoir en 1779, qui fit de Téhéran la capitale du pays. Construit autour d’un jardin composé de bassins et de zones plantées, il fut doté de ses éléments les plus caractéristiques et de ses ornements au XIXe siècle. Devenu un centre des arts et de l’architecture kadjars dont il est un témoignage unique, il est demeuré jusqu’à aujourd’hui une source d’inspiration pour les artistes et les architectes iraniens. Il incarne un nouveau style combinant les arts et l’artisanat persans traditionnels et des éléments de l’architecture et de la technologie européennes du XVIIIe siècle.
1 note
·
View note
Text
Parisfood Un peu d'histoire 😊 Le Polo Albaloo est un plat Iranien composé à base de riz et de cerises aigres. Le polo est un st...

Un peu d'histoire 😊 Le Polo Albaloo est un plat Iranien composé à base de riz et de cerises aigres. Le polo est un style de riz cuit et Albaloo signifie cerise! 🍽️ A table ☎️ 09 53 10 14 06 📍 92 Rue de la Réunion, 75020 Paris . . . . #parisrestaurant #parisfood #foodie #restaurant #paris #parismonamour #spécialitésiraniennes #iran #saintblaise #topparisresto #foodparis
from #parisfood hashtag on Instagram • Photos and Videos https://ift.tt/34osGca via TAGSPARIS
0 notes
Text

Le Désert des Tartares / Il deserto dei Tartari de Viviane Berty 2018
1/ préambule 3,référence à Dino BUZZATI
A un certain moment, un lourd portail se ferme derrière nous, il se ferme et est verrouillé avec la rapidité de l’éclair, et l’on n’a pas le temps de revenir en arrière.
Le Désert des Tartares (1949) de Dino Buzzati Oh, il est trop tard pour revenir sur ses pas, derrière lui le grondement de la multitude qui le suit, poussée par la même illusion, mais encore invisible sur la route blanche et déserte. Le K de Dino Buzzati Nous sommes ici pour votre perte, pour vous faire damner. Nous sommes les pensées, les idées mauvaises, les tentations, les manies, les peurs, les soupçons. (…) Il est toujours téméraire de juger le cœur des autres. Le Désert des Tartares de Dino Buzzati [extrait] Juste à cette époque, Drogo s’aperçut à quel point les hommes restent toujours séparés l’un de l’autre, malgré l’affection qu’ils peuvent se porter ; il s’aperçut que, si quelqu’un souffre, sa douleur lui appartient en propre, nul ne peut l’en décharger si légèrement que ce soit ; il s’aperçut que, si quelqu’un souffre, autrui ne souffre pas pour cela, même si son amour est grand, et c’est cela qui fait la solitude de la vie.
Cette œuvre (le tableau ci-dessus) vous inspire, intrigue, évoque … ? Je la trouve extraordinaire de simplicité, pureté, à peine plus qu’en 2 dimensions, elle nous projette dans l’univers tellement humain, infini à la fois qu’en temps suspendu du “désert des Tartares”. Si vous ne l’avez pas lu, il est temps. Si vous l’avez lu, retournez y, pour quelque passage, c’est tellement humain, tellement profondément juste.
Au delà du style de Monsieur Dino BUZZATI qui dans mes années de boulimie littéraire m’a offert une approche poétique et surnaturelle de la solitude, il y a ce sens de l’insensé, de l’irrationnelle aberration absurde et parfois extravagante déraison d’être… au delà donc. Jusqu’à aujourd’hui et demain, peut être.
This slideshow requires JavaScript.
2/ Pourquoi en fin de titre “page 3 sur l’infini” ? Parce que.
Je pourrai choisir d’alimenter indéfiniment la liste de bourreaux élus comme cible à éliminer, liste d’esclaves à libérer de leur propre saleté, de leur avidité intrinsèque, de leur peur devenue haine, violence, mépris; meurtriers par procuration, condamnés par contumace, nuisibles.
Cependant que toute bonne chose à une fin ou est infiniment infinie, immesurable , démesurément sempiternelle, il suffira d’une ponctuation, le point final, pour passer à autre chose. Si importants qu’ils en deviennent insignifiants. Car le propre de l’homme en phase à l’univers, à sa terre, c’est d’être intemporel, en extension, insaisissable et perpétuellement renouvelé. Poussière, tu redeviendras poussière. Donc je me renouvelle, plus souvent qu’à mon tour diront les lecteurs cartésiens, car vous l’avez compris, incartésien, mystique un peu, cosmique beaucoup, irrationnel à la folie, je suis. Quoi que je fasse, que tu fasses, que l’humanité fasse, l’univers poursuit son extension entre néant et néant, big bang et big black out, à l’infini ! donc page 3/3 qui aurait pu être 3/300 ou 3/999 999 999 999 999 999 999 999 … à l’infini et au-delà ! s’écria Buzz
__________________________________________
3/ Pour clore temporairement la mission des PISTOLEROS those NON HEROES, petit tableau (très sujet à polémique) et fichier joint (très complet dans la catégorie dirigeant des états)
Liste non exhaustive et contestable qu’incontestablement je délivre:
PDF à télécharge en cliquant ici: la liste est longue alors prenez le temps de faire votre choix, vous organiser, donner du sens, agir avec méthode, être connecté à l’univers … tableau-dirigeants-du-mondeTélécharger
Cidessous, petit tableau spécialement dédié aux croyants de tous bords, très borderline, et à quelques tueurs de masse par commerce interposé
à éliminerpourquoicommentJorge Mario Bergoglio alias Pape Françoisgrand manitou d’une organisation aux mains ensanglantéessur une croix, lapidé, immolé selon que vous soyez catho, musulman ou bouddhiste. Si vous êtes athé vous pouvez lui tirer une balle dans le sexe, là où ils ont généralement pécho. Paix à ton âme.Dr Ahmad al-TayyebGrand Sheykh de l’Azhar, équivalent au pape de l’islamSes coreligionnaires sont adeptes de la lapidation, entre autres raffinements hérités du passé. Alors que celui qui n’a jamais péché ( ou alors juste en eau douce) lui jette la première puis une bonne vingtaine de pierresOttoman, Iranien, Saoudien, ???Autre plus ou moins grand Sheykh al-islam d’Istanbul et d’autres grands pays ou l’islam est très présentTrès souvent imbriqué entre pouvoirs religieux et politiques, ils sont nombreux et souvent bien barrés… Faites votre choixDalaï Lama et autres grands penseurs “méditeurs” pacifiquesParce qu’ils se contentent d’observer et laissent les non initiés s’empêtrer dans leurs aberrationsleur fournir le bidon de white spirit et les allumettes pour l’immolation, ils se débrouillent bien seulsun juif qui vous a insulté d’une manière ou une autre, ignoré tel le goy impie que vous êtesכל ישראל ערבים זה לזה “All Jews are responsible for one another”le circoncire jusqu’au raz des glaouis ou luis découper le crane pour en extraire une kippa d’os et laisser respirer son cerveau d’éluIntégristes de tous bordsParce qu’ils conspuent ou tuent à l’aveugleles rassembler dans une arène avec des ceintures d’explosifs et leur expliquer qu’il faut tirer sur la poignée pour exploser. Si vous faites exploser tous les autres (en déclenchant leur ceinture) et en réchappez, vous gagnez un sursis jusqu’à la prochaine sessionIndustriel de l’alimentationparce qu’ils nous empoisonnent en détruisant la planèteNe me dites pas mais quelle religion, c’est évidemment celle de la consommation sans limite, irresponsable, empoisonnante et empoisonnée. Il suffit de les gaver de leur produits jusqu’à l’implosion. Si vous leur faite ingérer les emballages avec, ça ira plus viteNanard CarettiUne belle enflure qui harcèle les gros et les grosses à la téléLe faire exploser en lui faisant ingérer avec une gaveuse à oies ses produits, entrée plat dessert. La première semaine gratuite suffira.Philipp Morris et le cow boy marlborough, et autres cigarettierscombien de morts?pendus par les pieds et enfumés jusqu’à ce que cancer s’en suive. Si pas de résultat après 20 ans, leur injeccter une overdose de nicotine
This slideshow requires JavaScript.
(C) (R) ™ Oli W.P. alias Olivus l’étoilé
≡ NO HERO PISTOLEROS ≡ 1st ⇔ last ≡ 3/∞ ≡ Le Désert des Tartares / Il deserto dei Tartari de Viviane Berty 2018 1/ préambule 3,référence à Dino BUZZATI…
0 notes
Text
Aux Frontières du Réel
Abbas Kiarostami est décédé le 4 juillet dernier. Réalisateur invétéré, mais aussi scénariste, monteur, photographe et poète, il est considéré par plusieurs comme l’instigateur du nouveau cinéma iranien. Le cinéaste laisse dans le deuil de nombreux metteurs en scène admirateurs de sa virtuosité, mais surtout une nouvelle génération de talents iraniens tels Jafar Panahi, Hossein Shahabi et Ashgar Farhadi. Né à Téhéran, Kiarostami, comme ses collègues, est marqué par la révolution iranienne de 1979. Devant une continuelle menace de censure, il détourne subtilement ses récits pour raconter la société iranienne contemporaine sans en avoir (trop) l’air. Petit retour sur quelques œuvres emblématiques d’une filmographie des plus humanistes.
Dès ses débuts, le thème de l’enfance façonne le cinéma d’Abbas Kiarostami et transforme chacun de ses projets en véritable parabole. Durant les années 1970 et 1980, il développe également un style documentaire qu’il harmonise à ses fictions. Le cinéaste est alors perçu comme le plus légitime héritier de Rossellini, captant la réalité telle qu’elle se présente. Ce n’est pourtant qu’en 1987, avec Où est la maison de mon ami ?, que Kiarostami obtient une certaine reconnaissance. À la fois allégorie de l’amitié et portrait d’une société ancrée dans l’autoritarisme, le film montre le périple d’un garçon qui doit rapporter le cahier d’un camarade de classe subtilisé par erreur.
C’est cependant Closeup, sorti en 1990, qui permet la consécration du cinéaste. Sorte de docufiction où tous les protagonistes ont accepté de jouer leur propre rôle, le long métrage propose de reconstituer l’arrestation, puis le procès d’Ali Sabzian, un homme qui a convaincu une famille qu’il était le réalisateur iranien Mohsen Makhmalbaf dans le but de tourner un film dans leur demeure. En empruntant les codes du cinéma documentaire, mais aussi en manipulant ceux de la fiction, Kiarostami brouille les frontières entre les deux approches pour construire un véritable objet autoréflexif. Non seulement l’Iranien déplace son dispositif pour mieux créer l’illusion du « vrai », il rompt également avec la structure narrative traditionnelle. Grâce à de multiples retours en arrière et aux points de vue auxquels il donne accès (la séquence de l’arrestation filmée à l’intérieur de la maison, par exemple), Closeup se transforme en réflexion sur l’image, sur la fiction, sur la réalité, mais surtout sur le pouvoir du septième art. Si la démarche très conceptuelle du cinéaste peut sembler trop intellectuelle pour certains, le savoir-faire de Kiarostami réside toutefois dans son désir sincère de transporter le spectateur dans ce monde entre vérité et mensonge où le réel surgit de la fiction. Ces questionnements, à la base de l’œuvre entier du cinéaste, se précisent dans ses deux films suivants, Et la vie continue (1992) et Au travers des oliviers (1994), où la mise en abîme devient le moteur ludique d’un rapport poétique au monde.
Puis, en 1997, vient la récompense. Le Goût de la cerise sacralise Kiarostami comme l’un des plus grands en remportant la Palme d’or du Festival de Cannes. Alors qu’il se bat toujours avec les codes de la censure nationale, le cinéaste persiste en offrant le portrait d’un homme défilant à travers les collines à la recherche d’une âme charitable qui pourra l’enterrer après son suicide. Ici, le réalisateur iranien simplifie la mise en scène et opte pour la répétition. Au volant de sa camionnette, monsieur Badii rencontre trois individus : un jeune soldat, un étudiant et un taxidermiste. Les deux premiers refuseront la proposition du protagoniste tandis que le troisième acceptera en tentant de le sensibiliser à la beauté de la vie. Encore une fois, le récit de Kiarostami sert à mettre en image un discours social provocateur. Bien qu’il suscite quelques réactions pour l’aridité de sa mise en scène, sa conclusion ambiguë et son épilogue déroutant, Le Goût de la cerise est certainement le tableau le plus bouleversant de la filmographie du cinéaste.
Deux ans plus tard, Kiarostami récidive avec Le Vent nous emportera, qui montre le voyage d’un journaliste à la campagne pour assister aux derniers jours d’une vieillarde agonisante. Venu filmer la mort, le héros va plutôt s’ouvrir à cette communauté rurale, se faisant fin observateur de leurs mœurs. Encore une fois, le réalisateur utilise le symbole de la route sinueuse — image récurrente dans son œuvre — pour représenter la quête lyrique du protagoniste. À partir de nombreux va-et-vient entre le village et le sommet des collines, où le personnage tente de rejoindre un réseau téléphonique, le réalisateur exprime tantôt l’inefficacité des nouvelles technologies, tantôt la place vertueuse de la nature. Mais c’est le dispositif qui, comme toujours, est au cœur de la réflexion de Kiarostami. En faisant du héros son double et en déplaçant constamment la position de la caméra (qui la manipule et qui examine-t-elle précisément ?), le cinéaste iranien s’interroge à nouveau sur la représentation du réel. Le nouveau millénaire évoque une autre révolution dans le cinéma de Kiarostami : la présence de la femme. Souvent injustement attaqué pour l’absence de personnages féminins, le cinéaste se dévoue explicitement à la condition féminine avec Ten (2002). Le récit se divise en 10 vignettes où le spectateur suit Mania conduisant sa voiture. Elle y rencontre différentes personnes, surtout des femmes. Tourné en numérique, le long métrage est un véritable hommage au féminin. Mères, sœurs, amies et prostituées tiennent tour à tour leur discours. Et Kiarostami, à travers une mise en scène d’une grande simplicité — le champ / contrechamp — examine la quête de liberté de Mania.
Une quête récurrente traverse la carrière du cinéaste, celle de tourner sur sa terre natale, et ce, en dépit des menaces et des dangers constants. Kiarostami finit toutefois par s’exiler avec son cinéma en 2010. Copie conforme transporte le cinéaste, et avec lui le spectateur, en Toscane où deux inconnus, joués par Juliette Binoche et William Shimell, se rencontrent et discutent d’art et de rapports au réel. Puis, à mi-chemin, le récit bascule : ils formeraient en fait un couple depuis une quinzaine d’années. Le dépaysement n’est alors qu’une distraction. L’œuvre est purement kiarostamienne. Plus que jamais, le vrai et le faux s’entremêlent. Simple jeu de couple ou mise en abîme de l’approche scénaristique privilégiée par le cinéaste tout au long de sa carrière ? Avec Kiarostami, la réponse n’est jamais limpide. Dans ce cas-ci, le plaisir se trouve dans la façon dont le cinéaste déploie ses idées et ses mystères, qui lui permettent de poursuivre une fois de plus sa méditation sur le réel au cinéma. Puis, en 2012, dans Like Someone in Love, un long métrage aux allures plus sages tourné à Tokyo, se manifeste un Abbas Kiarostami infatigable. Reprenant son immuable leitmotiv — les personnages en voiture —, le réalisateur crée un étonnant triangle amoureux entre une jeune travailleuse du sexe, son amant jaloux et un client septuagénaire. Par un étrange concours de circonstances, le jeune homme se persuade que le vieil homme est le grand-père de sa copine. Afin d’éviter le drame, celui-ci joue le jeu. Pour une ultime fois, Kiarostami illustre sa fascination pour le mensonge et la vérité en exploitant les faux-semblants des personnages. Mais curieusement, c’est une fable moraliste qui prend forme dans les derniers instants, marquant une nette rupture avec les conclusions plus ambiguës de l’artiste. Un peu comme à l’image de la disparition du maître iranien, cette œuvre testamentaire étonne par son dénouement abrupt, mais expose l’évidence même, la plus certaine du cinéma de Kiarostami : celle d’une déconcertante habileté à exprimer et à raconter les multiples possibilités du médium cinématographique pour mieux laisser surgir une émouvante passion pour le réel.
0 notes
Photo
Les Iraniens sont entourés par 40 bases militaires états-uniennes. Devraient-ils se sentir menacés ? Hmmm, attendez que j’y réfléchisse ...
Si l’Iran installait 40 bases militaires (une seule base) aux frontières des USA, les Amaricains se sentiraient-ils menacés? Mon ami raciste Jonathan (Jeff Fillion en bermudas) en est convaincu.
Car, croit-il, rien de plus dangereux que des femmes et des enfants refugiés de pays (Guatemala, Honduras, Salvador) où les Amaricains ont installé des marionnettes qui imposent les guns, la malbouffe, les pinunes, les pitounes et les gros Ram et les p’tites queues amaricaines à de pauvres illettrés qui ne demandent pas mieux que de se transformer en idiots utiles avec l’espoir de traverser le Rio Grande pour avoir le prestigieux privilège d’arroser la pelouse et de torcher le cul de petits idiots utiles blancs et républicains qui ont des choses bien plus importantes à faire comme trouver le chemin le plus court pour se rendre au walamarde et boysarosse.
(Exercice de style "human interest" que Pierre Falardeau, Pierre Bourgault, Michèle Lalonde, Michel Chartrand, Jean Duceppe et 3-4 millions de québécois sans peur et sans reproches auraient adopté avec cynisme et empressement.)

73 notes
·
View notes
Photo

Un nouvel article a été publié sur http://www.rollingstone.fr/les-10-meilleurs-films-des-annees-1990/
Les 10 meilleurs films des années 1990
Des « Affranchis » à « Pulp Fiction », les meilleures comédies, les meilleurs drames, thrillers et films d’horreur des années 1990
Ah, les années 1990, la décennie qui a vu naître l’avènement du cinéma indie et des blockbusters, les fight clubs et les cannibales charismatiques. Prenez les films qui ont forgé les années 1990, une période étonnamment fertile pour les réalisateurs et pour les cinéphiles, vous pouvez remarquer à quel point le ton a été donné, de la montée des documentaires comme phénomène mainstream aux touches metal qui ont transformé de nombreux films en musées de cire avec du rythme. A cette époque, on côtoyait des junkies écossais, des criminels beaux parleurs et des mecs inoubliables. On connaissait le kung-fu. Wow !
Nous avons rassemblé une équipe de mordus de cinéma, des vautours de la culture, des critiques de la pop-culture et des critiques de tous genres pour lister les 10 meilleurs films des années 1990. Des films ayant remporté un Oscar aux joyaux obscurs-mais-magnifiques en passant par les sagas documentaires et Tarantino, voici les films dont on parle encore aujourd’hui, dont on cite les répliques et que l’on regarde sans jamais s’en lasser.
10. « La Leçon de piano » (1993)
https://www.youtube.com/watch?v=6DnEenWLODI
Holly Hunter joue Ada, une jeune mariée muette du 19e siècle envoyée avec sa fille (Anna Paquin) depuis l’Écosse jusqu’en Nouvelle-Zélande pour vivre avec un mari difficile (Sam Neill). Le piano est sa seule voix, jusqu’à ce qu’un voisin violent (Harvey Keitel) l’acquière en échange de terres. La brute accepte de rendre le piano à Ada contre des leçons qui dissimulent un amour naissant réciproque. Cette romance gothique originale a séduit le Festival de Cannes, faisant de Campion la première femme à remporter la Palme d’Or. Hunter et Paquin ont également remporté les Oscars des Meilleurs Acteurs tandis que Campion a remporté celui du Meilleur Scénario Original. SG
9. « Chungking Express » (1994)
https://youtu.be/Bjd7PFf_TFw?t=6s
Vous n’avez besoin de regarder l’ode de Wong Kar-wai à toutes les personnes seules qu’une fois pour altérer votre conscience. Après ça, vous ne pourrez plus écouter « California Dreamin’ » sans imaginer Faye Wong en train de danser. Cette chanson rock des années 1960 n’est que l’une des nombreuses influences que le réalisateur de Hong Kong importe dans son film fluorescent qui raconte l’histoire d’un amour perdu. Les personnages, un mélange entre le Vieil Hollywood et les archétypes de la New Wave française, boivent de la Mexican Sol Cerveza et fréquentent un restaurant dans lequel de la viande à kebab tourne sur des rôtisseries verticales. Les héros de cette romance chaste sont deux policiers qui luttent pour passer à autre chose après une rupture. L’un s’entiche d’une hors-la-loi affublée d’une perruque blonde tandis que son double est secrètement courtisé par une petite fille espiègle qui se glisse dans son appartement pour faire le ménage. Le style visuel impressionniste de Wong et du directeur de la photographie Christopher Doyle immerge le spectateur dans un paysage onirique de cinéma. JB
8. « Malcolm X » (1992)
https://www.youtube.com/watch?v=sx4sEvhYeVE
Spike Lee espérait que son biopic sur le leader assassiné des Droits Civiques aurait l’effet qu’ont eu des films classiques comme Lawrence d’Arabie ou Gandhi. En fait, il a réalisé quelque chose d’encore plus grand : à la fois un drame historique, une étude convaincante du personnage et un essai politique. Lorsqu’on regarde Malcolm (interprété par Denzel Washington qui signe là l’une de ses meilleures performances) passer du statut d’homme heureux qui aime faire la fête à celui de voyou amateur, de détenu à agitateur, de leader politique à père de famille, on remarque à quel point l’impact des vies qu’il a vécues a transformé sa pensée. Ce n’est pas un portrait historique, c’est un film vivant qui parle tout autant du présent que de l’époque mercurielle de son sujet ou du moment où le film est sorti sur les écrans. BE
7. « Slacker » (1991)
https://www.youtube.com/watch?v=KlmfRuXxuXo
Le London Calling du cinéma des années 1990 est arrivé pile au croisement de deux décennies. L’obsession du temps qu’a Richard Linklater tout au long de sa carrière (ce qu’il nous fait et ce qu’on en fait), commence ici. Offrant une intrigue, des personnages récurrents et des localisations fixes, cette excavation libre de l’excentricité de Lone Star se promène autour d’Austin au Texas et suit les troubadours bavards d’une génération vaincue par Reagan et prête pour le cynisme de l’époque Clinton. C’est une chronique de ce temps qui résume les conspirations et les philosophies nihilistes d’une ville universitaire post-hippie très spécifique tout en se concentrant sur un sens impérissable de liberté précaire. EH
6. « Close-up » (1990)
https://www.youtube.com/watch?v=WS7idiZkOQ0
En ouvrant les yeux du monde occidental sur une compassion sans frontières, Abbas Kiarostami a été la « découverte » du cinéma d’art et d’essai des années 1990 : un humaniste au cœur tendre qui a donné tort aux politiques réductrices du jour. Démarrant la décennie qu’il viendra à dominer, Kiarostami a sorti ce docu-fiction hybride radicalement original, tacheté d’humour furtif et d’une angoisse plus profonde sur les notions empruntées d’identité. A première vue, le film est l’histoire d’un escroc : Hossain Sabzian aime les films et veut être célèbre. D’une certaine façon, mentir à un étranger ne lui pose pas de problème et il lui affirme qu’il est le fameux réalisateur iranien Mohsen Makhmalbaf. Une chose en amène une autre et notre héros bidon envahit la maison d’une famille sous une fausse excuse tout en s’enfonçant encore plus dans un mensonge colossal. Close-Up étend la ruse jusqu’à son dénouement glorieusement compatissant, une touche qui a aidé à pousser le flm jusqu’à un territoire inexploré. JR
5. « Pulp Fiction » (1994)
https://www.youtube.com/watch?v=s7EdQ4FqbhY
Prenez deux tueurs à gage, ajoutez une femme fatale qui se drogue, son mari gangster, un boxeur en fuite, des péquenauds dans un sous-sol et un couple Bonnie and Clyde bas de gamme qui dévalise un restaurant. Mélangez tout ça aux obsessions pop culturelles de leur créateur et vous obtiendrez un classique du cinéma indépendant des années 1990. Aucun autre film de cette décennie n’a eu un impact aussi instantané que cette lettre d’amour de Quentin Tarantino aux films qui ont forgé sa filmographie. Pulp Fiction est un film qui caractérise les années 1990 et dont on peut constamment citer les répliques. On ne pouvait pas éviter les posters accrochés aux murs des dortoirs, les parodies qui surgissent en une nuit ni même la bande originale pleine de rock et de R&B vintage. Construit sur des dialogues, de la violence et de l’amusement, ce film de Tarantino est sa signature. Peu de réalisateurs peuvent affirmer que leur nom de famille soit devenu un adjectif après seulement deux films. On ressent encore aujourd’hui, des années plus tard, les répliques de ce tremblement de terre du septième art. BT
4. « Le Silence des agneaux » (1991)
https://www.youtube.com/watch?v=XtikUtu8loI
Le masque notoire, les papillons de nuit géants, l’œuvre grotesque de non pas un mais deux maniques meurtriers, « J’ai mangé son foie avec des fèves et un bon Chianti »…ça fait vingt ans que le thriller de Jonathan Demme a remporté de nombreux Oscars et terrorisé les cinéphiles et pourtant, aucune de ses images indélébiles ni aucune de ses meilleures répliques ne s’est effacée de la mémoire collective. Le défunt réalisateur et scénariste Ted Tally vous rend immédiatement complice de cette histoire Faustienne entre Clarice Starling (une stagiaire prometteuse du FBI interprétée par Jodie Foster) et le sauvage bon vivant Hannibal Lecter interprété par Anthony Hopkins. Toutes les conversations avec Hannibal Lecter se transforment en un flirt singulier et étrange. (Ce qui ne veut pas dire que le créateur ignore le chauvinisme de l’époque.) Elle déchiffre ses indices énigmatiques tandis qu’il isole son traumatisme et l’éduque comme un parfait psychopathe. On conseille à Clarice de ne pas laisser Hannibal entrer dans sa tête, mais elle le laisse faire…et il ne sortira jamais de la n��tre. PR
3. « Safe » (1995)
https://www.youtube.com/watch?v=63NPIiCl3zo
Le film commence par un camion qui émet des vapeurs, ou peut-être est-ce ce nouveau canapé « complètement toxique » : pour une raison ou pour une autre, Carol White (une femme au foyer de San Fernando Valley brillamment interprétée par Julianne Moore) est malade. Le génie effrayant du chef-d’œuvre proche de l’abstrait de Todd Haynes, c’est qu’on n’arrive jamais à avoir de réponse (un régime de fruits ? Une permanente chimique ?), ce qui nous fait emprunter des chemins sur lesquels peu de films osent nous aventurer. Safe se déroule dans une année 1987 sans âme et semble être une remise en cause de la banlieue américaine : « Où suis-je ? » demande Carol, au bord de l’effondrement mental. Elle réagit probablement à des attentes auxquelles elle ne peut pas répondre. Le film est souvent perçu comme une métaphore du virus du Sida, jamais mentionné, mais ce thriller s’étend bien au-delà de ce diagnostic. De façon provocatrice, Haynes donne au personnage timide l’impulsion pour changer…mais est-ce au prix de sa liberté ? Après avoir vu ce film, vous aurez peur d’à peu près tout. JR
2. « Hoop Dreams » (1994)
https://www.youtube.com/watch?v=-TRIx7oD3lo
Ce film (celui que Roger Ebert appelait « le grand documentaire Américain ») a fait entrer clandestinement le documentaire d’observation dans les multiplexes, a donné naissance à une génération de réalisateurs et a permis à une audience de masse de s’identifier aux défis de la jeunesse, des pauvres et des personnes de couleur aux États-Unis. Filmé pendant six ans et présenté sous un format de trois heures, cette œuvre réalisée par Steve James, Frederick Marx et Peter Gilbert et nominée aux Oscars suit les adolescents William Gates et Arthur Agee, des joueurs de basket-ball du sud de Chicago bourrés de talent, du terrain de basket aux gymnases en évoquant les drames en dehors du terrain et les épreuves qui les attendent chez eux. Même 25 ans plus tard, ses protagonistes ayant dépassé la cinquantaine, Hoop Dreams est encore un film dont on parle car il raconte une histoire encore largement inédite au sein de l’art populaire, une histoire qui prend vie à travers un tas de détails complexes et intimes et qui prend le temps de rendre compte des méandres et des indignités que seule la vraie vie peut offrir. C’est un chef-d’œuvre américain approuvé par le temps. EH
1. « Les Affranchis » (1990)
https://www.youtube.com/watch?v=h3QpxNI-PtE
« Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours voulu être un gangster ». L’adaptation vertigineuse de Martin Scorsese de Wiseguy, un roman sur la mafia écrit par Nicholas Pileggi, est plusieurs choses à la fois : une étude sociale et anthropologique, un aperçu du Rêve Américain, un cauchemar, un retour nostalgique sur une époque précise, un étalage de cinéma virtuose à en donner le tournis, le projet d’une saga sur le crime organisé moderne et un aperçu incomparable du monde dans lequel vous pouvez recevoir une tape dans le dos ou bien être exécuté d’une balle en pleine tête. « Les gens aiment ce film parce qu’il est vrai, a déclaré Pileggi à GQ. Ils disent que c’est comme un film maison ». Lorsque vous regardez Ray Liotta (interprété par Henry Hill) passer du statut d’escroc à celui de témoin sous protection, vous réalisez que vous êtes témoin du reflet d’une vieille réussite américaine avec des costumes italiens et de grosses liasses de billets.
Chaque performance est parfaite, de la sainte trinité composée de Liotta, Robert De Niro et de Joe Pesci (« Mais je suis marrant comment ? Je suis un clown ? Je t’amuse ? ») aux rôles secondaires en arrière-plan. Les références du film vont du Parrain au Vol du grand rapide ; sa bande originale est pleine de chansons de Bobby Darin, de Donovan, des Stones et de Sid Vicious. (Après ce montage, on interdit aux réalisateurs d’utiliser la coda de Layla dans une scène de leur film.) Ses influences sont incalculables et même si Scorsese a fait de très bons films avant celui-ci et en a fait d’autres très bons depuis, Les Affranchis est comme un résumé de son cinéma qui a pour sujet des hommes au bord du précipice, un cinéma spécifique sur un plan culturel et universellement palpitant. Il existe peut-être des films plus emblématiques des années 1990, mais c’est celui-ci qui a donné le ton pour toute la décennie et qui a fait de la plupart des prétendants au trône des vieux schnocks. DF
Par Joshua Rothkopf, Stephen Garrett, Phoebe Reilly, Eric Hynes, Bilge Ebiri, David Fear, Brian Tallerico et Judy Berman / Traduit et adapté par Mélanie Geffroy
#1990#Chungking Express#Close-up#films#Hoop Dreams#La Leçon de piano#Le Silence des Agneaux#Les Affranchis#Malcolm X#Pulp Fiction#Safe#Slacker
2 notes
·
View notes
Text
Grosse flemme sur 2018 : top 15
Pas d’intro, puisque je vous dis que j’ai la flemme !

15. Everybody Knows (Asghar Farhadi)
Le grand maître iranien nous prouve avec ce film qu’il est tout à fait capable de transposer sa maestria du drame familial dans tous les contextes culturels. Amour, mensonges et trahisons, Everybody Knows pourrait être une telenovela grandiloquente si ce n’était cette précision magnifique que l’on connaît à Farhadi. Penelope Cruz est de plus en plus belle à mesure qu’elle vieillit et Javier Bardem n’en finit plus de briller dans tous ses costumes. Enfin, la beauté de la photographie nous réconcilie un peu avec cette hideuse diagonale du vide castillane…

14. Une Pluie Sans Fin (Dong Yue)
Le moins qu’on puisse dire c’est que le titre ne ment pas. Dong Yue nous fait nous sentir presque enrhumés sous sa pluie interminable. L’enquête centrale de ce thriller est presque un prétexte à montrer l’enfer de la Chine industrielle et le contexte particulier de la crise asiatique de 1997. Malgré la faiblesse du personnage féminin qui s’avère n’être rien d‘autre qu’un ressort dramatique, Une Pluie Sans Fin ne démérite jamais dans sa tension et sa cohérence. Certains reconnaîtront Seven dans les courses poursuites ou Heavy Rain dans cette ambiance poisseuse et sombre, mais surtout, cette impression tenace d’en sortir trempé jusqu’aux os.

13. O Grande Cirque Mistico (Carlos Diegues)
Adapté du poème homonyme de Jorge de Lima, O Grande Cirque Mistico nous ramène entre les pages de Cent Ans de Solitude de Garcia Marqués ou encore à la longue Chanson Des Gueux de Mahfouz… Longue fresque familiale dans la grande tradition de la chanson de geste, le film déroule la décadence lente mais irrémédiable d’une dynastie d’artistes de cirque. Marqués par un destin funeste inscrit dans le passage d’une comète, les Monsieur Loyal du conte empruntent autant de noblesse aux Labdacides que de puces et d’escarres aux clochards de Beckett.

12. L’Île Aux Chiens (Wes Anderson)
Manquant, on ne sait par quel coup du sort, l’Oscar du meilleur film d’animation, L’Île Aux Chiens avait tout autant sa place dans les catégories « adultes ». Miracle en stop motion, Wes Anderson ne rogne sur aucun trait de son esthétisme qui pourtant se traduit toujours dans une photographie parfaite. Les décors de carton-pâte n’envient rien aux bains du Grand Hôtel Budapest ni aux soupentes des Tenenbaum. Une petite machine à rêver qu’il faut avoir vu, rassemblant ce pouvoir rassérénant d’Anderson avec un peu de la magie Gondry-ienne en plus…

11. Mektoub, My Love : Canto Uno (Abdellatif Kechiche)
Comme un mauvais amant auprès duquel on retourne toujours sans vraiment savoir pourquoi, Kechiche captive et émeut autant qu’il agace et désespère. Tandis que Mektoub, My Love… peine à dissimuler les obsessions malsaines de son réalisateur pour les fesses bien pleines et les décolletés débordant de vie, il est aussi un indéniable bijou de réalisation. Sa caméra, douée de magie syncrétique, est tout aussi capable de nous faire sentir le soleil des vacances et le sel sur la bouche que l’envie d’embrasser les lèvres maculées de sauce de tomate d’Adèle Exarchopoulos dans La Vie d’Adèle… Mais Kechiche, ici, a au moins l’élégance de se révéler et se dénuder un peu aussi à son tour, nous emmenant dans le sud de ses plus jeunes années.

10. Le Grand Bain (Gilles Lellouche)
Point n’est besoin je crois de ressasser le succès de Lellouche qui a fait cette année un splash fracassant avec son Grand Bain. Alors juste un mot à ce propos. A un Lellouche, vieux beau, fleuron fanfaronnant de la masculinité toxique qui s’est lové dans ce qu’on appelle parfois le « séducteur à la française », celui qui tient la porte et met des mains aux fesses, qui offre de fleurs et trompe sa femme, on avait appris à ne rien laisser passer. Et puis ce film, défaisant avec minutie et délicatesse tous les poncifs sur l’homme dans la fleur de l’âge. Cet homme-là justement, le plus frappé par le suicide, car on a désappris à l’entendre pleurer, c’est lui que Lellouche nous offre. Male tears ? Ou vraies larmes d’hommes qui remplissent à ras-bord cette piscine où on s’entraîne à flotter lorsqu’on n’a plus pied. Un regret cependant, Alban Ivanov et Balsingham Thamilchelvan, si beaux mais tout juste relégués au rang de gags de répétition…

9. Sauvage (Camille Vidal-Nacquet)
Quelques nuits dans les rues de Paris, à dormir avec Félix Maritaud sur les trottoirs, dans les bois, dans les toilettes de bar et les bras désespérés des clients de Léo, 22 ans, homme prostitué à la rue. Contrairement à ses collègues du Bois, il ne cherche pas l’argent facile, qu’il pourrait trouver dans la poche d’un client évanoui ou dans celle d’un sugar daddy aimant. Jeune enfant loup, il trouve sa place dans un trou de terre à même le sol, le goût de son propre sang et les longues nuits de bitumes. Quand il est arraché à la rue pour quelques temps, une nuit, un jour, un répit, il ne retrouve plus son odeur ni celle de sa meute et alors comme un fou la piste jusque dans les recoins les plus sombre de ce métier sordide. Quelques nuits dans les rues de Paris où les prostitué.e.s, les hommes, les femmes, les trans, les migrants, les enfants, monnaient un bout d’eux-mêmes pour un billet froissé.

8. Heureux Comme Lazzaro (Alice Rohrwacher)
Etrange fable que celle racontée par Alice Rohrwacher. On ne sait si elle dit la violence du monde moderne et la nostalgie d’une innocence dorée ou au contraire l’immuable règle qu’est celle de l’oppression des forts sur les faibles. Elle déroule en tous cas un kaléidoscope lyrique à l’image de ces veilleuses d’enfants qui projetaient des formes exagérées aux murs et aux plafonds. La première partie se tourne avec une pureté et une luminosité incroyables, dans l’Italie rurale des années 80 (1980 ou 1880 ?) tandis que la seconde tient presque du reportage tant elle est grise et crue. On en sort séduit et dans un état un peu second, la grande machine du cinéma nous montre, une fois encore, l’implacable roue capitaliste broyant l’immortel ouvrier-poète italien.

7. En Liberté (Pierre Salvadori)
On retrouve ici le dialoguiste de génie, avec un quelque chose du vaudeville Veberien en plus. Salvadori recycle le motif du flic ripoux dans toute sa splendeur, en abusant du cliché avec un Vincent Elbaz qu’on n’avait plus trouvé aussi drôle depuis Dov Mimran. Le récit à tiroir est complètement maîtrisé, de même que les ingérables Pio Marmaï et Adèle Haennel. On a accusé, à raison, le film d’être brouillon et peu soigné dans la photographie. Oui, et alors ? Le rythme est parfait, les acteurs font ce qu’ils font de mieux chacun dans leurs marques sans se marcher dessus (et c’est un exploit). Le tout est arrosé d’une romance un peu malaisante entre Yvonne et Louis mais celle-ci nous sauve d’une fin cochonne où l’héroïne aurait fini avec le voyou enfin repenti. Gag après gag, une comédie à la française, mais dans ce qu’elle avait, jadis, de plus noble.

6. Capharnaüm (Nadine Labaki)
L’Occident est-il à ce point cynique pour acclamer une œuvre qui dévoile place la pauvreté sous une lumière si crue et de l’autre main fermer toutes ses écoutilles à celle qui se presse à ses portes ? Le Liban, déjà rongé par une pauvreté alarmante, une fracture sociale jamais égalée en termes de complexité et un voisinage peu commode, a accueilli près de 1,5M de réfugiés fuyant les zones de conflits alentours. C’est cette société tenant au chatterton que Nadine Labaki montre avec sa délicatesse et son chien accoutumés. Capharnaüm est un véritable coup de poignard en plein cœur porté par un petit casting virtuose. Zain Al Rafeea, tiré des rues de Beyrouth et la magnifique Yordanos Shiferaw se donnent la réplique en égaux et en partenaires. Tout fonctionne si bien. Tout est si beau. Tout nous ramène à notre coupable immobilité.

5. The Charmer (Milad Alami)
Il y a quelque chose du crime de lèse-majesté dans la présence du très jeune Alami aussi haut dans ce classement et surtout si loin devant son éminent patriote et aîné, le très grand Asghar Farhadi. Les deux compères font en tous cas honneur au cinéma iranien, et c’est un peu comme si le facétieux Abbas Kiarostami était toujours avec nous. The Charmer prend les accents glacés du thriller danois en gardant de cette rigueur réaliste caractéristique du cinéma iranien, toujours très proche du drame social mais jamais dans le pathos. On est intrigués, séduits, touchés puis tout simplement soufflés par le personnage d’Esmaïl, troublant amant immigré qui se raccroche aux draps des danoises pour ne pas sombrer. Mais un terrible ressort dramatique se distend soudain et c’est la chute, où Esmaïl nous emporte avec lui.

4. Suspiria (Luca Guadagnino)
Deux entrées en top 5 pour Luca Guadagnino cette année dont Suspiria qui parle à notre âme d’apprentie sorcière comme le démon susurre aux oreilles des vilaines filles. Toujours très amouraché, et à raison, de Tilda Swinton, Guadagnino fait le choix un peu déconcertant de Dakota Johnson en rôle central. On regrette de ne pas pouvoir profiter un peu plus de Chloe Moretz à l’écran mais le film est si beau et viscéral que tous les choix finissent par s’aligner d’eux-mêmes. Les ajouts de Guadagnino par rapport à l’original de Dario Argento sont aussi parfaitement maîtrisés recréant une toute autre dimension symbolique et esthétique.

3. Le Monde est A Toi (Romain Gavras)
Fils de et lascar VIP du collectif Kourtrajme, Romain Gavras impose son style avec Le Monde est à Toi. Moitié hooligan, moitié enfant-roi, Gavras Jr fait des films comme on organise des soirées. Dans une interview en go-fast sur Vice, et dans la vraie lignée des hackers de Kourtrajme, il raconte en complète transparence la recette de la soupe au caillou. La contrainte financière le pousse par exemple à tourner à Benidorm, la ville la plus cheap d’Europe, d’une tour grandiose et hideuse à une autre, passage d’une banlieue parisienne à une station balnéaire sans âme de l’immonde côte espagnole, « Miami en nul ». Et à l’ombre des monstres, Cassel toujours solide, Adjani lunaire, Damiens fidèle à lui-même, le petit Karim Leklou parvient tout de même à se frayer une belle place au soleil. Le film est à la fois sublime et grotesque, baddass et fleur bleue, tirant sur toutes les ambulances, des migrants aux jeunes de banlieue, sans pitié ni cruauté, mais sans jamais rater sa cible.

2. Call me By Your Name (Luca Guadagnino)
Luca Guadagnino a volé mon cœur cette année. Peut-être trop académique parfois, et notamment dans sa photographie et son déroulé narratif, Call Me By Your Name bénéficie tout de même d’une fraîcheur qu’on ne sait à qui attribuer, aux décors piochés dans nos meilleurs souvenirs de vacances ou à la sensualité des deux acteurs principaux… Sauvant Armie Hammer de son destin de beau gosse de blockbuster et révélant le sublime Timothée Chalamet, Call me By Your Name a aussi fait exploser les compteurs touristiques de la petite région du Monte Cremasco (que l’on recommande chaudement). L’envie de faire du vélo dans les rues de Crema, d’acheter un palais à Moscazzano ou de se baigner dans les laghetti qui ponctuent le Fiume Serio… Mais surtout de revivre son plus grand chagrin d’amour et de croquer à nouveau dans le fruit juteux des premières fois…

1. Au Poste ! (Quentin Dupieux)
Comme à chaque fois qu’il reprend son tablier de réalisateur Mr Oizo enflamme le dancefloor du cinéma français. Dans un paysage de la comédie française en plein naufrage, Dupieux est un phare constamment allumé. Au Poste ! est plus drôle que Wrong Cops, plus conceptuel que Rubber et encore plus intelligent que Réalité, c’est ce type de film qui nous fait aimer le cinéma. Avec les caméos complètement délirants de Michel Hazanavicius à Orlesan en passant par Chabat qui boucle une spirale infernale avec Réalité… Dupieux montre qu’il sait s’entourer. Sublimant un Poelvoorde en perte de vitesse et un Ludig complètement inattendu, le film explore les univers personnels de son auteur : le poste de police, le récit enchâssé, le discours rapporté et le langage performatif… Absurde et d’une intelligibilité extrême tout à la fois, on retrouve bien notre réal-DJ préféré. Dans une ambiance toujours feutrée et à la gamme chromatique soignée, Quentin Dupieux confirme qu’il est vraiment le Lynch de l’humour.
Et comme la dernière fois : le classement complet.
1 note
·
View note
Text
Smyrneiko Minore de Maríka Papagíka
Smyrneiko Minore (ou «An S' Agapo Ki Ein' Oneiro»), 1919 Un rebétiko interprété par Maríka Papagíka (Μαρίκα Παπαγκίκα, en grec)
[ https://www.youtube.com/watch?v=PtJRl7_cVlY ]
Le rebétiko (ρεμπέτικο en grec) est une forme de musique populaire grecque apparue dans les années 1920, à la suite des vagues migratoires des populations, principalement grecques, expulsées d'Asie mineure.
En 1912-1913, les guerres balkaniques permettent à la Grèce d'incorporer plusieurs anciens territoires de l'Empire ottoman, notamment la Macédoine, au nord-est du pays. En 1923, le Traité de Lausanne met fin au conflit qui opposait Athènes à Istanbul depuis 1919 et somme l'échange de population entre les deux voisins : un million d'Orthodoxes sont forcés de rejoindre la Grèce et plus de 400 000 Musulmans font le chemin inverse. Un épisode connu sous le nom de «Grande Catastrophe» par les Grecs[1]. Avant de devenir l'emblème du folklore grec, le rebétiko a longtemps été méprisé et même un temps, interdit par les autorités. Ce genre musical qui fait le pont entre l'Orient et l'Occident s'est façonné pendant l'entre-deux-guerres dans les quartiers déshérités des grandes villes de Grèce, là où se massaient les réfugiés d'Asie mineure et les ruraux en quête d'une vie meilleure[2].
Le rebétiko chante principalement l’amour ou des comportements défiant la loi (consommation de drogues etc.) et il est en réalité constitué d’une multitude de formes musicales différentes, en passant par les rebétika d'Istanbul du début du 20e siècle aux chansons «laïkó» de Vassilis Tsitsanis dans les années 1950[3]. Musiques rhizomatiques, empruntant à l'héritage musical d'Istanbul et de Smyrne, des îles grecques et des musiques continentales, puis s'alimentant tout à la fois des musiques indiennes et latino-américaines, les rebétika ont connu un développement foisonnant tout au long du 20e siècle[4].
Deux courants principaux sont généralement distingués, soit le «style de Smyrne» (Smyrnéiko), et le « style du Pirée » (Pireotiko). Ce qui est appelé «style de Smyrne» est lié aux musiciens micrasiates, des réfugiés d'Asie mineure. Ce style se distingue par une plus grande diversité d'instrumentation (oud, violon, santouri ou kanonaki, etc.), la virtuosité des musiciens et des voix haut perchées. Prédominant dans les années 1920 et le début des années 1930, il s'est progressivement effacé au profit du style pireotiko[5].
Izmir, traditionnellement Smyrne (en turc İzmir; en grec moderne : Σμύρνη, Smýrni), est le deuxième port de Turquie (après Istanbul), et la troisième agglomération du pays par le nombre d’habitants). Elle est située sur la mer Égée, près du golfe d'Izmir. Ses habitants sont les Smyrniotes[6].
[1] COHEN, Elèni (2008), Rebétiko, un chant grec, Saint-Cyr-sur-Loire, Éditions Christian Pirot
[2] LEBOUKAS, Vassili (1991), « La thématique du rebétiko : un récit politique au carrefour de deux cultures » dans CEMOTI, Cahiers d'Études sur la Méditerranée Orientale et le monde Turco-Iranien, n°11, p. 41
[3] Ibid,
[4] Ibid, p.42
[5] Ibid
[6] COHEN, Elèni (2008), Rebétiko, un chant grec, Saint-Cyr-sur-Loire, Éditions Christian Pirot
0 notes