#BenjaminDuronflan
Explore tagged Tumblr posts
Text
Les Aventures de Benjamin Duronflan, chapitre 20 - Un lit à Madurai
Elle avait raison, ils arrivèrent sans encombre à Madurai, les contrôles avaient été sommaires, malgré des sueurs froides lorsqu’un policier, à la fouille, avait renversé méticuleusement l’intégralité du porte-feuille de Benjamin.
Un taxi les attend, ils grimpent en silence. Le trajet est loin, la nuit tombe, ils distinguent qu’ils quittent la ville pour la périphérie, et soudain, au milieu d’un terrain vague et sec, se tient leur hôtel. Un hôtel de standing avec des portiers, du marbre, une piscine, un room service. Silencieusement, ils font ce qu’ils ont à faire. Leur chambre est immense, c’est une véritable suite avec plusieurs pièces et deux salles de bains. Finalement, Benjamin qui n’en peut plus, brise le silence.
« -Mais, qu’est-ce que… qu’est-ce que tu as fait ? - Hum… je pensais pas vraiment que cela serait comme ça, répond-elle perplexe. C’est la première fois qu’une expression apparaît sur son visage depuis plusieurs heures. - Enfin, bon, c’est très très bien, on va pas se plaindre du confort. - Oui, enfin, c’est un peu ridicule quand même, ça pète un peu plus haut que son cul je trouve. - C’est vrai qu’il y a des traces d’humidité sur les peintures. - Et puis, c’est pas très bien meublé. - Il y a un bar à thème en bas. - C’est quoi le thème ? - Western. Ça te tente ? - Bof, tu sais, les westerns, ça vient de chez moi. - Ah oui, j’avais oublié. Tu parles bien français d’ailleurs, c’est marrant, c’est la première fois que je le remarque. J’avais toujours pris ça pour acquis en fait. - On va se promener ? »
Se promener, ça voulait dire aller voir le « bar », le hall d’entrée et la piscine. Ils firent aussi le tour de l’hôtel à travers les friches qui l’entouraient. En rentrant, ils commencèrent à discuter avec un homme, grand, brun, « la cinquantaine » avait dit l’Américaine. Sa femme était dans leur chambre, « elle dessine » il dit. Benjamin remarque qu’il lit le Monde Diplo, « ah, c’est le Diplo ». « Vous connaissez ? ». Un peu. Ils sont venus voir leur fils, qui voyage depuis longtemps. « Nous aussi, on voyage depuis longtemps » remarque l’Américaine. Il leur explique qu’il n’a pas trop compris comment ils étaient arrivés ici, ils devaient être plus proches du centre dans quelque chose d’un peu plus modeste, explique-t-il en levant les yeux au lustre qui pendouille au plafond. Mais, on comprend pas grand-chose à ce qu’ils racontent dans ce pays, quand même un accent… alors, il a pas osé dire non, et… « bah, voilà, on est là. Forcément, on est un peu déçu, enfin on va pas se laisser abattre. C’est pas grave ». Benjamin dit que c’est un peu pareil pour eux, qu’ils ne pensaient pas que cela serait comme ça. Il raconte un peu son voyage, il explique en riant qu’avec l’Américaine, il et elle s’étaient rencontrés une première fois à Bénarès, puis s’étaient retrouvés par hasard à Jaisalmer. « Ah ! Mon fils aussi est allé à Jaisalmer, il a fait du chameaux ! ». C’est marrant, comme Benjamin, son fils veut devenir instit’… L’homme explique, sa chemise à carreaux entrouverte, que tous les gens qu’il connaît sont tombés malades en Inde. « Ah oui, c’est une lutte permanente pour rester en bonne santé » acquiesce Benjamin. Alors, lui, il a décidé qu’il ne tomberait pas malade : « c’est un peu mon défi, quoi. » Alors, il ne prend qu’un repas par jour, et toujours dans un endroit « où les assiettes, les couverts, sont propres, vous voyez ». « C’est pas un peu radical quand même? » demande l’Américaine. « C’est toi la gauchiste qui parle de radicalité » lui réplique Duronflan en riant. « Écoutez, vous savez j’ai pas beaucoup de vacances, j’ai envie d’en profiter alors… gauchiste ? ». « Oui, je me définis comme appartenant à la gauche critique ». « Mon fils aussi, il est engagé comme ça, dans les luttes il dit, le syndicalisme... ». Là, Benjamin est certain, son fils, il l’a croisé à sur la route de Jaisalmer, et il a fait du dromadaire avec lui. C’était au moment où il avait été ruiné par son séjour à l’hôpital, et finalement, à son fils, il lui avait taxé pas mal d’argent. « Il va voter Poutou, alors ! ». « Faudrait qu’il trouve ses cinq cents signatures ». « Il arrive quand ? ». « Il ne devrait pas trop tarder. » répond l’homme en regardant l’heure sur son téléphone. « On va vous laisser alors ».
Lorsqu’ils furent revenus dans leur chambre et qu’ils profitaient de la fraîcheur de la climatisation, nus sur le lit, immense, Benjamin déclara : « - Il faut qu’on parte d’ici dès demain. - Non, après-demain, on a rien visiter, elle répondit. - Je croyais qu’on était en cavale. - Oui, je vois pas pourquoi ça nous empêche de visiter. - C’est vrai, admit-il. Par contre, j’ai une condition. Elle se retourna vers lui, elle le voyait loin loin au bout du lit, ses bras étendus le long de la peau blanche de son ventre et ses hanches. Quand elle vit les marques de bronzage de son ami, elle releva sa tête pour tenter de voir son décolleté et ses épaules. Oui, c’était pareil, en un peu plus claire. - C’est presque trop grand ce lit, elle dit tout en se rapprochant. Ils sont ensemble, leurs courbes tendres vont bien ensemble, le tableau est doux. - Tu as une taille presque féminine, elle dit encore. - Toi, aussi, il répond, mais… tu ne m’as pas demandé ma condition. C’est pas très important, mais je voulais t’en parler. Elle ne lui répond pas, elle compare leurs genoux respectifs. Ceux du jeune homme sont dures et anguleux, ils articulent ses longues jambes, alors que les siens sont ronds. Ce ne sont pas des os qu’ils relient, ses jambes sont comme de la porcelaine ou plutôt, comme de la pâte d’amande. - Je veux qu’on ne parle plus ni à cet homme, ni à son fils, faut les éviter, tu comprends. Demain, on les évite. Elle compare leurs pieds, les siens semblent minuscules à côté. - Comment on dit en français déjà… panards ? De grands panards ? Il ne répond pas, il se dit qu’elle ne l’écoute pas, qu’elle ne l’écoute jamais. L’Américaine le sent, elle se rapproche encore un peu, suffisamment pour qu’il sente sa peau froide d’air conditionné près de lui. - Pardon. Les éviter… Benjamin, ça va pas ? - Je… tu te rappelles, quand on s’est retrouvé, je faisais, enfin, j’avais des activités peu… peu morales quoi, commence-t-il à expliquer. L’Américaine se souvient le drama qu’il avait fait à l’époque, cette scène de repentance quasi-mystique. En se souvenant du ridicule de la scène, elle se demande presque pourquoi elle l’avait alors suivi. Cela sembie si dérisoire par rapport à ce qu’ils avaient fait, tous les deux, à Varanasi. - Oui ? - Leur fils. - Ben, abrège, dit-elle autoritaire, je suis certaine que tu me fais peur pour rien. - Bah, je lui ai… on va dire que je lui ai coûté pas mal d’argent et que ça me met un peu mal à l’aise. - Tu as peur qu’il te le demande, parce que tu sais, moi je suis une fugitive alors un coup de schlass et c’est réglé, elle lui dit les yeux dans les yeux. - Mais… mais… bredouille son ami épouvanté, mais… tu… tu connais le mot « schlass » ? - Faut croire. Suffit d'un geste, d'un mot pour qu'la gazeuse te douche, chante-t-elle tout en mimant une mitraillette avec son avant-bras que le soleil a rendu légèrement cuivré, pour qu'la rafleuse te touche ! Bam bam bam bam bam bam ! »
Duronflan se recroqueville dans un coin du lit, il la regarde, elle qui est nue, debout devant lui le menaçant d’un FAMAS imaginaire. Il ne comprend pas, et la regarde sauter sur leur lit. Elle parle du public et du cheval de Troie ou de quelque chose comme ça. Elle rebondit près de lui, essoufflée, demain, ils doivent aller visiter un temple très connu.
Le lit était tellement grand qu’il autorisait toutes les fantaisies pour dormir, ils en profitèrent, dormant dans les positions les plus improbables. Pendant la nuit, Benjamin qui avait froid à cause de l’air conditionné se blottit contre sa compagne qui lui renvoya un coup de poing sur la face. Il cria, il et elle se disputèrent à moitié endormis, avant que l’Américaine n’ait la bonne idée de baisser la climatisation. Benjamin voulut continuer à geindre contre le coup de poing, mais fut arrêté par un « tu sais, je suis une fugitive, je suis prête à tout ». Elle se rendormit rapidement, tandis que l’imagination de Benjamin quant à elle, allait bon train. Après tout, il ne la connaissait pas tant que ça, et elle parlait peu de sa vie avant. Peut-être qu’elle était déjà en cavale, que depuis qu’ils voyageaient ensemble, il l’aidait à fuir les autorités de son pays. Il pensa d’abord aux « black blocs », « je suis de la gauche critique » elle disait. Oui, elle disait ça. II la regardait dormir, ses joues rondes et roses. Lèvres fines, mèches blondes si claires. Son bourrelet léger et pâle sur les hanches comme pour mieux souligner les lignes pures de ses jambes. Elle, peut-être qu’elle avait jeté des cocktails Molotov, blessé des policiers. Ou peut-être pire. Une poseuse de bombe, ou alors elle a tiré dans les genoux des patrons. « Pour que la raffleuse te touche » répéta-t-il encore avec la chair de poule. Ils ont trouvé son ADN sur quelque chose, ou alors, ils avaient une vidéo. Et elle a dû partir. Il crevait d’envie de la réveiller pour lui demander, mais craignait un autre coup de poing. Il rêva toute la nuit qu’ils braquaient des banques, puis il la vit à son procès. Elle disait « Oui, je suis une révolutionnaire professionnelle, je suis une anarchiste et le seul jugement que j’accepterai sera celui de mes sœurs de lutte ». Il la voyait avec sa combinaison orange, dans un parloir avec d’autres couples - sans avoir l’autorisation de se toucher.
Quand le lendemain, derrière un large pilier du temple de Madurai, il lui demanda : « tu étais déjà en fuite avant de me rencontrer ? », elle lui répondit « on fuit tous un peu quelque chose, non ? ». Une énième fois, il la regarda consterné. Elle marchait à travers le vieil et immense édifice d’un pas assuré. « C’est quand même beaucoup plus facile d’être une femme ici que dans le nord de l’Inde » lui fit-elle remarquer. Ils jouaient à reconnaître les dieux, ce qui n’étaient pas si évident parce que l’iconographie n’était pas totalement la même ici qu’en Uttar Pradesh ou au Rajasthan. Il y avait par exemple, ces statuts de Shiva comme « danseur cosmique ». Le dieu qu’il avait l’habitude de voir plein de muscles et des haschichs, couvert de sa peau de bête, était là tout gracile, que souplesse et élégance. Duronflan déclara que cet endroit l’oppressait un peu : l’obscurité, les colonnes, les pierres massives. Ils sortirent ; de dehors, on pouvait observer les toits. Ils étaient composés d’un enchevêtrement de multiples statuettes de dieux, déesses, animaux, êtres humains, très colorées. L’ensemble était à la fois kitsch et impressionnant. Il lui demanda où ils allaient le lendemain, elle lui répondit « Munnar, Kerala ». « Munnar », ça lui faisait un peu penser à un personnage d’Harry Potter mais il ne se rappelait plus bien lequel. « C’est au bord de la mer ? ». « Non, à la montagne ». « Ah ».
Lorsqu’ils rentrèrent à leur hôtel, ils aperçurent dans le restaurant la petite famille réunie, le père devait avaler son unique repas de la journée, et le fils… le fils était bien le jeune homme à qui Benjamin avait extorqué un voyage en bus et un safari en dromadaire. Ils regagnèrent leur chambre avant d’être aperçu. Cette nuit-là, ils réglèrent correctement la climatisation avant de se coucher. Ils purent ainsi dormir nus sans avoir trop froid et dormir l’un près de l’autre sans avoir trop chaud. C’était parfait. Benjamin lui souffla à l’oreille un « tu règles bien les climatisations, tu sais ? ». Elle lui dit que s’il essayait de donner une connotation érotique à sa phrase, c’était ridicule, mais que si c’était juste un constat, c’était mignon. Il dit que, bien entendu, ce n’était qu’un constat et elle revint se pendre à son épaule.
1 note
·
View note
Text
Les Aventures de Benjamin Duronflan, chapitre 16 : From Here To Eternity / Street art
Minuit, Manikarnika ghat. Un homme s’affaire contre le mur de la plate-forme des brahmanes. Il peint. La lumière des lampadaires ne le touche pas ; il profite de l’épaisseur de l’obscurité et de la brume. La musique directement dans ses oreilles rythme son bras qui se balance avec des mouvements vifs, parfois il prend du recul et hoche la tête un air satisfait. Autour, il y a les témoins de ce qui est en train de se passer, tous restent silencieux. Ils observent ce grand homme aux yeux bridés, les cheveux longs et noirs ramassés dans un chignon sur le haut de son crâne, un tikka noir sur le front. Le mur quant à lui se recouvre de traits de couleurs vives, une noueuse composition psychédélique s’étale sur le mur tandis que moins d’un mètre au-dessus, le corps d’un membre d’une haute caste brûle lentement.
Benjamin et l’Américaine s’étaient levés de bon matin ce jour-là. Après ce qu’ils avaient pris l’habitude d’appeler sa « crise », Benjamin était resté pendant une semaine dans un état de faiblesse relative. Il s’était réellement épuisé dans sa « crise », mais cette faiblesse semblait aussi une manière pour Benjamin de se protéger, un bon prétexte pour rester enfermé : il avait eu peur et , malgré l’intensité des sentiments qu’il avait pu vivre et le sursaut existentiel que cela lui avait procuré, il voulait mettre à distance le spectre de la folie et de la mort, et la manière qu’il trouva dans un premier temps d’exorciser cela fut de mettre à distance la ville elle-même, bien qu’il y résida. Au bout d’une semaine cependant, il retrouva sa curiosité habituelle, celle pour laquelle nous l’aimons. Il organisa leur déménagement de Bengali Tola (où ils étaient retournés après la « crise ») à Manikarnika ghat pour « prendre un nouveau départ ». Ainsi, ils s’étaient levés tôt ce matin où il et elle avaient découvert avec stupéfaction le graffiti coloré sur le mur de la plate-forme de crémation des brahmanes.
« - Oh, putain nique sa m…, murmura l’Américaine. - Bougre, il y en a un qui s’est fait plaisir, commenta son partenaire. - Mais mec, comment c’est possible ? - C’est quand même marrant… - Inimaginable. - Pardon ? - J’ai dit, inimaginable. Impossible. - Ah. - …. - De quoi parles-tu ? - Regarde ! - Oui, oui, il y a un tag. - Enfin, Ben ! C’est pas n’importe quelle… enfin, je veux dire, on est à Manikarnika ghat, goddam ! - Everything is possible, twenty-four hour, répondit Benjamin en riant. Ce dernier ne semblait pas se rendre compte de la lourdeur de l’acte dont ils étaient en train d’observer le résultat. Il prenait cela avec un air amusé qui scandalisait un peu l’Américaine. - Tu ne trouves pas ça beau ? lui demanda-t-il. - C’est pas la question. Mais… Qui est le fils de pute qui a bien pu faire cela ? - Euh, je pense que tu ne devrais pas parler comme ça, lui fit-il remarquer. Le français vulgaire de l’Américaine le mettait souvent mal à l’aise, il trouvait que cela était comme comme une fiente de pigeon sur une fresque de Raphaël, une faute de goût flagrante dans sa manière d’incarner sa féminité. - Sorry, dude. - C’est quand même oser de poser son graff’ là, sur un des endroits les plus sacrés du monde, déclara Benjamin. On pouvait sentir qu’il avait fait un effort pour éprouver cette réflexion. L’Américaine le regarda encore une fois, un œil tout étonné, l’autre sur le point de sombrer dans le désespoir. - Oui, c’est ce que j’essayais de te dire… - Je me demande ce que les gens peuvent bien penser de tout cela, continua-t-il avec un air méditatif.
La fresque était principalement composée de traits colorés formant un ensemble psychédélique et acidulé. Lorsqu’on l’observait longtemps, on pouvait voir émerger comme un « motif dans le tapis » (Benjamin détestait cette expression mais bon…) l’inscription « From Here To Eternity » (même si on distinguait mal le « y » de « eternity »). Le couple était fier de leur découverte et continuèrent donc à faire parler cet audacieux graffiti. Dans le coin gauche, étaient dessinés plusieurs grosses têtes de mort dans un style un peu enfantin, et aussi un délicat portrait de sadhu avec une technique impressionniste. L’Américaine dit avec un ton docte que c’était une pièce de street art quelconque comme on pouvait en trouver aux quatre coins de la planète. Benjamin défendait l’œuvre avec entrain quand ils découvrirent qu’elle était probablement signé. « Guido Cipolla : Mr Onion »¨était inscrit dans la partie haute. Dans le silence que provoquait la découverte de la probable identité du « vandale » (l’Américaine) ou de l’ « artiste » (Benjamin), un jeune homme comme il en existe beaucoup à Manikarnika vint leur proposer une explication des rîtes funéraires. Benjamin coupa rapidement court à ces explications qu’il connaissait déjà par cœur et posa frontalement la question du graffiti. Ce dernier semblait laisser complètement indifférent leur interlocuteur, contrairement toutefois au peintre qu’il connaissait bien. Selon ses dires, l’artiste était un « gars allemand » qui venait souvent ici et qui maintenant habitait près de Lalit Ghat, oui, il était venu de nombreuses fois ici et surtout, il consommait beaucoup de drogues, il en achetait à un ami à lui. De la marijuana mais aussi… il se boucha une narine et respira de l’autre, le nez collé à sa main droite. Cocaïne.
« - Tu vois, c’est quelqu’un qui connaissait le coin, il est pas arrivé comme ça un matin… dit Benjamin à son amie, satisfait. - A bloody junkie ! s’exclama-t-elle avant de traduire.Un putain de camé. - Je comprends l’anglais tu sais. - Ah oui ? »
Benjamin qui se sentait vexé se décida à mener l’enquête, il entendait bien prouver, pour une fois, sa supériorité en matière de compréhension du pays dans lequel ils voyageaient. On verra bien. Il se lança donc dans un important travail de recherche avec une connexion internet vacillante, mais son ambition d’en savoir plus sur la fresque furent rapidement déçues. Après avoir activé tous les réseaux interdiscursifs de la fresque, le sens de cette dernière lui restait toujours opaque.
« - Au rapport colonel, s’adressa-t-il à l’Américaine. - Oui ? - Alors, j’ai fait mes recherches. D’abord l’auteur : Guido Cipolla. Déjà cipolla, ça veut dire oignon en italien, d’où le Mister Onion… et « Guido », alors soit c’est juste un prénom. Soit c’est un mot d’argot new-yorkais pour désigner les italiens, et notamment la figure de l’italien macho. Ou ça peut aussi être le verbe « conduire » à la première personne du singulier, mais je pense pas que ça soit ça… - Intéressant dis-moi, souffla-t-elle dans un demi-sourire. - Oui, oui ! Et… alors… sur Facebook, j’en ai trouvé vingt-six des « Guido Cipolla » mais aucun qui fait l’affaire. Par contre, et là plus intéressant, j’ai trouvé un Guido Cipolla qui fait de la longboard en Italie, ce qui nous rapproche de l’univers des cultures urbaines. - Mais pas de graffeur. - En effet. J’ai aussi essayé de comprendre à quoi l’œuvre faisait référence… je te préviens, c’est un peu flou. Déjà, « from here to eternity » c’est pas de lui. La première fois que ça intervient, c’est dans un film de Fred Zinnemann, réalisé en 1953, c’est le titre du film. - Et alors, ça voudrait dire quoi ? - Je ne sais pas trop… le film critique, selon ce que j’ai lu, l’institution militaire… Toutefois, l’histoire de l’expression ne s’arrête pas là. Vingt-quatre ans plus tard, c’est le musicien Giorgio Moroder qui sort son tube du même nom. J’ai écouté, c’est de la disco un peu planante qui fait « From here to eternity / That's where she leads me / From here to eternity / with love, with love, with love, with love ». - Une chanson d’amour. - Exact. - Ce qui ne nous aide pas vraiment à comprendre, ajouta l’Américaine dont la curiosité commençait à s’éveiller. - Il y a aussi une chanson d’Iron Maiden sortie dans les années 90, de ce que j’ai compris, elle parle d’une jeune femme se faisant séduire par un bad boy lui proposant d’aller « from here to the eternity », à savoir en enfer… j’ai pas trop aimé la chanson. - Ça m’aurait étonné. Et alors ? - Bah… c’est tout. J’ai rien d’autre. - Et comment tu interprètes ça ? Lui demanda-t-elle toujours ironique. - Hum, peut-être, peut-être, commença Benjamin qui chercher quelque chose à dire, peut-être que Guido Cipolla, alias Mr Onion, a fait ce graffiti pour déclarer son amour à une femme qui allait prendre un bateau le lendemain pour voir Manikarnika ghat depuis le Gange… - Ou peut-être que ce bastard s’est cru profond en écrivant un truc sur l’éternité dans l’endroit où on brûle des morts qui, selon ce qu’on dit, devraient atteindre le moksha et qu’il n’a pas du tout penser au réseau interdiscursif qu’il était en train de produire. - C’est quoi déjà le moksha ?... C’est marrant aussi d’imaginer cet endroit avec un tube de disco, peut-être qu’il écoutait ça pendant qu’il peignait, déclara crânement Benjamin tout en se mettant à chanter « From here to eternity, That's where she takes me, Frome here to eternity »… L’image la fit rire et elle concéda que le gars avait dû « prendre son pied et se taper un bon petit trip ». Le moksha, c’est la libération ultime de l’âme individuelle, sa sortie du cycle des réincarnations… si on est incinéré à Bénarès, normalement, on rejoint le moksha. - Peut-être qu’il voulait dire que le véritable moksha, c’est l’amour. »
Benjamin lui-même se sentit niais, ce qui le fit rougir, ce qui attendrit l’Américaine, et ce qui les détourna de cette épineuse question. Dans leur nouvelle maison, sur ce toit grillagé (contre les singes), il et elle profitaient de la chaleur du mois de février. Quelques cendres venant des ghats de crémation en contrebas flottaient dans le vent. Ils étaient bien, à deux, dans la lumière de la fin d’après-midi. D’ici à l’éternité, c’est là où elle le menait, d’ici à l’éternité, lalala lala la...
youtube
#from here to eternity#benjaminduronflan#fiction#varanasi#manikarnika#Burning Ghat#ghat#bénarès#amour#street art
1 note
·
View note
Text
Les Aventures de Benjamin Duronflan, chapitre 8 - La Citadelle du désert
Le rescapé des bactéries sortit de l'hôpital le cœur lourd de rage et les poches légères de roupies. On lui expliqua plus tard qu'il s'agissait des pratiques peu scrupuleuses des hôpitaux privés, qui, à travers tout le continent, tenter plus d'alourdir les notes des patients que de véritablement les soigner. De retour dans sa guest house, Benjamin avait discuté avec un voyageur français, futur instituteur comme lui, qui avait failli se faire avoir de la même manière mais qui, ne voulant pas quitter ses amis et ayant été prévenu, n'était pas tombé dans le piège du médecin au regard grave. Le jeune homme avait fustigé « la marchandisation de la santé », ce processus de libéralisation du marché du soin qui avait aussi lieu en France aujourd'hui. Benjamin lui avait dit en riant « nos vies valent plus que leur profit, c'est ça ? T'es un peu Besancenot, toi non ? », le voyageur avait grimacé et répliqué qu'il se fichait des partis politiques et qu'il écoutait juste l'expression des travailleurs et travailleuses des hôpitaux, comme par exemple le syndicat Sud-Santé sociaux. Cela faisait longtemps que Benjamin n'avait pas discuté politique avec un de ses compatriotes (même si son interlocuteur réfutait ce terme car il ne « reconnaissait ni patrie ni frontière »). Cela lui fit oublier un peu sa colère contre ces médecins ripoux qui l'avaient « séquestré », sans toutefois lui faire oublier qu'il n'avait pas assez d'argent pour continuer son voyage. Au détour d'une discussion sur les mérites de Célestin Freinet, Benjamin demanda à son nouveau « camarade » s'il pouvait lui prêter un peu d'argent pour payer son billet de bus pour Jaisalmer. Il accepta, et c'est ainsi que Benjamin se joignit à Arthur, le futur instituteur syndicaliste, Dimitri, étudiant ingénieur, Quentin, le pharmacien du groupe et Romain, créateur de start-up et film maker. Benjamin trouvait cette compagnie fort agréable, les quatre amis étaient amis d'enfance et il trouvait cela fantastique qu'ils fussent encore amis en ayant des parcours d'études si différents. Le bus-couchette pour Jaisalmer mettait quinze heures, dont une bonne moitié sur une route cahoteuse où il était difficile de dormir. Benjamin se réveilla plusieurs fois en se cognant au plafond de sa couchette, tant est si bien qu'il se confectionna un turban autour de la tête pour amortir les coups. Le principal sujet de discussion du groupe était alternativement l'attitude qu'ils auraient dû avoir lorsqu'ils s'étaient rendus compte que la guest house où il séjournait faisait travailler un enfant, et les différentes stratégies d'un jeu népalais qu'on leur avait offert qu'ils appelaient entre eux « le jeu des tigres et des chèvres ». A leur arrivée, ils s'étaient faits amener directement dans une guest house par un rabatteur, juste pour « prendre un petit-déjeuner ». De fil en aiguille, ils s'étaient engagés pour un safari dans le désert. Leur hôte les avait considéré comme un groupe et ainsi Benjamin s'était retrouvé embarqué d'office dans l'aventure, obligeant les quatre amis à payer pour lui. Il sentait bien qu'il commençait à les agacer, mais une occasion pareille ne se refusait pas, il avait suffisamment payé et de toute manière, il n'avait pas le choix. Le safari avait été un moment sympathique même s'ils avaient rapidement compris qu'ils n'étaient pas allés très loin dans le désert comme on leur avait promis. Benjamin s'était efforcé de faire rire ses compagnons de safari : il leur avait avoué son amour pour Camaro et Garou, deux chanteurs assez démodés, et les avait impressionnés avec ses imitations de François Hollande. Bref, la soirée autour d'un feu de camp sous un ciel sans étoile avait été agréable. Le safari avait été aussi plus court que prévu, mais personne n'avait émis la moindre protestation, la chevauchée de dromadaire étant fortement inconfortable pour les postérieurs des cinq Français. De retour à Jaisalmer, les quatre amis s'étaient mis à l'arrière de la jeep, tandis que Benjamin s'était retrouvé tout seul devant avec le conducteur. Il angoissait un peu quant à ses moyens de survivre et de continuer son voyage. Il passait en revue ce qu'il pourrait faire pour gagner de l'argent, quant tout à coup, Jaisalmer apparut au loin. Une citadelle de sable s'élevait au milieu de la plaine désertique. D'épaisses tours se dressaient à chaque angle des remparts. Au pied du haut talus sablonneux, une petite ville jaune ocre s'étendait autour du fort. Pendant les minutes qui suivirent, Benjamin eut le raisonnement suivant ; c'était la première fois que de telles pensées lui arrivaient. S'il avait été une proie facile pour les rabatteurs et arnaqueurs en tout genre, c'était notamment à cause de son air naïf et un peu niais. Il pourrait alors « retourner le stigmate », utiliser cet air naïf et un peu niais pour arroser les arroseurs. Toutefois, en réfléchissant plus longuement, il lui apparut qu'il était bien plus facile, et donc plus rapide, de lui aussi arroser les arrosés : et c'est ainsi que Benjamin se lança dans une carrière de rabatteurs et de petit escroc.
Benjamin avait remarqué que les rabatteurs les plus convaincants, les arnaqueurs les plus efficaces, étaient ceux dont on ne se rendait jamais compte qu'ils en étaient. Lorsque le voyageur flaire le coup monté, le faux désintéressement, il prend la fuite. Il perdra alors tout plaisir et tentera de s'en tirer en dépensant le moins possible. Si par contre, il ne se rend jamais compte qu'il est en train de se faire avoir, s'il croit que tout est normal voire qu'il est en train de vivre un événement exceptionnel, une heureuse rencontre, il lâchera facilement ses roupies pour vivre des expériences « qui n'ont pas de prix ». Le jeune Français remercia rapidement ses compatriotes et tâcha de trouver la chambre la moins chère du fort. La nécessité lui fit négocier comme il ne l'avait jamais fait, revenant trois fois, inventant des tas d'histoire sur sa vie et s'intéressant jusqu'à la taille et au poids de tous les enfants de son logeur, pour enfin obtenir le prix qu'il souhaitait. Sa « piaule » était lugubre, humide et sans fenêtre ni eau chaude malgré le froid qui traversait la ville en ce mois de janvier, mais il payait l'équivalent de moins de deux euros. Lorsqu'il fut au calme, Benjamin établit une liste :
« - d'abord trouver des clients dans divers domaines : safari, billets de train et de bus, guest house, restaurants de divers types. Pour garder son indépendance, ne pas avoir à faire à une seule personne, mais à cultiver une réseau de partenaires possibles. - leur faire comprendre l'intérêt de travailler ensemble, parler en business man, négocier les commissions. Ne pas hésiter à faire preuve de cynisme. Jouer le gagnant-gagnant. - bâtir les scénarios avec ses partenaires - trouver des pigeons - commerce équitable - tradition . respect . étoiles Faut-il trouver des partenaires de qualité ? => si oui, possibilité de faire plus d'argent en gagnant la confiance des pigeons. => si non, argent en les arnaquant sur les prix. »
Pour les safaris, il connaissait une personne, celui qui leur en avait vendu un, deux jours auparavant. Benjamin avait les jambes flageolantes, la boule au ventre, les mains tremblantes… bref, il avait le trac. Il s'arrêta à l'entrée du fort pour faire un peu de méditation et se calmer un peu, mais n'y arriva pas. Dans sa tête, il se répétait les formules qu'il allait sortir à son client et se demandait s'il y avait des risques…
« - Bonjour ! S'exclama Benjamin en voyant son homme, avant de lui serrer chaleureusement la main. - Namasté, vous cherchez une chambre ? - Hum, non… mais j'ai à vous parler, vous prendrez un chaï ? - Oui, si vous… vous pouvez monter à l'éta… - Non, non, je vous invite, répliqua doucement le Français tout en prenant son homme par les épaules. » Son client était un peu abasourdi et suivait Benjamin d'un air méfiant ; ce dernier était fier de comment cela commençait, « il ne faut pas baisser la garde, ne pas se déconcentrer » se répétait-il. Ils s'assirent dans un tea-shop, Benjamin commanda deux chaï d'un air assuré et planta son regard « naïf et un peu niais » dans les yeux sombres de son interlocuteur. « - Votre approche est trop directe, on comprend tout de suite l'arnaque. D'autant plus que tous les guides de voyage préviennent les touristes, expliqua Benjamin rapidement. Vous voyez, vous arrivez à prendre des touristes à la sortie de leur bus, mais, de deux choses l'une. Primo, ils prennent vos safaris à contre coeur… - Mais, non les touristes sont toujours très… tenta de répliquer le loueur de dromadaire qui avait dû mal à sortir de son rôle habituel. -... et donc ils sont moins prêts à dépenser. En réalité, s'ils acceptent, c'est juste parce qu'ils sont fatigués et qu'ils ont la flemme de chercher autre chose.
Benjamin marqua une pause pour capter l’attention de son auditeur.
… Deuxio, vous ramenez trop peu de personnes. Vous préférez chercher les touristes vous-mêmes parce que vous ne connaissez personne qui parle mieux anglais que vous, certes, certes... Toutefois, vous ne parlez pas d'autres langues européennes, alors que 30 % des touristes qui viennent à Jaisalmer sont français. Vos qualités, c'est de connaître le coin, les chameliers, etc. Par exemple : laissez tomber le couplet sur la fête de trois jours dans le désert à se bourrer la gueule. Vous croyez que c’est à ça que rêvent les touristes ? Y a Goa pour ça ! Le touriste, il veut des étoiles, des chansons traditionnelles autour du feu, il veut des turbans colorés et des moustaches, de la tradition, de l’authenticité. Il veut trouver son fantasme d’un Rajasthan de conte de fée… Benjamin continua pendant plusieurs longues minutes, son client était conquis. Ils se mirent d’accord sur une bonne commission. Benjamin expliqua le scénario à jouer devant les touristes : il est un ami de la famille, et ils sont un peu sa deuxième maison. Blablabla…
Ainsi, Benjamin traînait dans les hôtels, les restaurants… il entamait la discussion avec quelques « voyageurs » (il savait bien pour en être un que les touristes préféraient être considérés comme des « voyageurs »). Il était tombé amoureux de Jaisalmer après avoir fait un exposé sur la conservation des systèmes défensifs anciens en contexte touristique lors de son cours de licence sur les systèmes défensifs, et depuis, il venait tous les ans. Cette année, il avait la chance de pouvoir y rester six mois. Il préparait actuellement un sujet de thèse sur la préservation patrimoniale du système défensif de Jaisalmer avec une perspective sociologique. L’association des habitants du fort est, par exemple, en ce moment en procès contre le Lonely planet pour diffamation parce que le guide a écrit que le tourisme abîme le fort et qu’il faut donc éviter de dormir dedans. Pour le jeune chercheur, il était intéressant de voir aussi les enjeux postcoloniaux de ce problème de la préservation du patrimoine : la prétention du Lonely planet incarnant bien cette prétention postcoloniale anglo-saxone à prescrire les bonnes conduites aux subalternes dans tous les domaines, en dépit de l’avis des premiers concernés. Et en même temps, quelle politique de patrimonialisation pour le fort ? Il leur demandait ensuite s’ils comptaient faire un safari et avec qui, il y en avait tellement ! A coup sûr, on lui demandait des conseils et il sortait son discours sur sa deuxième famille, que c’était des gens adorables, qu’ils pouvaient leur faire visiter leur village et le désert qui l’entourait, que c’est un peu plus cher que les autres tours parce qu’ils tiennent à payer équitablement tout le monde dans le village. Ce n’est pas une entreprise avec un patron à Jaisalmer qui s’en met plein les poches et les autres au village qui ne voient pas la thune. L’argent, il reste dans les villages du désert pour être réinvesti dans le développement : puits, écoles, dispensaires, entretien des routes. Un peu comme le commerce équitable quoi. Ils verront : la nuit dans le désert est une expérience inoubliable, des étoiles par millions. Avaient-ils déjà vu la voie lactée ? Il les prévenait aussi que le dromadaire n’est pas un moyen de transport très confortable, mais que c’était à faire parce que c’est quand même le moyen de transport traditionnel et que les 4x4 polluent beaucoup et abîment les chemins pastoraux, les chemins de bergers précisait-il. Ils avaient aussi une option qu’il servait quand il sentait qu’il manquait un petit quelque chose pour convaincre. Avec le tourisme de masse aujourd’hui, les dromadaires sont souvent très mal traités, on leur fait porter de trop lourde charge, les chameliers connaissent leurs bêtes et sont obligés de les battre pour les faire avancer… Alors que dans sa famille ! Eux, ils connaissent leurs bêtes, faut voir comment ils leur parlent et ce qu’ils sont prêts à faire quand ils perdent une bête.Les animaux sont leur seule richesse depuis des générations, ils savent en prendre soin.
Bien entendu, Benjamin ne donnait pas ce discours en bloc comme nous l’avons fait par commodité, mais le diluait au fil de la conversation si bien que, avec par ailleurs ses soupirs compréhensifs quant à l’attitude épuisante des rabatteurs, Benjamin à coup sûr arrivait à convaincre ses cibles de prendre un safari chez son client. Ensuite, Benjamin s’assurait de les faire se rencontrer dans un espace petit et exiguë pour que les touristes s’imaginent qu’il s’agissait de leur seul logement à Jaisalmer et qu’ils aidaient par conséquent une famille pauvre et le tour était joué ! Les touristes étaient même parfois compréhensifs quant aux petites rations qu’on leur servait, imaginant qu’il s’agissait d’une ration normale pour les gens du cru.
Ainsi, les affaires tournaient bien pour Benjamin. Il avait diversifié ses activités et renégocié ses commissions. Ce qui avait été juste un moyen de sortir d’une mauvaise passe devenait pour Benjamin un véritable gagne-pain et il recevait des offres de commerçants qui observaient les prodiges qu’il arrivait à faire avec les touristes. Puis, un jour alors qu’il embobinait un groupe d’Australiens, il pâlit soudainement comme s’il avait subi une attaque. Ses yeux partirent de sa main et remontèrent le long de son bras, et plus ils avançaient dans leur enquête plus les traits de Benjamin trahissaient une douleur terrible, plus ses paroles se faisaient lentes et difficiles. « Quelle idée va-t-elle prendre de moi ? » se dit-il. La main blanche et potelée se déplaça le long de la table pour attraper sa tasse de café ; Benjamin était désormais muet. Le lecteur attentif aura reconnu la source du trouble du jeune rabatteur. Les Australiens continuèrent à discuter sans se rendre compte de ce qu’il se passait dans le cœur de notre héros. Le trouble, la simplicité presque enfantine de la mine apeurée de Benjamin, le dévouement parfait, simple, sans effort, sans espérance que son regard exprimait, firent un contraste charmant avec l’aisance et la volubilité qu’il avait montré dans les minutes précédentes quand il parlait de Jaisalmer et ses systèmes défensifs. Quand la passion était monté sur scène, elle avait fait tomber le masque de l’acteur.
L’Américaine poussa un cri enthousiaste qui ressemblait un peu à « Mon cher Benjamin », mais le destinataire de cette exclamation ne pouvait s’en rappeler clairement. Elle fut troublée de voir une rougeur brûlante envahir Benjamin jusqu’au bas du cou. Il semblait avoir du mal à respirer et se tordait les mains d’une manière pathétique ; elle entendit un bref « excusez-moi... » prononcé dans un soupir et vit son ancien compagnon de Vanarasi disparaître soudainement. L’Américaine était bouleversée par cette réaction, elle se demandait quelles mésaventures avaient pu changer ainsi le caractère de son ami. Après tout, il était si naïf qu’elle s’était inquiétée pour lui quand ils s’étaient quittés. Mais d’ailleurs, ne devait-il pas être à Bombay à l’heure qu’il était ? Elle eut peur : « Une âme si simple, si sincère que celle de Benjamin, pourquoi rougirait-elle en me voyant ? Pourquoi sentirait-il le besoin impérieux de me fausser compagnie ? Il faut qu’il est fait une chose terrible, affreuse qu’il ne puisse supporter de me voir en face. Mais quelle crime peut être si noir pour produire un tel effet chez un être si jeune et si bon ?». Tandis qu’elle se posait ce type de questions, Benjamin s’était réfugié dans sa chambre, secoué de hoquets et de larmes : ces larmes n’étaient pas des larmes de tristesse, mais de honte. Benjamin était dévoré par la honte d’avoir été aperçu dans ses « activités » par la femme aux mains blanches. Alors qu’il avait réussi à mettre sa mauvaise conscience de côté pendant ces deux semaines d’ « activités », la vue de cette main blanche saisissant sa tasse à café lui avait fait soudain sentir tout le poids de ses mauvaises actions. Il était doublement tiraillé par le remord et la crainte de son jugement à elle. Il s’enroulait dans sa lohi, un large châle en laine très porté par les hommes dans le nord de l’Inde, et tout en tremblant, il saisit le livre qu’il lisait actuellement : Lucien Leuwen. « Stendhal, Stendhal, lui ne me jugera jamais. » chuchota-t-il avant de rejoindre Lucien dans la bonne société de Nancy. « Il n’y a plus d’yeux que pour les grâces d’une petite légitimiste de province, garnie d’une âme qui préfère bassement les intérêts particuliers de sa caste à ceux de la France entière […] « Pour me rapprocher de ces beaux yeux, j’ai acheté un missel, je suis allé me battre, je me suis lié avec M. Du Poirier » ». Et lui qu’avait-il fait pour se lier avec ses belles mains ? Il continua à lire les essais amoureux de Lucien avec Mme de Chasteller. Le jeune homme n’était pas non plus un expert dans ses amours, et Benjamin ne trouva pas véritablement en Lucien un modèle. Il remarquait toutefois que Mme de Chasteller était touchée par la sensibilité et la sincérité de Lucien, ce qui décida le rabatteur français a confessé à celle qu’il adorait – oui, il s’en rendait compte désormais, il l’adorait – tous ses récents péchés. Elle lui avait ouvert les yeux sur la noirceur du monde une première fois en lui révélant le mensonge du chauffeur de rickshaw à Vanarasi, et désormais elle tournait le miroir vers son âme et l’obligeait à un examen de conscience. « Je veux avoir le cœur léger pour m’adresser à un être si pur, il ne peut y avoir de mensonge entre nous, se disait-il dans son lit. Mon pauvre Ben, ton caractère est changeant comme un vent de printemps. Demain, je puis être assassin, voleur, tout au monde. Je ne suis sûr de rien sur mon compte » conclut-il en pensant à Lucien Leuwen.
1 note
·
View note
Text
Les Aventures de Benjamin Duronflan, chapitre 17 : Devenir artiste
Benjamin et l’Américaine conclurent que le sens de la peinture importait finalement moins que celui que les « locaux » lui donnaient. Redescendant de leur perchoir, ils prirent ainsi place dans le tea shop de Manikarnika pour en savoir plus. Au milieu des tas de bois, derrière les plate-forme de crémation et le temple de Shiva, se tenait en effet une petite échoppe où l’on vendait du chai et quelques samossas. Une vieille radio diffusait de la musique. Depuis leur banc, ils pouvaient apercevoir les têtes de mort de Mr. Onion et même parfois, quelques flammes dépasser de la balustrade de la plate-forme des brahmanes. Ce matin-là, un baba les accueillit en buvant un chaï, il leur fit remarquer qu’ils les avaient déjà vu le jour d’avant. Oui, oui, ils habitaient à côté. Après quelques échanges de politesse, l’Américaine se lança. « Qu’est-ce que vous pensez de la peinture, là-bas ? ».
Le saint homme dit tranquillement qu’elle avait été faite par un ami colombien. Les voyageurs se regardèrent, on leur avait dit la veille que le peintre était allemand. L’Américaine se demandait si elle pouvait toujours considérer ce geste comme un geste néocolonial, un ultime geste de possession du territoire de la part de l’Occident, si l’homme était colombien. Plongée dans cette perplexité géopolitique, elle resta muette et laissa Benjamin prendre le relais. « Mais, vous, vous l’aimez bien ? » demanda Benjamin. Le vieil homme répondit doucement que l’artiste avait fait cela avec le cœur, qu’il leur avait laissé cela et que cela, oui, cela était bien. Et puis, on pouvait le voir depuis la rivière… Quelques minutes plus tard, ils interrogèrent un autre homme : s’il semblait connaître bien Manikarnika, mais n’avait ni la posture, ni le regard des gens du coin, et pour cause, il venait de Delhi et faisait des études d’anthropologie dans une université estonienne. « Ce n’est pas bien… les gens, ils viennent, ils peignent les murs sans en connaître l’Histoire. Cet endroit... très ancien, très sacré, vous savez… non, il n’aurait pas dû. » leur expliqua-t-il d’un air sombre. « Mais bon, les choses changent, ce n’est peut-être pas si mal... ». Un autre homme écoutait la conversation, Benjamin se tourna alors vers lui pour le faire participer au débat : « Et vous, vous en pensez quoi ? ». « On comprend pas. Ici, personne ne comprend ce que ça veut dire ».
Un plus tard, ils réitèrent l’expérience dans un second tea-shop un peu en contre-bas. Et là encore, il n’y avait pas d’unanimité. Un jeune homme qui passait beaucoup de temps ici semblait indifférent à la peinture en elle-même (« cela ne change rien à ma vie, rien de plus, rien de moins ») mais expliquait que le peintre leur avait laissé quelque chose, et que ce dernier pourrait dire à ses amis « vas à Manikarnika et tu verras ». Un autre, plus âgé – qui disait avoir vécu à « Fille-du-Calvaire » à Paris – trouvait que les gens ne se rendaient pas compte et qu’ils ne protégeaient pas assez leur culture : on n’aurait pas dû laisser le peintre dégrader les lieux. Benjamin et l’Américaine n’arrivaient donc pas à distinguer de tendance générale : ce qui était certain, c’était que le geste n’avait pas été unanimement considéré comme sacrilège. Mais cette incompréhension s’ajoutait à leur difficulté à comprendre ce petit quartier qui fonctionnait, et cela ils le percevaient, différemment du reste de la ville. On leur avait dit : « Faites attention, Manikarnika, c’est un endroit dangereux »… ce qui posait a priori un voile sombre sur ce ghat, qui s’ajoutait en plus à sa fonction mortuaire et à la présence des bûchers. Et oui, en effet, on sentait qu’il existait des solidarités cachés, un fonctionnement spécifique. « Ce n’est pas un lieu publique ici, ce n’est pas le gouvernement qui gère le ghat » leur disait-on. Non, c’est vrai, les lieux sont contrôlés par les Doms, une puissante caste d’intouchables, qui gère leur monopole de la crémation à Varanasi. A Manikarnika, tout passe par Dom Raja, le roi des Doms, et l’État ne semble pas y mettre les pieds. Il y avait aussi la présence de la drogue qui transformait cet endroit en un lieu interlope, la marijuana à usage religieux mais aussi pour les junkies… Benjamin et l’Américaine ne comptaient plus les propositions qui s’allongeait comme des chapelets : « marijuana, haschich, MD, héroïne, opium, cocaïne, LSD... ». D’ailleurs, l’endroit où ils vivaient avait la réputation d’être un repère à junkies (ils ne s’en étaient pas rendus compte) et le patron serait un vieil héroïnomane. A chaque fois, l’Américaine refusait poliment, pour elle, vivre c’était se battre et elle avait besoin de toute sa lucidité dans son entreprise. Analyser la situation pour donner le premier et le dernier coup.
Benjamin lui n’analysait pas, jamais, ce qui ne l’empêcher pas tâcher de comprendre. Par exemple, cette ambiance lui faisait penser à Jean Genet qui voulait mettre le théâtre dans le cimetière, faire un spectacle qui réunisse la mort et les marginaux. « Car c’est une Fête qui aura lieu à la tombée du jour, la plus grave, la dernière, quelque chose de très proche de nos funérailles » répétait Benjamin avec un air intelligent. Il faisait aussi remarquer qu’on voyait déjà cette figure du cimetière comme lieu interlope dans Hamlet avec la scène du fou et du fossoyeur. L’Américaine lui fit d’abord remarquer que c’était difficile de rapprocher cette image occidentale de Manikarnika ghat,avant de succomber rapidement au rapprochement qui était trop séduisant intellectuellement. Elle ajouta donc sa pierre à l’édifice et remarqua que l’expurgation des cimetières des villes européennes au XIXème allait de pair avec le mouvement hygiéniste et la mise au ban, socialement et géographiquement, des prostitués, des drogués, des théâtres… bref, de tout ce qui ne correspondait pas à la morale de l’époque. Elle remarqua aussi que l’Inde et l’Europe n’avaient pas vécu séparément, ne serait-ce qu’ à cause de la colonisation, et que ce statut de Manikarnika était peut-être lié à une évolution récente. D’ailleurs, il lui semblait avoir entendu que le nombre de crémations avait augmenté ces dernières décennies. Ainsi, Benjamin et l’Américaine se gargarisaient de leurs analyses dans l’odeur douceâtre du feu de bois (« l’odeur de la viande grilléééée » plaisantait Benjamin sans que son amie comprenne la référence*). Si l’endroit avait donc cette dimension sulfureuse, il y faisait bon vivre et la présence de nombreux babas réjouissaient notre héro. Il passait de longues heures assis en silence à côté d’eux, observant leurs postures et, comme l’aurait fait un enfant, tentait de reproduire ces états méditatifs. L’Américaine, elle, regardait cela de loin, ressentant toujours le même malaise quant aux pratiques de spiritualité hindous.
C’est l’Américaine qui, pendant, que Benjamin était encore on-ne-sait où en train de faire on-ne-sait-quoi, demanda au gérant de leur guest house ce qu’il pensait du graffiti de Mr. Onion. Pour lui, c’était un taggueur coréen assez connu ici, notamment parce qu’il prenait de la cocaïne. S’il le voyait, il pourrait lui présenter. Mais, aimait-il la fresque ? Cela ne le regardait pas vraiment, il s’en fichait. Mais avait-il le droit de peindre sur le ghat ? Il n’y avait pas de problème, non vraiment pas de problème, everything is possible. Demander aux locaux, seulement si la police arrivait, ils pouvaient te demander d’arrêter pas plus. Si elle était intéressée, si elle voulait peindre, il pouvait l’aider. L’Américaine tentait d’expliquer qu’elle en était bien incapable, mais son interlocuteur l’encourageait. Vraiment si elle voulait, pas de problème, il fallait qu’elle essaie. Il pouvait venir avec elle, où elle voulait, tout était possible. Lorsque Benjamin rentra, l’Américaine écoutait encore les conseils de Ravi, alias Manu Chao, pour décorer les murs de Bénarès. Le Français qui n’avait pas suivi la conversation fut tout de suite emballé par ce qu’il croyait être le projet de l’Américaine et ce qui encouragea leur hôte qui était déjà en train d’imaginer déjà les aspects pratiques de l’expédition. Il fallait trouver de la peinture, des pinceaux – à moins qu’il ne souhaitait peindre à la bombe, mais c’était plus difficile à trouver –… il fallait surtout trouver un lieu. C’est ainsi que de critique d’art, ils passèrent avec l’aide de Manu Chao, du côté des artistes. L’Américaine était à la fois un peu effrayée et gênée ( n’était-ce pas un peu colonial) mais ses doutes furent balayés par l’insistance et la motivation de leur hôte aux cheveux longs. Elle se laissait aller à l’expérience, le cœur léger : aujourd’hui, elle n’était plus analyse mais création. Les scrupules pouvaient aller se faire foutre.
* pour comprendre la mauvaise blague de Duronflan
0 notes
Text
Les Aventures de Benjamin Duronflan, chapitre 19 - Kolkata
Benjamin avait un goût de fin dans la bouche tandis qu’il regardait les paysages défiler devant lui. Au petit matin, ils avaient pu découvrir le Bengale. Plus luxuriant, avec des cocotiers partout, de larges feuilles vertes, des étangs, des rizières inondées. L’Inde poussiéreuse et sèche était derrière eux. Il y avait quelque chose de tropical dans cette approche tranquille de Calcutta. « Kolkata », elle prononçait ce nom machinalement. La ville de la fuite. Kol – ka – ta, un mot simple et équilibré. Loin du drame de Bé – na - rès. Un mot comme de raison, une ville d’intellectuels. Kol – ka – ta.
Pourquoi Calcutta ?
Tout d’abord, parce qu’il y a un train direct depuis Varanasi. Oui, c’est la principale raison. Peut-être aussi parce que les grandes villes sont faites pour les fugitifs.
C’est tout ?
Non, aussi parce que l’Américaine… elle en rêvait depuis plusieurs semaines déjà, depuis leur premier séjour à Bénarès. Elle avait littéralement épousé le désir de Kolkata des habitants de Bengali Tola, la rue des Bengalis de Bénarès. Elle avait vu les lumières dans leurs yeux, elle y avait vu une ville de culture, une fierté pour autre chose, une pratique de la pensée, de l’art qu’elle ne trouvait pas à Varanasi et qui lui manquait.
La capitale coloniale, en somme ?
Oui, et non. Calcutta, c’était aussi Anne-Marie Stretter emmenant « aux îles » ses amants. Le vice-consul criant dans les rues. Une mendiante qui chante. Bien entendu. Mais, Calcutta, c’est aussi la révolution. Le marxisme triomphant. Et puis, il y avait Mère Térésa.
Mère Térèsa ?
Non, enfin, cela faisait partie de… du problème, ça construisait Calcutta comme un problème. Et elle aimait les problèmes. Donc quand on dit qu’elle voulait se rendre à Calcutta parce que c’était une capitale coloniale, c’est vrai dans le sens où elle était attirée par l’épaisseur politique de la ville.
Un goût pour la polémique, vous voulez dire.
Ils avaient quitté Varanasi dans la journée. Manu Chao ne tiendrait pas sa langue longtemps et toute la ville ne tarderait pas à être au courant. Ils sentaient qu’ils devaient partir sans attendre le début des rumeurs ; il n’y a pas d’anonymat possible à Bénarès. Prendre le premier train pour Calcutta. Fuir cette ville, fuir cette tragédie. Qu’avaient-ils fait ? Pourquoi cela ? Même Benjamin était possédé par le remord, l’Américaine quant à elle était froide, glacée. Partir. Partir. Partir. Fuir Bénarès. Fuir ce drame, ce théâtre. Fuir cette ville où le sublime et la merde se donnent la main, toujours. Fuir cette ville si vivante et si tournée vers la mort. Fuir. Sortir de la tragédie par la petite porte, refuser la mise à mort. Le Doon express arriva avec deux heures de retard. Les deux amants faillirent d’abord prendre le train pour Bombay, puis manquèrent de rater celui pour Calcutta qui changea de quai au dernier moment. Dans leur compartiment, deux militaires. Benjamin s’étonna du pouvoir qu’avait sa compagne pour reconnaître les militaires. « Je le sens » répondait-elle. Les vêtements de sport, l’œil mélancolique, le visage jeune et rasé, les cheveux courts. Un corps svelte. Les trains indiens sont plein de jeunes militaires qui rentrent chez eux pour quelques jours. Elle aurait parié trois milles roupies que les deux venaient d’Assam, au nord du Bengale. Ils n’échangèrent pas un mot, tous s’endormirent rapidement.
Quand ils arrivèrent au matin dans la gare de Howrah, la gare principale de Calcutta, de l’autre côté du Gange, ils prirent la sortie des marchandises. Au milieu des ballots et des caisses de denrées, ils embrassaient l’anonymat et évitaient les possibles contrôles de police. Et là, presque par hasard, ils grimpèrent dans un ferry pour traverser le fleuve, se mêlant à la masse paisible des commuters de Calcutta sur le chemin du bureau. Le petit ferry débarqua ses passagers, la foule envahit les rues de BBD Bagh et ses larges avenues de quartier d’affaires. Ils suivent ces gens qui marchent au milieu de la rue, dans l’ombre des arbres et des immeubles coloniaux. C’est là, que l’Américaine ressentit soudain un grand calme : la ville, sa protection, sa grandeur, son vide étaient comme le souffle d’un soupire, un soulagement. De la peur d’être arrêté, mais aussi d’autres choses d’une boule au ventre qui grandissait au fond d’elle à Varanasi. Ils marchent tous les deux, parfois se touchent le bout des doigts pour être certain que l’autre est toujours là, oui, il est toujours là. Il ne s’agit plus de fuir, cette ville, Kol-ka-ta, elle-même est une fuite. Il suffit de se laisser aller, se laisser marcher, soudain ressentir et retrouver son corps, sa vitalité, son élasticité, sa résistance. L’éprouver, l’épuiser.
Ils remontèrent l’avenue qui borde le parc, saluèrent la statue de Lénine, sourirent au policier qui faisait la circulation dans son pantalon serré immaculé, son casque et ses bottes en cuir. Ils passent devant des échoppes servant des puris pour le petit-déjeuner à des employés de bureau. Jusqu’à ce que leurs pieds endoloris ne les arrêtent dans la très chic Park street. Il y a une église dans une rue adjacente, et un café vendant des pâtisseries européennes à déguster dans des petits fauteuils Louis XV. Ils regardaient les gens à travers la vitrine : la bourgeoisie de Calcutta et quelques touristes, cela leur faisait envie mais ils n’osèrent pas entrer, fugitifs à grands sacs à dos dans ce lieu de raffinement. Dans un dernier souffle, il trouvèrent une guest house dans une rue adjacente. Un grand immeuble du début du XXème siècle à la façade orange, aux escaliers en bois et au vieil ascenseur.
Que firent-ils à Calcutta ? A Calcutta, ils marchèrent beaucoup sans s’arrêter, sans se faire arrêter. A Calcutta, aussi, ils se firent amateurs d’art, ils marchèrent dans les rues et dans les musées, les galeries. Il dit qu’ « il est arrivé ici comme un étudiant en voyage mais que de jour en jour il vieillit à vue d’oeil ». Et elle « L’ennui, ici, c’est un sentiment colossal, à la mesure de l’Inde elle-même ». Non, ce ne sont pas eux qui ont dit ça, mais à l’ambassade de France, dans un fin de soirée d’un été moussonneux. Eux, ils ne s’ennuient pas puisqu’ils marchent, tant qu’ils marchent, il et elle sont heureux. C’est nouveau pour eux, cette harmonie dans le pas, dans l’épuisement. Ils comprennent la langueur, parfois l’envient même, mais non, pour eux Calcutta ce n’est pas ça. La grande cathédrale Saint-Paul, blanche et seule au milieu de son jardin, le Victoria memorial - « Taj Mahal victorien » lit-on, un bâtiment qui n’a jamais servi à rien qu’à une colonisation symbolique d’une ville rebelle, l’Indian Museum. Ils passent des heures debout, fatigués, à observer les peintures de Tagore et l’école du « Jeune Bengale », ces jeunes peintres formés dans les écoles d’art britannique qui revendique à l’aube du Xxème siècle leur art, leur culture. Le Bengale : la capitale a été transféré à Delhi parce que Calcutta était trop révolutionnaire, puis les Britanniques ont imposé une première partition pour affaiblir le nationalisme bengali. C’est cette partition qui a été reprise en 1947 lors de l’indépendance, entre le Bangladesh et le Bengale occidental participant, lui, à l’Union Indienne à majorité hindou. Puis, le Bengale a connu le communisme. D’abord, la répression d’Indira Gandhi, les meurtres… puis, enfin, le PCI a gagné les élections, plusieurs fois jusqu’à aujourd’hui. C’est aussi pas très loin qu’est né le mouvement naxalite, la guerilla, rencontre des intellos de Calcutta en fuite qui ne croiyaient plus aux moyens démocratiques et des paysans. Ils regardaient ces peintures, y voyant le mélange subtile de la tradition des miniatures et des techniques venues d’Occident. « Il y a une vraie modernité dans cette hybridation » répétait l’Américaine.
Dans les jardins du Victoria Museum, il y a un couple sous chaque arbuste, sous chaque buisson. Eux aussi en choisirent un. On dirait que là, on a le droit, alors ils se foutent un peu des regards obliques et des passants honnêtes. Puis, Benjamin soupire. « Ça a un goût de fin, cette cavale, tu trouves pas ? ». Elle ne sait pas, elle s’en fout un peu, ça fait tellement longtemps qu’elle est partie qu’elle ne sait plus trop ce que revenir veut dire. « J’ai peu écrit sur Katmandou, et ce que j’y ai fait » remarque Benjamin. Il parle seul. « Quand j’y pense aujourd’hui, je ne peux m’empêcher d’y penser avec une profonde tendresse. Je crois qu’au début, elle m’avait un peu déçu, peu d’immeubles à l’allure ancienne, peu de monuments. Et c’est vrai que les temples importants sont plutôt en périphérie. Mais que fut douce ma vie là-bas. C’est dure de décrire la douceur. On dit souvent que Katmandou est fatigante, bruyante, agitée, et pourtant, moi j’ai été frappé par sa tranquillité, son caractère presque rural. En un quart d’heure, tu es à la campagne, tu sais. Mais peut-être que je ne puis parler de cela qu’en parlant de mon expérience à l’école. Mon plaisir d’y travailler le soir quand tout le monde est parti, celui d’y arriver le matin sur ma bicyclette ». « Oui » elle luit dit. Il la regarde, pourquoi comme ça, pourquoi elle dit cela. Elle a les yeux fermés, il voudrait l’embrasser mais n’ose pas, il voit qu’elle pense mais pas à lui. Il y a la vie de famille, de quartier, de fac, la vie nocturne et la vie diurne, celle de Brooklyn et celle de Manhattan. « Oui, elle répète, ça a peut-être un goût de fin, cette cavale ».
Ils prenaient un petit-déjeuner dans une échoppe de Sudder street, elle est calme cette rue, bien que cela soit la rue touristique de Calcutta. La chaleur n’est pas encore pesante, pas de suée, au contraire, on profite du soleil. L’homme explique avec fierté qu’il est le seul, ici, à posséder une vraie machine à café, une cafetière à l’italienne que lui a fait livrer une Européenne, il y a longtemps. Elle regarde les aller-venus tranquilles, les taxis jaunes, le vert vif des arbres. Ces couleurs, c’est Calcutta. Benjamin achète le Time of India à un marchand ambulant, il feuillette distraitement. Hier, ils ont parcouru à pied le sud de la ville. Ce temple de Kali couvert de mosaïque « à l’italienne », son sacrificateur de chèvre avec son ventre rebondi et son tee-shirt taché de sang. Les quartiers résidentiels, les modestes avec leurs petites maisons et les moins modestes. Elle s’était dit que c’était une ville où elle pourrait habiter, même si elle pensait à tous ces commuters qui faisait des allers-et-retours tous les jours, oui, elle pensait quand même que c’était une ville où elle pourrait vivre. Avoir une vie normale avec un travail, elle voulait dire. « Putain, sa mère » L’Américaine s’étonna et inquiéta, il n’était pas dans les habitudes de Benjamin d’être vulgaire. Elle passa sa tête au-dessus de son épaule pour voir la page.
The BJP chairman Ramhaman Swareep speaks about a « Paki provocation », Varanasi police portrayed a couple of tourists.
« - Ils disent que je suis italien, c’est déjà ça, marmonna-t-il. - « La couleur verte du tag sur un monument les plus importants de la religion hindou, quand on connaît l’histoire de ce temple et sa première destruction par les musulmans, il est clair que cet attentat vient des islamistes pakistanais » a avancé le porte-parole du BJP, Ramhaman Swareep, lundi lors d’un déplacement à Lucknow, lut L’Américaine. Quelle bande de bouffons… Le BJP, c’est les nationalistes hindous. - Oui, je sais. C’est le parti de Modi, le président. Oui, oui, merci (parfois, elle le prenait un peu pour un con). - « En attaquant le Vashiwnath temple, ce n’est pas seulement Varanasi qu’on attaque, mais l’Inde entière. Ce temple est le coeur battant de notre foi et de notre culture. » continua-t-elle de lire. La police de Varanasi a cependant déclaré au TOI, dimanche, que la piste privilégiée serait celle d’un couple de touristes ayant séjourné à Manikarnika ghat les jours précédant l’événement. Il s’agirait d’une Américaine et d’un Italien. Le porte-parole du commissariat central de Varanasi a assuré aux fidèles que la police mettait tout en œuvre pour arrêter les coupables, quels qu’ils soient a-t-il ajouté. Personne à ce jour n’a pu attribuer une quelconque signification à ces mots abjectes ‘Fuck Mr Onion’. »
Les amants regardaient la photographie de leur œuvre en silence. Duronflan ne pensait pas par lui-même, mais tentait désespérément de percer les pensée de l’Américaine. « Elle est en train de penser à se rendre, se donner à la police, inventer une histoire, présenter ses excuses… se disait-il un peu effrayé, si elle le fait, je dois le faire aussi. » « Jamais. Non. La liberté ou la mort. Qu’ils aillent se faire foutre. » s’écria-t-elle soudain tout en se levant. Benjamin était troublé, c’était comme si elle lui avait répondu, il ne comprenait qu’à moitié.
L’Américaine était partie.
Il la retrouva une heure plus tard, à leur guest house. Les sacs faits ; sur le lit, deux billets d’avion. Madurai, Tamil Nadu. Elle avait le visage tendu et ses yeux claires orageux, les lèvres légèrement pincées. « On décampe ». La seule fois où il lui avait vu cet air, c’était justement lorsqu’elle ébauchait et mettait en œuvre leur « plan », cela fit un peu peur à Benjamin. Il tenta de bafouiller quelque chose, puis abandonna, mit son sac sur ses épaules et la suivit. Il voyait défiler Calcutta dans leur taxi, il ne comprenait rien. Elle lui disait qu’elle avait tout prévu, qu’il n’y avait normalement pas de contrôle de police les aéroports domestiques, qu’il avait un hôtel à leur arrivée… « Un hôtel ? » répéta-t-il, idiot.
0 notes
Text
Les Aventures de Benjamin Duronflan, chapitre 18 : FUCK MR. ONION
Que pouvait-on faire de mieux qu’un graffiti à Manikarnika ghat ? Après le geste de Mr. Onion, la moindre fresque semblait être au mieux un jeu d’enfant, au pire une insipide activité touristique. Telles étaient les pensées qui tourmentaient Benjamin, l’Américaine et Manu Chao. Si effectivement, tout était possible à Varanasi, le jeu du street art perdait franchement de son intérêt. La bande voulait du challenge. Manu Chao avait rassemblé le matériel, il ne restait plus qu’au deux autres à décider du support. C’est l’Américaine qui trouva l’idée. En réalité, elle y avait pensé dès le début, mais avait mis longtemps avant d’oser la dire. Elle-même avait du mal à se départir de sa morale, mais finalement, leurs débats sans fin pour trouver un lieu adéquate l’avaient convaincue. Elle l’avait dit. Vishwanath temple, le temple d’or. Manu Chao et Benjamin l’avaient regardé silencieux, leurs traits étaient devenus soudainement soucieux. N’avait-il pas dit que tout était possible ? Elle plongeait ses yeux dans les leurs, elle voulait, là, leur faire sentir leur peur. Leur reste de morale, de sens du devoir. Benjamin lui était transparent comme une eau minérale, elle pouvait distinguer les mouvements de son âme. A ce moment-là, sur la terrasse surplombant les crémations de Manikarnika, elle n’était qu’un mélange de crainte et d’excitation. Rien de plus. Les yeux de Manu Chao, eux, étaient plus difficiles à sonder : elle le sentait réfléchir intensément, peut-être comme il avait rarement eu l’occasion de réfléchir. Elle sentait aussi qu’elle avait visé juste, que tout n’était pas possible mais qu’il ne pouvait dire non, qu’au fond de lui, il avait déjà accepté. Ils ne dirent plus un mot ce soir-là : leur silence était un pacte de conspirateurs, il les traversait et les unissait dans un destin commun.
Le lendemain fut consacré aux préparatifs : le Vishwanath temple n’est pas n’importe quel temple. Il s’agit d’un des lieux de pèlerinage les plus importants de Varanasi et l’endroit le plus sécurisé de la ville. En réalité, c’est tout un pâté de maisons, contenant plusieurs temples et une mosquée qui est soumis à un plan vigipirat à l’indienne très strict par peur des attentats de la part de l’ennemi pakistanais. Ainsi, si on voit peu de policiers à Bénarès, on observe une véritable militarisation des alentours du golden temple. Pour entrer dans la ruelle qui dessert les temples, le visiteur doit abandonner à l’entrée tout effet personnel sauf son porte-feuille et ses offrandes (fleurs, verres de lait...) qui sont assidûment contrôlées. En outre, les étrangers ne peuvent entrer sans leur passeport et un contrôle d’identité. Une fois à l’intérieur, des policiers surveillent chaque porte des temples. Bref, il était impossible pour la bande de faire entrer les bombes de peinture par la voie normale, et de toute manière, cette dernière ne leur permettait pas d’accéder à la toiture dorée du temple, futur support à leur caprice artistique. Il leur fallait donc prendre une voie de traverse, et cette dernière, ils l’avaient tous les trois remarquée lors d’une de leur visite de reconnaissance. A environ cinquante mètre au nord de la porte 3, une petite impasse leur permettait d’arrivée à un point de vue surplombant la mosquée et le temple d’or, il suffisait d’un peu d’escalade. Le point délicat était toutefois que ce point de vue se trouvait à moins de trois mètres d’un poste de police, lieu de repos des gardiens du temple.
L’Américaine était le cerveau de l’opération, elle donnait les ordres et les deux autres acquiesçaient. Parfois, Manu Chao faisaient quelques suggestions d’ordre pratique qu’elle intégrait au plan sans discuter. Il était simple. A cinq heure du matin, les trois compères se rendraient au point de vue. Si les policiers ne dormaient pas, Manu Chao déguisé en un sadhu extravagant serait chargé de les divertir pour laisser descendre sur l’esplanade en contre-bas le couple de touristes. En dernier recours, ce dernier allumerait un fumigène sous-prétexte d’un rite particulier pour troubler la visibilité des policiers. Une fois à l’intérieur, ils devaient escalader le temple – ce n’était pas difficile, les bas-reliefs faisant comme des marches d’escalier, et poser leur graffiti sur le toit en profitant des dernières minutes d’obscurité. Cela fait, il leur fallait enfiler des déguisements de pèlerins et attendre les premières lueurs du jour, pour se laisser glisser côté ruelle et se volatiliser en se fondant dans la foule naissante. L’Américaine ne dormit pas cette nuit-là, elle n’avait en tête pas d’autres pensées que son plan dont elle se répétait les moindres mouvements. Elle avait des doutes concernant les capacités de Benjamin à ne pas faire quelque chose d’idiot dans un moment crucial. Quant à Manu Chao, on verrait bien, se disait-elle. Ils sortirent tel des ombres à quatre heures et demi du matin. Bénarès dans le silence. On a parlé des sons de Bénarès, mais a-t-on parlé de son silence, des ruelles si sombres que l’on ne voit pas ses propres pieds. Duronflan et l’Américaine suivaient mécaniquement l’ombre de leur guide qui caressait les murs de la vieille Kachi. Qu’allait-il lui faire à la vieille Kachi ? Il était travaillé par le doute mais avançait sans hésitation du pas agile de celui qui est né ici. Qu’allait-il lui faire à la vieille Kachi ? Tout est possible, l’Américaine l’avait forcé à soutenir sa parole, à lui donner la consistance d’un acte et il se transformait maintenant en porteur de bombes. De peinture, certes. Mais porteur de bombes quand même. Ce ne serait même pas les Paki, mais ces deux touristes lunaires et lui qui leur servait de guide. Lui-même qui les avait encouragé. Oui, il les avait poussé à l’acte et s’était retrouvé entraîner dans un engrenage qu’il n’avait pas maîtrisé. Comme lorsqu’on pousse quelqu’un dans un piscine et que le poussé reste accroché à votre maillot de bain, vous entraînant dans sa chute. Le poste de police était endormi, ou presque. Un policier affalé dans un fauteuil regardait un feuilleton à la télévision, à demi-somnolant. Manu Chao n’avait pas besoin de jouer son rôle, ou alors en dernier secours. Les deux passèrent devant le poste et basculèrent par-dessus la balustrade. Fracas. Le policier lève les yeux ; heureusement, Manu Chao est là, virtuose. Il joue le baba à moitié fou, son costume est parfait. Il se fait chassé rapidement par l’officier, mais les deux autres sont déjà de l’autre côté de l’esplanade en train d’escalader le temple.
Quand on pense à ce qu’il se passa sur le temple, on pourrait penser que nous avons pu observer-là une véritable duronflanisation de l’Américaine. Comment cette étourderie, ce manque de sérieux avait-il bien pu lui arriver, on se le demanda longtemps. Toujours est-il que se trouvant face à la toiture plaquée or du Vishwanath temple, tentant d’éviter les projecteurs qui l’éclairaient et l’attention des gardes sur les miradors (qui heureusement se situer de l’autre côté), Benjamin et l’Américaine furent traversés par un mouvement de panique. L’angoisse de la page blanche. Le plan minutieux de l’Américaine ne comprenait tout sauf. Sauf… quand elle se rendit compte de son oubli, elle… sauf… qu’avaient-ils à dire ? À écrire ? Elle avait décrit des procédures mais pas l’objet final, et ni Manu Chao, ni Benjamin n’avaient non plus pensé la chose une seule fois. Et ils étaient, là, perchés comme deux oiseaux idiots, aplatis de tout leur corps sur le plaquage d’or pour ne pas glisser, devant décider ensemble quoi écrire. Et puis le jour se levait plus rapidement que prévu, déjà, on entendait les premiers pèlerins sonner les cloches du temple. Déjà ! Les minutes s’écoulaient à une vitesse extraordinaire, Benjamin semblait avoir perdu connaissance sous l’effet de la peur… elle eut alors un sursaut et laissa échapper un « tant pis ! » agacé. Elle se saisit de la première bombe qu’elle trouva – elle était verte – et traça avec de grands mouvements un « FUCK MR. ONION » dégoulinant. La spontanéité de l’Américaine avait parlé. Il fallait maintenant amorcer un mouvement de fuite.
0 notes
Text
Note sur le chapitre 15 et l’affaire “British officer Vs. Durga goddess”
Le chapitre 15, c’est le télescopage dans le délire de Benjamin de ses imaginaires bibliques et hindous, sans abandonner l’arrière-plan colonial qui travaille la conscience du héro. A la fin du chapitre, Benjamin se retrouve à incarner un officier britannique qui, au cours du XIXème siècle, tira sur le temple de Durga. La légende dit que le temple se mit à saigner et que l’officier prit la fuite et trouva la mort. Cette histoire, elle m’a été racontée par Dada, un employé de ma guest house – cet homme ne sait pas lire, mais et malgré sa jeunesse, est la mémoire de la culture populaire et orale de Varanasi. Il me l’avait racontée une première fois, mais j’en avais oublié les détails, j’ai donc fait des recherches sur internet.

En effet, cette histoire avait attiré mon attention. Elle apparaissait pour moi comme un belle objet de socio-histoire religieuse, mettant en valeur le rôle des configurations politiques et sociales d’un moment, ici la situation colonial, dans la production des croyances religieuses et de apparitions. Cela me faisait penser à ce que j’avais pu lire du travail de l’anthropologue Élisabeth Claverie sur les apparitions de la Vierge à Medjugorje en Bosnie. Dans une interview pour le magazine Jeff Klak, on pouvait notamment lire :
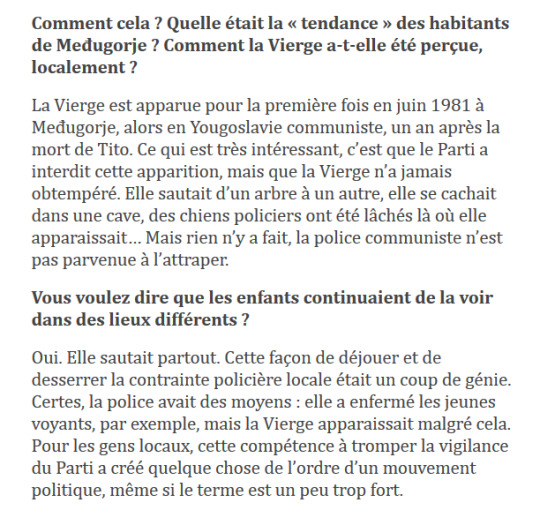
Bref, s’intéresser à comment les dieux du panthéon hindou ont réagi au contexte colonial me semblait intéressant. Le problème, c’est que sur internet, je n’ai rien trouvé de cette histoire. Enfin… je n’ai pas trouvé de trace de ces événements à Ramnaghar de l’autre côté du Gange comme Dada me l’avait dit. Par contre, j’ai trouvé la trace de plusieurs événements très similaires, produisant le même récit sommaire dans d’autres lieux en Uttar Pradesh. On trouve le même récit par exemple dans le temple Lehara Durga Mandir, près de Gorakhpur dans le nord de l’état. Il existe aussi des variantes de cette histoire avec la volonté de destruction du temple de la part des Britanniques pour construire une voie ferrée…
Je trouvais donc des échos à mon histoire, des répliques nées probablement d’une même configuration socio-historique, mais ma légende à moi, à Varanasi, aucune trace. J’ai toutefois pu me faire reconfirmer l’histoire par Dada qui m’a indiqué précisément comment me rendre dans ce temple.
D’abord, il faut traverser le Gange pour se rendre à Ramnaghar. De ce côté-ci de la ville, il y a un pont en construction depuis des années et l’hiver, quand le Gange est bas, on peut traverser sur un point flottant. Il est vraiment de bric et de broc, mais il permet de traverser.

Après, on passe devant le palais. Puis, il faut tourner à gauche et on sort rapidement de la ville.
On retrouve l’Inde poussiéreuse des bords de route. Puis, on on tourne à droite. Sur le bord de la route, il y a un grand bâtiment, immense et sublime. Apparemment, c’est une école.

Quelqu’un me propose de me déposer au temple sur son scooter, j’accepte avec joie cette occasion d’éviter la marche dans la chaleur et la poussière. Une fois arrivé, il y a beaucoup de pèlerins et aucun touriste ; il se dresse au milieu d’une campagne chaude et poussiéreuse. J’observe avec amusement les bas-reliefs et les manifestations de piété. Il y a aussi une distribution de sucrerie qui crée quelques bousculades…

Tout cela est très intéressant, mais je ne trouve aucune des impacts de balles dont Dada m’avait parlé. Ce qui est sûr, c’est que ce miracle n’est pas un objet de culte, ni d’une quelconque forme de patrimonialisation. Finalement, quelqu’un me les a montrées, on en distingue trois, à environ autre mètres de hauteur et en effet, autour, on peut voir comme des traces de sang. Mon interlocuteur m’a aussi donné des détails sur la mort de l’officier britannique : il serait mort attaqué par un essaim d’abeilles. Cela devient déjà un peu miraculeux, on peut facilement imaginer la scène, les abeilles paniquées par les coups de feu… A la fois, je suis content d’être allé voir ce temple, et en même temps, il y a aussi quelque chose d’un peu décevant avec ces trois petites traces de balles que tout le monde semble avoir oublié. J’ai quand même eu le temps de prendre quelques photos avant qu’on m’explique que c’était interdit.

0 notes
Text
Les Aventures de Benjamin Duronflan, chapitre 15 : Délires II
Benjamin se réveilla dans un patio vert d’eau. Il y avait des reflets sur les murs, on aurait juré se trouver près d’une source. Autour de lui, de larges bassines en fer blanc dans lesquels du paneer flotte au milieu du petit-lait. « On eut dit à les voir dormir dans un coin sombre, d’énormes nénuphars s’ouvrant avec les flots lents ou des mets protégés par des couvercles blancs qu’on réservait pour un repas d’anges, dans l’ombre » il se murmure. Au fond, il y a ces pots en fer blanc calfeutrés avec des feuilles de bambous qu’on ouvre puis qu’on verse dans un grand chaudron. Les yeux de Benjamin se décile doucement, que lui était-il arrivé ? Était-il en paix ? Il se redressait douloureusement tout en observant cette blancheur liquide… encore et encore arrivent des hommes à bicyclette, encore les pots en fer blanc, toujours plus de lait. Avec un grand bâton, un homme ceinturé d’un longhi à carreaux remue le lait qui chauffe. S’il continue à en verser, on va frôler la catastrophe ! Benjamin se lève, il tente de leur dire mais eux n’en ont goutte, au contraire, ils accélèrent la cadence. « Une telle abondance de lait qu’on mangera de la crème ». Le ballet des bicyclettes ! Mais ! Non, Benjamin ne veut pas de ces pâtisseries blanchâtres et sucrées. L’odeur du lait frais, du lait qui chauffe, du petit lait, de la fermentation : la tête lui tourne, les reflets liquides sur les murs lui donnent le mal de mer… Dans un effort soudain, il s’arrache à ce lieu et déboule dans la rue. Il reprend ses esprits, il n’est pas loin de Thatheri bazaar, il connaît le coin, il va… une vache lui fait face, c’est une grande vache blanche comme Kamdhenu, la vache-mère. Elle le regarde, le force à plonger ses yeux dans les siens. Encore une fois, la noyade, il se plonge dans leurs sclérotiques pâles : c’est immense comme un océan. La vache et Benjamin bloquent le passage et une bicyclette, toujours chargée des mêmes pots en fer blanc s’approche ; il faut partir. Partout, il le voit ce liquide immaculé et ces petits fromages sucrés, ça déborde des magasins, il faut qu’ils fassent attention. Ça tourne ces choses-là. II veut échapper à l’étouffante odeur des ruelles, il court. Enfin, le Gange. Et l’Américaine, elle l’attend. Sa peau est pâle et son sourire est comme une touche de safran, « ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans du… ». Non ! Pas toi non plus ! « Que tu es belle mon ami, que tu es belle » ! Et dans tous les ménages, on s’attelle à battre le lait, comme une grande coopérative. Les petites filles qui courent dans la rue ressemble à la fillette d’Amul, avec ces couettes bleues. Il coule sous les portes, « comme un troupeau de chèvres suspendues aux flancs de la montagne de Galaad », non pas lui, elle ! Il faut fuir ma belle. L’Américaine ne bouge pas, elle a trop couru pour le suivre. Il l’abandonne dans cette inondation lactée. Le ciel blanchâtre se reflète dans le Gange, et la boisson des Dieu coule en cascade sur les ghats, depuis les fenêtres, sort des robinets et des fontaines… Les premières gouttes ont déjà touché le fleuve. C’est un déluge de lait qui se prépare, il emporte tout. Pur et froid comme la peau de son aimée. Un boat man vite, de l’autre côté du fleuve. Benjamin ne compte plus son argent, les dents blanches de l’homme aux rames lui font mal à la tête, il se renverse le visage face au ciel brumeux. Le lait qui ruisselle arrive dans les eaux sombres du Gange, et comme dans un tasse de café noir, forme des nuages filandreux.
Lorsque Benjamin arrive sur l’autre rive, le Gange a déjà une teinte beige. Le jeune Français se trouve sur cette grande étendue de sable gris, la ville n’a pas d’emprise de ce côté-ci. Il erre comme un fou en tentant d’échapper à son délire, d’échapper au « lait de ses consolations ». Il s’insurge tout en traversant ce désert, il ne veut pas de cette purification, il ne veut cette abondance, la peur blanche. Face à lui se dresse Durga Mandir, un temple pour la déesse, il en a entendu parler. Il se dresse vers le ciel, droit et responsable et devant lui un bassin rempli du même liquide immaculé. Maintenant que le soleil perce la brume, les reflets se fond insupportable, il est sur le pire des glaciers himalayens, là où habitent les dieux. C’est elle, c’est la déesse, elle se venge oui, elle nous provoque ! Il comprend tout maintenant, cet officier anglais, il y a deux cent ans, c’est lui. Il a le fusil entre les mains, il fait face au temple. C’est un duel entre lui et moi, se dit-il. Il n’y a pas d’autres solutions. Il vise, et tire, l’Américaine n’est plus là pour retenir ses doigts. Pan, pan, pan. L’édifice est touché, trois balles sur sa partie supérieure. Qu’a-t-il donc fait le malheureux ? Celui qui pensait l’océan de lait comme une malédiction ? Le sang se mit à couler, littéralement ce temple de granit saignait, et comme dans un mécanisme inverse, le monde qui avait soudainement blanchit se mit à rougir. Le crépuscule arriva avec son voile orangé, le lait du monde prenait cette teinte rosé comme une mer de grenadine. Le rougissement soudain d’une pudeur nouvelle, le rougissement d’après la chute, celui des amants qui se découvre pour la première fois. Pendant quelques minutes, nul ne pouvait dire si le retour de la couleur était une malédiction ou une bénédiction. Ces minutes furent celle du doute pour tout le monde, et peut être que l’on aurait aussi pu influer sur le cours des choses si l’on avait su saisir l’occasion. Mais comment ne pas considérer le mélange du lait d’où viennent tous les dieux et du sang de la déesse comme un présage funeste ? Benjamin avait, une fois encore, pris la fuite. Mais où aller ? Il courait lorsqu’il marcha sur un nid d’abeilles. Elles n’eurent aucune pitié et il perdit connaissance.

0 notes
Text
Les Aventures de Benjamin Duronflan, chapitre 14 - Délires I
Le jour suivant, mais peut-être devrions-nous dire les jours suivants. Ou mieux encore ne pas tenter d’établir de chronologie exacte des événements tellement ce qu’il se passa pendant cette période fut trouble. Petit à petit, et malgré les soins de l’Américaine, Benjamin perdit ses couleurs, sa peau, ses vêtements prenaient désespérément l’apparence d’une pellicule noir et blanc. « - Je ne porte plus de couleur, tu vois. - Mais, ce n’est pas possible. - Et bien si, puisque je les perds. Elle glisse sur ma peau, comme de l’eau sale d’aquarelle. » Elle voyait avec effroi l’eau de sa douche se colorer ; et peu à peu, la face de Benjamin devenait de plus en plus blafarde, l’intérieur de ses cuisses et ses poignets étaient presque translucide, on pouvait voir courir des veines grisâtres sous sa peau. Il se glissait alors dans un large costume deux pièces de différentes teintes de blanc cassé. Mais non seulement, les teintes de Duronflan s’étaient dissipées, mais sa présence décolorait aussi légèrement tout ce qu’il touchait voire même ce dont il s’approchait. Le plus souvent, elles perdaient juste en éclat, comme dans un vieux film, prenant une nuance bleuté, mais parfois, il les attirait dans son délire de noir et blanc.
Vice-consul de France aux Indes. Déplacement à Bénarès. Pénible même si l’amiral a eu l’amabilité de lui faire suivre les journaux français depuis Pondichéry. « Pardon, ma chère, mais à vivre depuis deux ans parmi les gentils et à entendre parler de Issa (Jésus) comme de Mahomet ou tout autre prophète, j’ai oublié qu’il était beaucoup mieux que cela... ». La moiteur des rues de Bénarès. Les intérêts français en Inde du nord. « Les journaux de février ne me sont pas parvenus, je suis resté bloqué en février dans cet odieux combat Valls et Hamon. ». Les anglais vont très peu dans la vieille ville où l’on ne parle que hindi. Pourtant, la charmante douceur hindou. Peuple de paix et de lenteur. « Pas question dans ces conditions, d’abandonner les comptoirs de l’Inde. » Il y a une semaine, il était encore à Chandarnagore. La soie, la canne à sucre, le tabac. L’indigo. Calcutta Jute Fabric Brokers’. Sacrebleu. Benjamin irait bien faire un tour au tennisground, peut-être pourrait-il y éprouver ses nouveaux sous-vêtements en coton. On dit qu’ils sont perfect pour le sport, the Indian best quality. Ou alors, il y croiserait une charmante lady. Il aimait les Anglaises des colonies : cette rigueur alanguie était pour lui le comble de la sensualité et de l’érotisme. A l’image d’un corset que l’on ouvre parce qu’on étouffe, de ces coups d’éventailles qui se font de plus en plus amples, de ces gouttes de sueur qu’on renonce à éponger ; la peau brûlante presque fiévreuse que d’ordinaire on eut caché si la chaleur ne rendait pas insupportable le tissu. Ces ladys vivent dans le fantasme à la fois de cet ailleurs que constitue l’Angleterre, pour elles qui n’y sont pas retournées depuis leur mariage, et de cet ailleurs derrière leur porte, la jungle des chowk et des bazaars. Bref, la sensualité des femmes d’administrateur des colonies. Il enchaîne les tasses à café sur son rooftop dominant la ville avec cette âme de conquérant. Et elle, l’Américaine, à côté de lui ? Non, non, elle, elle est différente. « Ce n’est pas une femme ». C’est une aventurière, elle ouvre les voies dans l’Himalaya, traverse les déserts, force les portes du ciel. Elle, il ne pouvait l’aimer. Il pousse un cri. Sa mission est imbécile, il est envoyé ici uniquement pour bouger son corps à travers le sous-continent, faire acte de présence, représenter les « intérêts français » au sein du British Raj. Et il est bloqué ici à Bénarès, ce ne devait être qu’une semaine et… « Pourquoi je suis ici ? ». Un problème au sein de la Northern Railway Compagny, une grève longue et lente comme tout dans cette contrée, ou un glissement de terrain quelque part. Et par la route ? « N’en parlons plus ». Les British ont de plus en plus de mal à faire travailler les Hindous. Mais où est donc passé le carton d’invitation au cocktail du field grade officer ?
Son petit palace de Panchganga ghat l’ennuie, où sont les cafés, les restaurants ? « Mon empire colonial pour un verre de gewurztraminer » soupire-t-il. Il crie encore dans son délire sans couleur. Lorsqu’il descend à Chowk en quête de quoi se sustenter, il voit la foule des coolies tout habillés de blanc. Benjamin carbure au lait chaud à la cardamone, cela rend fort paraît-il. Il les boit dans un petit pot de terre par petite gorgée. Encore et encore, le liquide sucré lui coule dans la gorge tandis qu’il observe des chiens galeux copuler près de sa jambe. Le liquide lui coule dans la gorge, il sent la chaleur dans son estomac. Tous les chiens du quartier sont là avec leurs touffes de poils manquantes, la chair poudreuse à nue et leur sexe impudique. Il brise le pot en terre dans sa main, qui se met à saigner doucement. Les blessures saignent et cicatrisent doucement à Bénarès. Il fuit en évitant les couples de chiens errants, les vaches et les taureaux, les immondices. Il veut retrouver la blancheur du ciel allongé sur le Gange, la blancheur des pages de son journal de bord. Il envoie un jeune garçon – son strabisme est bizarre – habillé d’un long pagne beige brodé de fils de soie, il l’envoie lui chercher du paneer : il aime un fromage qui a l’aspect d’une éponge. Quand on le met dans la bouche, il absorbe tout. D’un coup le spleen disparaît dans cette blancheur immaculée. Le cocktail du field officer, la candeur des vapeurs sur le Gange près des tentes où des ladys sirotent des boissons sucrées ; frissons d’ombrelle. « J’écoute India song. Je suis venu aux Indes à cause d’India song » explique-t-il à un gars cherchant fortune dans le négoce des épices. Des gouttes de sueur se forment sur son front, puis elles coulent, il les sent, le creux de son cou, son sein, elles se refroidissent brutalement au niveau de son ventre, sur les chutes de ses reins. « Cet air me donne envie d’aimer ». Il tombe. L’Américaine le relève, elle chasse les interprétations qu’on lui fait de la maladie de Benjamin, non ce n’est pas le « syndrome indien », non ce n’est pas le fantôme du brahame. Elle n’y croit pas, elle refuse l’interprétation – ne pas mettre de mots - tout en regardant la face endormie du jeune français. Son visage est pur et endeuillé ; il n’a plus de teint, il est comme mort.
C’est la fête de la déesse Sarsvati, les hauts-parleurs hurlent des musiques criardes dans les ruelles étroites, une grande tente d’étoffe blanche a été dressée sur la place, devant la mosquée. Des hordes d’enfants s’époumonent, s’excitent « nau, aht, saht, chah, pach, çar, tin, do, ek… » (un, deux, trois, quatre, ….). Hurlements. Les chansons, les rythmes des tabla rebondissent sur les fenêtres du petit palace de Benjamin. Il trouve cela charmant - fêter la déesse des arts et de la poésie, les enfants, une kermesse de village – dans un premier temps. La musique du matin au soir : elle tape sur son crâne, encore et encore du lever du soleil à tard dans la nuit. Deuxième jour. Mais comment osent-ils faire cela à lui ? Ils savent qu’il habite là, lui et l’Américaine. Ils. Ils, il utilise le « ils ». Ils n’ont aucun respect, ils n’ont aucun savoir-vivre, ils honorent mal leur déesse. Mais qui ils ? Eux… Troisième jour. Le vice-consul est comme un fou. Non la déesse de la sagesse n’accouchera pas, il l’a bu dans une goutte de lait. Avalée, elle tape dans sa tête avec ses fidèles. L’armée de la déesse creuse des tranchées, donnent des coups de pioche à l’intérieur de son crâne. Le vice-consul descend de son Olympe, un fusil à la main. La douleur est trop forte, il va en finir avec la déesse et son armée. Le fusil se dirige sur sa tempe, et encore, la musique et encore les rythmes, ça lui explose la tête. Oui, il faut qu’il se fasse exploser la tête pour réduire à néant la déesse, trop de musique. Il va tirer, il tire… non ! Non, non, il n’y aura pas de chouette qui sortira de son crâne comme un grand soulagement. Ils sont là, devant lui, ils continuent les tabla, ils continuent à crier dans leurs hauts-parleurs. Pas dans sa tête, mais devant lui. C’est sur eux qu’il doit tirer. « Taisez-vous, je vous en supplie, taisez-vous ! C’est le vice-consul de France qui vous parle, taisez-vous...» hurle -t-il à la foule, sa chemise blanche ouverte. Il les pointe de son fusil – la foule regarde ce jeune cinglé, mais elle commence à avoir peur – l’homme blanc au fusil est dangereux. Ils le chassent ; derrière lui, ce sont des dizaines d’hommes ; des tikkas grises sur le front, leur longhis entre les jambes, une mèche de cheveux noirs sur leur crâne religieusement rasé. Ça court des bâtons à la main, c’est lui qui est chassé. Benjamin, c’est toi qui est le gibier de cette chasse à l’homme, court Benjamin, court et ne t’arrête jamais. La fin des privilèges, ton 4 août 1789, à bas le vice-consul, nique les comptoirs ! Benjamin court, passe sous des portes ouvragées, saute de toit en toit. Il se cache : « Mon dieu faut que je m’dirige vers la Mecque / mais bon… je suis de la pire espèce » souffle-t-il désespéré. Il s’endort.
0 notes
Text
Les Aventures de Benjamin Duronflan, chapitre 13 - La Mort d’un brahmane
posBenjamin descend les escaliers. Elle, elle ne sait pourquoi, est d’une extrême lenteur, elle observe les pieds vifs de Duronflan dégringoler les marches, avaler la distance qui sépare leur troisième étage du premier. Là, dans le patio, un homme d’une quarantaine d’années, celui qui parle un peu anglais, explique quelque chose à Benjamin avec un air grave et embarrassé. Et elle, par dessus l’épaule de son ami, elle le voit : le vieux Rajat Upadhyay est étendu au milieu de la pièce à vivre, le visage étrangement à l’horizontal, inexpressif et apaisé. Elle croise le regard de Sunita Upadhyay, sa femme, elle comprend. Elle voudrait lui dire, l’embrasser, la prendre dans ses bras « Oh ma chère Sunita, ma mère, ma sœur, je prends sur moi la douleur qui fait couler ces larmes sur tes jolies joues ». Elle ne peut pas, elle est comme enfermée dans ce corps, cette posture, cette langue d’Américaine. Elle maudit ces doigts blancs et potelés, ces incapables, maudit cette langue pataude. Benjamin n’a pas l’air de comprendre, elle le prend doucement par le bras et l’emmène à l’extérieur. Non, il n’a pas compris. Faut-il qu’il soit si différent de nous autres, communs mortels pour ne pas comprendre ce que la mort veut dire ? Il l’agace, quel égoïsme ! Incapable de reconnaître une famille endeuillée !
« - Mais Benjamin ! Il est mort ! - Il est mort ? - Oui, Rajat Upadhyay est mort. Décédé. Parti. Gone. »
Le jeune Français pâlit soudainement sous le regard scrutateur de l’Américaine. A quoi pense Benjamin Duronflan à présent ? Machinalement, il progresse dans la rue, il esquive un taureau, trois vaches et un chien pour arriver au tea-shop. Cette centaine de mètre dans les ruelles étroites du vieux Bénarès paraissent une éternité pour la jeune femme. Ce tea-shop est un simple réchaud posé sur l’accotement d’une ruelle, autour duquel se rassemblent toujours cinq à six hommes. Ils commandent deux chaï, Benjamin a de petites gorgées rapides comme des hoquets, comme des soupires. On peut, si on le regarde bien, voir se former des larmes dans le coin de ses yeux, qu’il avorte d’un rapide coup de paupière. Pleurer au tea-shop un homme que l’on ne connaît pas, non, non cela ne se peut pas, cela ne se fait pas. Lorsqu’ils repassent devant leur porte, il y a du monde, ils n’osent pas rentrer et redescendent alors vers les ghats.
Le jour s’estompe ; la lumière n’était pas très belle cet après-midi où le brahmane était mort. De quoi était-il mort ? Un problème de cœur. Sur le Gange, des lumignons au beurre clarifié flottent délicatement sur l’eau. C’est l’heure des pujats, mais à Pachganga ghat, Rajat Upadhyay n’est plus là pour le célébrer. Non à Pachganga ghat à cette heure, il n’y a que les grillons pour leur tenir compagnie.
Son corps allait être brûlé pendant la nuit, à Manikarnika ghat, le grand ghat de crémation. Là, un de ses fils se raserait la tête et s’habillerait en blanc pendant toute la période de deuil. Elle dure treize à quatorze jours. Tous les jours, des prières. Puis les derniers jours, plus de prière et des gâteaux de riz pour aider l’âme à retrouver un corps. Des brahmanes seront invités à prier pour lui. Pendant cette période de deuil, ils consommeront moins et éviteront les contacts physiques. Oui, mais alors ? Que pouvaient faire l’Américaine et Benjamin ? Que devaient-ils dire ? Offrir des fleurs, cuisiner un repas, préparer des cookies, prendre dans les bras Sunita, sécher ses larmes, faire le ménage… toutes ces choses qu’aurait spontanément faites l’Américaine lui semblaient déplacées voire un peu grotesques. Peut-être qu’elles l’étaient aussi en Amérique, chez elle, mais c’était l’usage. Une fois de plus dans sa vie, la mort la laissait sans aucun mot pour la dire : les mots d’ici, elle ne les connaissait pas et ce n’était les siens, et ses mots à elle, ils n’étaient pas les bons. Benjamin s’enfonçait lui dans un mutisme qu’il rompait parfois pour expliquer qu’il était « un peu triste ». Il semblait le cœur lesté de pierres grosses comme celles qui lestent les corps que l’on ne brûle pas, directement jetés dans le Gange parce que déjà purs, ceux des enfants, des saints et des mordus de cobra. Le Gange. Soudainement, Varanasi et ses fonctions mortuaires lui apparaissaient clairement, il avait entendu ces discours sur les rituels post-mortem… mais désormais, il y avait un nom sur ce corps que l’on brûlait, sur ces cendres que l’on allait répandre consciencieusement dans la mère-Gange, mère de la Terre, cours d’eau de tous les cours d’eau.
Quand ils regagnèrent leur troisième étage, le corps enveloppé dans des draps pourpres était exposé dans le patio. Sa famille l’encadrait dans la lumière des bougies et la fumée des encens, une piéta orientale dans ce clair-obscur. La maison entière suffoquait, comme si l’on tentait d’étouffer les pleurs par le manque d’air respirable. Se noyer dans les fumées. Du troisième étage, ils pouvaient voir distinctement le visage de Rajat Upadhyay, ce teint cireux de cadavre qui commençait doucement à lui faire pâlir les joues. Ils s’étaient faits les plus discrets possibles ; vers minuit, ils avaient entendu du bruit au premier étage, puis de longues plaintes et des pleurs dans la rue… puis le corps était parti au son des « Ram nam satya hai » (le nom de Ram est vérité) sur son brancard de bambous en direction de Manikarnika.
C’était cette nuit-là que le lit de Benjamin s’était mis à grincer. Sous une moustiquaire de tulle, deux vieux lits étaient rassemblés pour en former un grand, et soudainement, cette nuit-là le lit de Benjamin s’était mis à grincer. Si l’on précise ce qui peut paraître un détail, c’est que ce n’était pas un grincement ponctuel, non… Mais bien une plainte continue, suivant le rythme cardiaque du jeune homme. Parfois, quand le couinement se taisait, l’Américaine était soudain prise de panique : un problème de cœur, un autre. « Benjamin ? Benjamin ! ». Oui, il répond. Oui, il est vivant.
Leurs sommeils furent mauvais. Au matin, quand Benjamin se leva pour préparer le café à la cuisine, il vit la place vide dans le patio. Il commenta qu’il avait dû être emporté pendant la nuit, lorsqu’ils avaient entendu les pleurs. En allant faire des courses, à l’intersection de deux ruelles, Benjamin croisa un veau étendu au sol, la tête renversé et les pattes étendues. Son poil était souillé de bouse, sa chair immobile. Heureusement, il n’eut pas à l’enjamber et pressa le pas. Il fuyait, il voulait fuir cette ville de mort ; à la fois dans un ultime souci hygiéniste, mais aussi parce que cette dépouille lui sautait à la gorge comme un présage. Il fut froid et brutal avec les commerçants, hésita à s’arrêter prendre un chaï mais fut indisposé par l’odeur du lait en train de bouillir. La tête lui tournait, il voulait retrouver la douceur du lit et les bras blancs. Oui, pardonne-moi mon amour, je t’aime, j’ai besoin de toi, ici-bas. Je ne suis pas assez fort pour affronter seul l’existence, notre amour est l’Alliance. Scène-du-Deux pour se donner la force d’avancer, de bâtir, de transformer. Un amour stratégique contre l’existant. Oh… Une fois au troisième étage, il ne pouvait rien dire. Que s’était-il passé ? Incapable de dire quoique ce soit. « Le veau dort », « le veau d’or ? » « il lança les tablettes qu'il tenait en mains et les mit en pièces au pied de la montagne » « non… le veau mord » « le veau mord ? » « le veau mort ». Benjamin, la tête posée sur les genoux de la jeune femme, tenait ces paroles avec un air prophétique. Au fond de lui, il se réjouissait de l’intensité et de la profondeur de ses sentiments. L’Américaine décida qu’il était inconvenant de laisser libre cours à sa fossette ironique, et tout en plissant les yeux, elle méditait sur ce que bredouillait son prophète d’amant. La vache, ici, c’est Kamadhenu, l’abondance, la pureté et la fertilité, celle qui apporte le lait, celle qui contient tous les dieux. La mère. Alors le veau… la mort du veau, c’est sans mauvais jeu de mot un signe d’une période de vache maigre. Le deuil du brahmane qui s’étend sur la ville. Comme ce voile blanchâtre et poudreux qui recouvre le ciel, cette lumière grise.
Lorsqu’en début d’après-midi, elle rencontra Benjamin au bord du ghat, encore des larmes, des gémissements. Il était une longue silhouette blafarde au bord de l’eau… répétant « le petit chien, le petit chien ». Cette fois-ci elle comprit rapidement. Il eut un frisson lorsqu’elle lui prit la main, et reprit des couleurs. Si elle le laissait trop longtemps, il perdait des contrastes, tournait en nuances de gris. « Attention, cette nostalgie pourrait devenir délicatement coloniale » lui fit-elle remarquer. Elle voulut préparer une salade, un plat « frais et coloré » pour le ramener du « côté de la vie », « on ne le connaissait pas, après tout ». Toutefois, sa salade manquait d’une bonne huile d’olive et de vinaigre balsamique, ou au moins d’une vinaigrette. Il aurait aimé aussi une belle laitue. Bref, les tomates pâles et les concombres rabougris qu’elle avait dégotés sur le marché ne le sortir par de cette brume triste.
Le soir, elle retrouva Benjamin au tea-shop, prostré et complètement en noir et blanc. Elle hésitait : le cadre et le grain de l’image lui faisaient penser à ces vieux films ethnographiques des années 30 qu’elle avait vu une fois pendant un séminaire, mais l’attitude de son compagnon lui rappelait des images sépias des années 70 de hippies trop défoncés pour bouger au milieu d’une foule d’indiens curieux et perplexes. Il murmurait « le rat, le rat, le rat, le rat, le rat, le rat, le rat... ». Symbole l’errance de notre âme, ses turpitudes et ses erreurs, toujours à courir dans tous les sens. C’est la monture de Ganesh : sa tête d’éléphant domine la futilité l’esprit humain. « Mais qu’est-ce que ça veut dire, alors ? La mort du rat ? Non, cela ne veut rien dire, tu ne crois pas aux oracles. » se disait-elle tout en remettant d’une manière toute maternelle, des couleurs à Benjamin qui les perdait à toute vitesse.
0 notes
Text
Les Aventures de Benjamin Duronflan, chapitre 12 – Panchganga ghat
Dans le train, Benjamin avait appris le nom des quatre-vingts ghats de Varanasi, qu’il ânonnait depuis comme une comptine, tout en comptant machinalement sur ses phalanges. « … Manikarnika ghat, Bajirio ghat, Scindhia ghat, Sankatha ghat, Ganga Mahal ghat, Bhonsale ghat, Naya ghat, Genesa ghat, Mehta ghat, Rama ghat, Jatara ghat, Raja Gwalior ghat, Mangala Gauri ghat, Venimadhava ghat, Panchganga ghat… ». Pour elle, c’était comme une incantation, un long mantra que son compagnon lui récitait. « Panchganga ghat » répéta-t-elle. C’était le ghat où il et elle habitaient. Par l’intermédiaire d’un site internet très renommé en Europe mais assez peu utilisé en Inde, ils avaient trouvé à louer une chambre avec cuisine « chez l’habitant ». Les trois fenêtres de leur chambre s’ouvraient sur le Gange et une ancienne mosquée. Le troisième étage était leur domaine, et ils en sortaient assez peu. Le reste de la maison était habitée par la famille qui les accueillait, enfin la famille… pour dire vrai, ni l’Américaine, ni Benjamin n’arrivaient à comprendre les liens de parenté qui unissaient les personnes qui les avaient accueillis. Qui était par exemple, cette petite vieille dame aux yeux perçants qui leur glissait des secrets en hindi à la dérobée ? Son nom était Sarsvati, comme la déesse des arts et de la connaissance. Benjamin aimait cette femme, elle l’appelait « beta » (mon fils) quand elle le voyait. Elle lui parlait beaucoup, il ne comprenait pas mais acquiesçait d’un air complice jusqu’à ce qu’elle disparaisse avec son sari orange dans une pièce obscure de la maison où il n’osait l’accompagner. La maison était percée d’un petit patio carré qui laissait passer un peu de lumière aux étages inférieurs. Que firent l’Américaine et Benjamin pendant les deux semaines avant la mort de Rajat Upadhyay ? L’Américaine se le demanda souvent par la suite. Quand elle tentait de se souvenir des deux semaines qui précédèrent le triste événement, elle ne pouvait pas en dire grande chose. Les litanies de Benjamin « ...Dashashwamedh ghat, Prayag ghat, Rajendra prasad ghat, Man Mandir ghat, Tripura Bhairavi ghat, Mir ghat, Phuta ghat, Nepali ghat, Lalita ghat, Manikarnika ghat, Bajirio ghat... ». Encore et encore jusqu’à la folie. En réalité, ils étaient restés beaucoup dans leur lit. Ils écoutaient depuis leur chambre la religiosité bruyante et animée de Kashi, l’ancien nom de Varanasi. Ils lisaient, tous les deux lisaient beaucoup. Parfois, l’Américaine lisait des passages, des lignes, quelques mots qui lui faisaient penser à son compagnon.
« - Écoutes, c’est colonial, mais c’est drôle et ça me fait penser à toi. ‘Dans la véranda de sa case à Brazzaville, Par un torride claire de Lune, Un sous-administrateur des colonies, Feuillette les ‘Poésies’ d’Alfred Musset…
Car il pense encore à cette Chilienne Qu’il dut quitter en débarquant à Loango...’ - Je vois pas le rapport, répondait Benjamin sans quitter des yeux son Dumézil qu’il considérait depuis peu comme contenant tous les secrets à connaître sur l’Inde et sa spiritualité. - ‘-C’est pourtant vrai qu’elle lui dit ‘Paul je vous aime’, A bord de la ville de Pernambuco. - Tu te moques de moi… - ‘Sous le panka qui chasse les nombreux moustiques, Il maudissait ce rivage où l’attache sa grandeur, Donne un soupir à ses amours transatlantiques, Se plaint de la brusquerie de M. le gouverneur, Et réprouve d’une façon très énergique La barbarie des officiers envers les noirs…’ - En plus, ça se passe en Afrique, ça n’a rien à voir. - ‘Et le jeune et sensitive fonctionnaire Tâche d’oublier et ferme les yeux...’ »
Quoi de plus ? Quel serait le récit de ces quatorze jours ? S’il y eut de l’amour ? Oui, Benjamin était distant, pour la première fois depuis qu’il avait aperçu cette main à Jaisalmer, depuis qu’il avait ressenti ce trouble tout à la fois sensuel et moral, il éprouvait le doute. C’est peut-être pour cela que ces deux semaines sont l’histoire d’un silence.
« ...Bhonsale ghat, Naya ghat, Genesa ghat, Mehta ghat, Rama ghat, Jatara ghat, Raja Gwalior ghat, Mangala Gauri ghat, Venimadhava ghat, Panchganga ghat, Durga ghat, Brahma ghat, Bundi Parakota ghat, Lal ghat... ». Elle le voyait descendre : il allait au tea-shop ou bien philosopher sur les marches de la mosquée avec quelques libres penseurs hindous critiquant les temples et les livres saints. Ils dissertaient ensemble sur une religion de l’humanité et de l’amour. De la fenêtre, elle regardait la cour de cette grande mosquée de pierre rouge dominant le Gange avec ses trois grands bulbes couvert de cerfs-volants abandonnés. Tous les soirs, vers sept heures, un muezzin venait chanter l’appel à la prière avec pour unique sonorisation la large voûte d’une des trois portes de l’édifice. Il chantait seul ; la mosquée n’avait plus de fidèles, isolée dans ce quartier hindou. Une fois, elle avait entendu sa voix se briser, il avait toussé trois fois puis avait repris ses « Allah akbar » magnifiques.
Le quartier n’était pas un quartier que l’on eut pu dire bruyant, mais il en dégageait une musique caractéristique qui peuplait l’espace entre elle et lui, qui emplissait leur chambre en passant par les fenêtres ouvertes. La nuit est l’empire des grillons, puis au petit matin, les cloches et les tambours se réveillent. Ils animent la ville en continue, se faisant échos les uns les autres. « On dit que Vanarasi est le cœur battant de l’hindouisme », et cette pulsation chaque temple la joue comme à tour de rôle. Quand la chaleur dissipe les brumes du matin, quand les rues s’emplissent, alors les discussions des hommes et les rires des enfants. « Aoh, aoh ! Aoh, aoh » mais c’est là quelqu’un qui appelle les mouettes qu’on entend. Et ces hurlements euphoriques ? Probablement un match de cricket organisé sur la placette sous leurs fenêtres. Mais ce que Benjamin préfère par-dessus tout ce sont les cris des marchands ambulants. Oui, il y a là sous ces fenêtres, comme dans le Paris du Moyen-Âge, cet homme qui crie « Oyez mesdames, oyez ! Vieux papiers, vieux chiffons, j’achète à bon prix ! », ou encore les « « Rémouleur, rémouleur ! Repasse couteaux ! Repasse ciseaux ! ». Dans son imaginaire, Kashi était ainsi telle une ville médiévale européenne et il s’en régalait. L’Américaine lui aurait fait remarquer le caractère problématique d’une telle pensée, mais pendant ces deux semaines, il les gardait pour lui. Panchganga ghat s’étalait sur une petite pointe en de nombreuses plates-formes abritées sous des structures en bambous. Une longue série de marches très raides descendait depuis la mosquée jusqu’au ghat, il fallait passer entre deux temples pour l’atteindre. La pointe était le repère où les lutteurs faisaient leurs exercices et se baignaient dans le Gange. Plus au sud, des pères et leurs garçons allaient au bain en fin de journée, tandis que des vieillards profitaient des heures chaudes presque nus, écoutant la radio et profitant de leur ami Surya, le soleil, après leurs ablutions quotidiennes. C’était là où, en bon brahmane, Rajat Upadhyay avait célébré son pujat tous les matins. Là aussi où Benjamin allait faire son yoga le matin ainsi qu’un peu de méditation. Mais, un jour, Rajat Upadhyay était décédé. Cela n’était pas arrivé du jour au lendemain, mais cela avait tout changé.
0 notes
Text
Les Aventures de Benjamin Duronflan, chapitre 11 - Doon Express stream
Ce gars est vraiment un gros porc ! C’est pas possible de ronfler comme cela, no way, je vais te donner coup de pied dans les couilles, ça te calmera. Y a que les mecs pour faire un bruit pareil quand ça dort, faut vraiment avoir été éduqué avec l’impression que tout t’est permis pour se permettre d’empêcher de dormir un compartiment entier. Eh bro, tu crois que ton sommeil, il a plus de valeur que le mien bastard… Et pourquoi on est encore arrêté ? Damn it ! Entre l’autre connard et les sifflets des trains, je comprends pas comment l’autre fait pour dormir. On dirait un enfant, mon sublime enfant-saint. C’est ce qu’on appelle le sommeil du juste. Worst night of my life… A ça y est on repart. La lumière blanchâtre des gares indiennes et le tempo douceureux du Doon Express. Retour à Bénarès. Je ne sais même plus depuis combien de temps je suis parti, j’ai tout oublié. Oh, come on ! Fuck off! Bon, il l’aura voulu… Hu, hu… putain, qu’on est serré dans ces couchettes, et… tiens… shut up, ta gueule. Boom ! Oh, lord, ça marche : il ferme sa gueule l’enculé. Non, pas enculé c’est homophobe. La raclure. Une vraie raclure, avec sa jolie lohi blanche, sa barbe noire et son petit chapeau. Alors, ça te fait fermer ta gueule quand une meuf te défonce les genoux. Je lui ai mis un sacré coup, et il se réveille même… C’est vraiment, genre le mec il se sent tellement hégémonique que… mais genre, moi, y a un truc qui me touche pendant la nuit, mais c’est la guerre dans ma tête. Lui, non. Quoi que l’autre en dessous. Il a pas l’air mal non plus… Quoique peut-être que Benjamin ne dort pas. » « Benjamin… Benjamin... » Ah l’enfoiré, je suis seule… oh putain… non, non, no dude, come on, stop it. Stop it. Et voilà l’autre qui recommence… peut-être que c’est pour ça que dans la spiritualité indienne, les mecs ils veulent faire comme les pierres, à cause des enfoirés de ronfleurs du train. Et les autres, ils en ont rien à secouer. Normal, normal. Ca s’appelle de la pollution sonore ça, des pollutions nocturnes, hi hi… silly girl… Les gens ici, ils ont pas de sac de couchage, soit ils prennent leur lohi, soit ils apportent leur couverture en polaire. Et c’est pas des couvertures de… la moitié de leur bagage c’est la couv’ pour le train. Et si j’essaye de siffler. « Pffit pffitttt... » Oh, ça marche pas. Mon dieu, mon dieu, pourquoi m’as-tu abandonné… la route est longue longue longue, ronfle sans jamais t’arrêter, la route est longue longue longue, chante si tu es fatiguée. Moi aussi je peux casser les couilles, hein, je peux vous sortir tout mon répertoire de chansons. Ba ouais, y en a ils font des bruits de cochon, pourquoi je pourrais pas faire la cigale. Une putain de cigale qui va chanter toute la nuit, et demain, je vous demanderai de porter mes bagages parce que je serai fatiguée bande de connards. Le train. C’est. Fatiguant. Parfois. C’est. Aussi. Emmerdant. Et pourquoi c’est si lent, sérieux ? En même temps, c’est peut-être mon dernier voyage en train en Inde, qui sait ! Autant en profiter… en plus, ils ont fermé les volets des fenêtres. Ces volets, c’est des guillotines, faut faire gaffe quand on les ouvre. C’était sympa Rishikesh quand même, le mariage… qu’est ce qu’ils avaient l’air de se faire chier les mariés ! Ils invitent tout le village, y a tout le monde qui se régale, se ressert. Et vlà, des nans, et du dhal par-ci, des currys par là, et un peu de panneer. Oh… mais c’est qu’il y a des snacks par là-bas. Petit dosa, petit samossa. Hum, un petit samossa. Un café ? Ah ba, pourquoi pas, avec plaisir. Et Ben, qui squatte devant le stand de gâteaux… un petit lassi. Je sais pas comment malgré tout ce qu’on a mangé, on a réussi à danser… Tout le monde se pète le bide, après tout le monde s’éclate sur le dancefloor, même les meufs, c’est taré. Shit !Ah sa mère ! Nique ton père ! « Asshole, fucking Donald Trump ! ». Si tu vas pas te faire enlever les amygdales, je crois que c’est moi qui vais te les enlever avant la fin de la nuit. Le village entier, mêmes quelques touristes, passent une pure soirée et les deux mariés restent comme des poupées de porcelaine, ne se forçant même plus à sourire avec les relatives qui défilent pour prendre des photos. Keep your shit together darling, il lui dit, en mode, c’est que trois jours après on aura la paix et on pourra s’aimer… De toute manière, elle est tellement apprêtée que je pense pas qu’elle puisse danser avec ça. La chaîne qui rattache les boucles d’oreilles à la boucle de nez… oups, pardon, je vous ai arraché l’oreille en faisant un pas de danse sexy, en même temps, il y avait une chaînette qui ballottait sur votre pommette gauche… Ah, tient le contrôleur… Mais, mec, il est trois heures du mat’… Shit, c’est Ben qui l’a. « Ben, Ben, ticket ». Ah ! Ah ! Bien fait pour ta gueule ronfleur de merde, toi aussi tu te réveilles ! Si seulement, les contrôleurs, ils pouvaient être là pour contrôler le volume sonore des voyageurs… Dans une société sans classe où les transports seront gratuits, les contrôleuses, elles seront là pour mettre la misère aux mecs qui ronflent… Mais peut-être que les mecs ronfleront plus dans une société sans classe et sans patriarcat. Oh gosh ! Il ronfle plus ! Plus que le doux bruit du train. Ce bruit régulier tant aimé. Contrôleur, si tu m’entends dans tes pensées, sache que même si j’ai déjà chanté « plutôt chômeuse que contrôleuse », tu as une place dans le panthéon de mon cœur. Oui, cette nuit, t’es béatifié direct dans mon esprit. Et maintenant que les gêneurs ont été éliminés, maintenant que la nuit a pu enfin étendre son empire, maintenant que nous ne sommes plus que journey, trajet, mouvement, translation. Enfin, le sifflet de la locomotive peut prendre l’épaisseur des rêves…
… J’en suis déjà à mon cinquième chai, peut-être faudrait-il que j’arrête. Quand c’est pas Ben qui propose c’est moi. Les gars, ils ont compris le filon, ils ont qu’à passer et repasser dans notre compartiment et ils ont fait leur journée. Je me demande si les femmes boivent du chai, on en voit jamais dans les tea-shops. On sait pas, si ça se trouve, quand les maris ils carburent au chai all day long, elles, elles se font des gins tonic au masala en scred à la maison… Il y a quand même une sacrée ambiance dans ces gares, avec la brume blanche du matin. Les gars posés. Puis, hop hop qu’ils remontent quand le train repart. Petite gare de campagne. Il faudrait essayer une fois de descendre au hasard… Dans le compartiment, ils descendent tous à Lucknow. J’espère que personne ne remontera, c’est chouette d’avoir beaucoup de place… ça me rassure quand même, Benjamin a mal dormi, lui aussi à cause de l’autre salopard. Heureusement que Duronflan ne porte pas bien son nom, sinon, ça aurait été bye bye direct. Ok, petit-déjeuner. Biscuits, biscuits et… hé hé, cette fois, on s’est équipé ! Banane ! Hum… c’est pas mauvais, ça irait bien avec un petit… bon allez ! «Two chai, please »...
...Pasolini, il écrit avant d’arriver à Bénarès, il écrit : « Il faudrait avoir la capacité de répétition d’un psalmodiste médiéval pour pouvoir réaffronter, chaque fois qu’elle se présente, la terrible monotonie de l’Inde ». C’est marrant, il écrit ça quand il est en voiture, au milieu de la plaine du Gange, à peu près là où on est. Immense. Elle semble plus verte que lorsque j’étais partie de Varanasi… On pourrait dire un truc genre, la plaine du Gange, c’est l’endroit où l’immensité du ciel rencontre l’immensité de la Terre. Et ça produit quelque chose de désespérément plat. Ça ne change pas, ça ne changera jamais, alors forcément ça touche au désespoir. Pas possible de prendre de la hauteur, le monde des hommes est rampant, plaqué au sol dans la poussière par la lourdeur du ciel. Quoique non. Parfois peut-être mais pas là. Non, l’hiver indien donne au ciel une certaine légèreté, il est moins poudreux qu’à l’automne. Son évanescence n’est pas celle de la poussière mais celle des brumes fraîches. Ces brumes qui causent les retards de train d’ailleurs… On arrive bientôt, bientôt Varanasi, c’est drôle comme sensation, l’impression de rentrer à la maison. Une ville qui reste effroyable et familière en même temps. La vie est très émotionnelle là-bas… et Benjamin, la peste… il a beaucoup changé quand même. Mûri ? Non, non, non… juste qu’avant sa naïveté le rendait craintif et paranoïaque, aujourd’hui, elle le rend sublime et aventureux... chaque fois qu’on voit quelqu’un dans les champs, il est accroupi, seul… Le soleil orange et las, il met un temps interminable à se coucher. Tout s’étire. Le retard du train. Mes sentiments. Il y a quand même une réelle mélancolie dans ces étendus de champs, des champs de quoi ? La famille qui s’est installée, ils ont tous une bonhomie bourgeoise fort charmante. Les enfants font leurs devoirs, il y a une étincelle de fierté dans le regard du père ramenant sa « tribu » au foyer après des vacances dans la famille. La tendresse de la grande sœur. Un vol de petits échassiers, blancs. La mélancolie, elle prolonge mes doutes, cet étrange sentiment à Rishikesh. On dirait des fleurs dans les champs quand ils sont posés, minuscules tâches blanches dans le vert. Quand le soleil est presque couché, la lumière prend une teinte violette, c’est un peu l’heure de l’attente, l’attente de quelque chose. Du marin de Gibraltar qui viendra me chercher au bout du monde. Et lui, là, au-dessus de moi, sur sa couchette. Il ne vient pas de Gibraltar, il est français. Le marin de Gibraltar n’est pas espagnol… Mince, je ne me rappelle plus. Parfois, je me demande si cet homme qui voyage avec moi existe vraiment, ou s’il n’est pas le fruit de mon imagination. Un amant imaginaire, improbable. Hi hi… comme ça je me sens plus intelligente, face à cet idiot. Prince des idiots aux yeux tout délavés. Avec ton âme qui n’a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Amour gloire et beauté. Oui, oui et oui. C’est mon personnage de feuilleton personnel, à moi.
« - Benjamin, t’es là ?
- Oui, je crois. Pourquoi ?
- Non, non, juste pour être sûr. Tu trouves pas que c’est un peu mélancolique comme paysage.
- Oui… vraiment. Mais, c’est pas triste.
- Non, c’est pas très triste. »
0 notes
Text
Les Aventures de Benjamin Duronflan, chapitre 10 - Exercices spirituels
Rishikesh s’étire à l’entrée d’une petite vallée où coule le Gange, où les contreforts de l’Himalaya s’ouvrent pour le laisser s’en aller dans la plaine qui porte son nom. Il y a une petite ville, puis en remontant le long du fleuve, deux villages qui sont les cœurs spirituels et touristiques de la ville. Le Gange, ici, n’a pas la couleur brune qu’on lui connaît à Bénarès ; il est d’un vert-gris et d’un aspect minéral qui nous rappelle les glaciers himalayens dont il est issu. Dans cette petite vallée se trouvent des centaines d’ashrams, lieux souvent dirigés par un baba, un saint homme et accueillant des personnes pour des retraites spirituelles. Cela explique pourquoi la ville est devenue aussi une capitale mondiale du yoga et de la médecine ayurvédique ; titre que la ville exploite abondamment puisqu’elle est presque exclusivement dédiée à ces deux activités. Toutefois, c’est aussi un lieu de pèlerinage où se rende beaucoup d’Hindous venus de l’Inde entière. Il n’est pas rare de voir des bus de vieux Rajasthanis avec leurs turbans et leurs oreilles percées, traversé les fiers ponts himalayens pour se rendre dans quelques temples et autres lieux saints.
C’est donc dans cette ville que l’Américaine et Benjamin arrivèrent avec la ferme intention d’y rester un mois et demi. De nombreux voyageurs leur avaient vanté les mérites et l’atmosphère détendue de Rishikesh. Rapidement, ils avaient trouvé un ashram où séjourner, les lieux étaient habités par un baba, trois ou quatre disciples et deux amis russes semblant étonnamment dévots. Benjamin était surexcité par l’idée de vivre avec ces saints hommes : il voulait assister à tous les pujats, ne rater aucune classe de yoga et pratiquer abondamment la méditation. Sa compagne, plus réservée, trouvait « l’expérience » intéressante et observer cela avec ses lunettes d’anthropologue du dimanche. Le matin et le soir, le petit Drom Puri, âgé de 11 ans se peignait un tikka sur l’intégralité du front, allumait le feu puis sonnait la cloche et soufflait dans la conque, appelant les autres habitants à la cérémonie. Tout le monde allait alors dans une petite hutte un peu au-dessus de la maison dans laquelle se trouvait un foyer pour le feu ainsi que plusieurs lingams et icônes religieuses. Tous pouvaient s’asperger de fumée d’encens avec un petit geste harmonieux des deux mains au-dessus de l’encensoir. Le jeune baba posait alors solennellement un tikka sur le front de tous les participants puis chantait quelques mantras en attendant que le guru arrive. C’était souvent le moment où chacun pouvait se faire passer le petit miroir et admirer son tikka, enlever un peu de couleur tombée sur le bout de son nez, voire replacer sa mèche pour mettre en valeur sa nouvelle parure. Lorsque le maître arrivait, ceux qui ne l’avait pas vu le saluaient en lui touchant les pieds ou les jambes, puis tous le regardait se peindre un tikka compliqué sur le front. Benjamin suivait tous les mouvements à la lettre, imitant scrupuleusement les autres disciples. Rapidement, il avait même fait du zèle et avait apporté de petites offrandes, il se prosternait pendant plusieurs secondes devant les icônes de Shiva et Parvati… L’Américaine au contraire faisait le minimum nécessaire pour rester, il lui semblait, respectueuse : toucher les pieds de ce vieil homme aurait selon elle était une comédie ridicule, respectueuse ni pour elle ni pour lui. Une fois le guru prêt, on se faisait passer des « missels » contenant des mantras et l’on suivait le guru dans son chant. L’Américaine se rappelait d’un moment particulièrement cocasse où soudainement, ils s’étaient tous levés et avaient fait un tour sur eux-mêmes avant de se rasseoir aussitôt pour méditer quelques minutes tout en se bouchant les narines. Elle se sentait idiote, à imiter ces gestes, à la traîne… Son ami était fasciné, il lui chuchotait « tu sais, j’ai toujours été mystique… ». Il ne lui semblait pas ridicule, elle admirait sa façon de vivre ces moments avec intensité, sans réfléchir. « Tu épouses l’instant, il n’y a pas de pensées entre toi et les choses » lui racontait-elle ensuite. Elle prenait des notes dans sa tête, tout cela la renvoyait à elle même, elle s’énervait. La cérémonie terminait presque toujours par un même mantra :
Om, je ne suis ni esprit, ni intelligence, Ni les oreilles, ni la langue, Ni l’odorat, ni la vue, Ni l’éther, ni l’air, Je ne suis ni souffles, ni organes, ni les mains, ni les pieds, ni la langue, ni le mouvement. Je suis l’extase et la conscience. Je suis Shiva! Ni peur, ni avarice Ni ignorance, ni préférence, Ni ego, ni devoir ni libération, Ne suis ni désir ni désiré N’ai ni plaisir ni haine, ni vertu ni vice, ni mantra ni chapelle, ni de Védas ni de sacrifice. Ne suis ni le mangeur, ni le repas. Je suis l’extase et la conscience. Je suis Shiva! Je ne connais ni la peur ni la mort ni ‘caste ‘, ni père ni mère, pas de naissance, ni ami ni camarade, ni disciple, ni gourou. Je n’ai ni forme ni besoin, j’existe partout, au-delà des sens, inconnaissable. Je suis l’extase et la conscience. Je suis Shiva!
A elle, cela lui rappelait la théologie négative chrétienne, celle qui dit Dieu n’est ni cela, ni cela, et sa mystique qui se sait vouée à l’échec. Lui n’était pas enchanté par les traductions, il ne voulait pas penser mais se faire bercer par ses sons, ses mélopées qui agissaient doucement sur tous ces sens comme une incantation magique. Le guru était un prosélyte délicat : il invitait ses hôtes à participer, mais ils pouvaient prier pour le dieu qu’il voulait. De toutes manières n’étaient-ils pas tous des manifestations différentes d’un même principe divin ? De la puissance de Shiva, ajoutait-il doucement… Il prenait soin de ses hôtes, leur traduisait des mantras, prodiguait modestement sa sagesse tout en confessant que le chemin vers la vérité était solitaire et très très long et que lui-même ne savait encore rien.
Elle était un peu sombre : une sorte d’inquiétude liée à son insatisfaction, son inconfort… Elle voulait s’efforcer à goûter à sa manière à la spiritualité des lieux, par une ascèse discrète. Quand Benjamin dormait paresseusement jusqu’au pujat du matin, elle se levait tôt avant le lever du soleil. Elle s’enroulait dans ses châles, ses écharpes, ses jupes à fleurs et ses chaussettes en laine sous ses sandales en cuir et sortaient de leur chambre dans le froid du matin. Elle affrontait les vents venus des montagnes qui s’engouffraient dans la vallée, elle sentait qu’ils prenaient leurs origines sur « le toit du monde » comme on dit. L’Américaine aimait sentir ses joues rougir avec le froid et attendre le soleil et sa chaleur émerger soudainement de derrière les montagnes. Le chemin depuis l’ashram menait à Lakhsam Jhula, le pont suspendu du second village. Sur la petite place, elle s’asseyait au milieu d’un groupe d’hommes dans un tea shop. Ils étaient riants, et la vue de cette Américaine de si bon matin les amusait, elle aussi. Elle commençait à avoir l’habitude de ces regards, insistants et curieux, rarement menaçants. Il y a si peu de femmes dans les rues en Inde, du moins dans le nord. Elle se rappelait les conseils d’une voyageuse : toujours porter une alliance autour du doigt, l’institution du mariage est très respectée dans la plupart des pays, et en cas de danger, hurler. Surtout en Inde, au milieu de nul part, il y a toujours quelqu’un. Partir tôt le matin, c’était aussi une manière de fuir un peu Benjamin. Ils vivaient si différemment cette expérience, avaient des rapports à la spiritualité si différents que cela les rendait comme opaque l’un à l’autre. Non pas qu’habituellement ils se comprenaient véritablement, non. L’un restait toujours un mystère pour l’autre, cependant ce mystère était le moteur d’une vie drôle et aventureuse, de découvertes et de fous rires. Mais là… pour l’Américaine, la spiritualité touchait à quelque chose de trop intime et de trop trouble. Tandis qu’elle pensait à cela, elle se moquait d’elle même : « voilà que je fais dans l’ineffable » se disait-elle. Il fallait qu’elle le dise à Benjamin, qu’elle lui explique qu’elle allait partir…
Lorsqu’elle rentrait, elle assistait malgré tout au pujat du matin, puis suivant le cours de yoga sur le toit. Le guru passait ensuite de longues minutes à lui parler, il disait qu’il savait qu’elle était intelligente, mais qu’il y avait des choses que son intelligence ne pouvait pas comprendre. Elle hésitait, devait-elle entrer en débat avec lui, ou faire comme ses disciples et boire tranquillement ses paroles comme elle sirotait le bon café qu’il lui avait offert… En réalité, les discours sur les vérités intérieurs à découvrir et les quêtes de soi, de « pleine conscience » l’ennuyait. Elle ne croyait pas en l’existence d’une vérité unique, elle ne pensait pas que l’on pouvait se trouver soi-même. Avec ce mélange jésuite de psychanalyse, de social sciences et de christianisme avec lequels elle s’était formée intellectuellement pendant ses années à Brooklyn, cette idée d’un moi à trouver, cette sorte de suprématie de la conscience ne la convainquait pas. Elle trouvait cela puérile, même si elle se répugnait à le penser. « Mon regard de petite intellectuelle américaine sur les pratiques religieuses de mes hôtes est un bon regard colonial... » se faisait-elle remarquer. Cependant, si les discours de leur baba ne la convainquait pas, c’était aussi parce qu’elle savait qu’ils étaient profondément appauvris par cette « transmission touristique » : tout ce qu’il lui disait, elle l’avait déjà entendu dans des communautés new age sur la côte ouest… Elle les trouvait très individualiste et, au fond, libéraux. Pour elle, la spiritualité était inséparable du surgissement d’une altérité radicale, de la naissance d’un désir. Pas une paix ataraxique mais bien une expérience violente qui arrache la personne à elle-même. Se noyer dans la complexité du réel par sa contemplation et éprouver cette complexité par l’action. L’action : elle ne voulait pas être comme « la pierre » qu’un sadhu disait prendre pour modèle, elle voulait agir, battre l’oppression. Sa pierre à elle, c’était celle qu’on lançait de Paris à Gaza, du Caire à Ferguson. En bref, sa spiritualité était inséparable d’une morale : parce qu’il y avait de l’action, et parce qu’il y avait de l’autre. L’Autre, cette transcendance. Et elle savait pertinemment que, dans l’hindouisme aussi il existait des morales normatives que leur passeur de spiritualité laissait de côté. Ces réflexions lui étaient à la fois douce, cela faisait longtemps qu’elle n’avait pas pensé comme cela, mais la rendait aussi mélancolique. Elle se sentait seule, loin de chez elle, loin de ceux avec qui elle pouvait dire des choses comme « la mystique, c’est la caresse aveugle de l’amant dans l’obscurité de la nuit». Ses doigts blancs passaient le reste de ses journées à tourner les pages de son roman, ou faire glisser son stylo à encre sur un cahier d’écolier. Elle se sentait profonde, et elle l’était.
Benjamin était affamé, il l’emmena dans un petit restaurant au bord du Gange, le Ganga Beach. Elle commanda un thali et lui, un plateau de légumes grillés. Il était immense, les légumes colorés se superposaient dans la pureté de leurs saveurs. Il dévora, et recommanda des momos. Depuis son départ du Népal, il n’en avait pas mangés de bon, peut-être que le retour vers les montagnes lui ferait retrouver le goût de ces petits raviolis à la vapeur… « - Écoute, Benjamin, on avait prévu de rester longtemps ici mais… - Oui, oui, je suis désolé, il faut que je parte, la coupa-t-il avec un air gêné avant de poursuivre. Et j’aimerais que tu viennes avec moi. Je voulais te le dire depuis hier. - Pardon ? s’exclama-t-elle aussi amusée qu’étonnée. - Oui… j’ai trop froid. - Quoi? - Oui, j’en peux plus, j’ai tout le temps froid. Au réveil, pendant le pujat, le yoga, le repas, la sieste, la promenade… même quand le soleil sort de son trou, je n’arrive pas à me réchauffer, avoua-t-il. Je suis désolé, on voulait se poser, mais là, c’est pas possible. »
L’Américaine le regardait : elle ne comprenait vraiment rien à ce personnage. Elle n’aurait pas à lui expliquer les obscures raisons de son malaise ici qu’il n’aurait de toute manière pas compris, et avec ces dernières paroles elle retrouva ce qu’elle aimait chez lui. Avec son plus américain des accents, elle lui souffla amoureusement : « Monsieur Duronflan, je vous adore ». Un sourire fendit le visage du Français, il était adorable. « Quel gaîté » se disait-elle tandis qu’il lui proposait d’aller faire un tour de scooter en montagne. Ils réglèrent leur addition, et filèrent sur une route secondaire remontant vers le nord le long du Gange. La route est mauvaise, sinueuse et ils n’ont plus beaucoup d’essence. Ils avancent donc doucement dans les dernières lumières de l’après-midi. « S’en aller tous les deux, dans le sud de l’Italie, et voir la vie en bleu, tout jouer sur un paris... » chante à tue-tête Benjamin. L’écharpe de l’Américaine vole dans le vent, qu’ils sont beaux tous les deux. Qu’ils sont libres et amoureux : demain, ils vont reprendre le train et s’en retourner à Varanasi, la ville de leur rencontre, et pour le moment, ils profitent des paysages de montagne sans plus ne penser à rien. Les petits yeux de l’Américaine brillent au milieu de son visage rond ; ses pommettes qu’on devine très blanches habituellement sont brunes de soleil et de voyage. Benjamin lui trouve une douceur slave, bien qu’elle lui ait expliqué que ses lointains ancêtres étaient irlandais. On entend un la mélodie d’un klaxon. « Oooh putain, un bus ! » s’exclame Benjamin joyeusement. Le petit scooter croise le car dans un virage, Benjamin freine un peu brusquement, la roue dérape. Le petit scooter rouge est au sol, ses deux passagers eux aussi. L’Américaine se relève rapidement, elle n’a rien. Le jeune homme se tortille lentement pour se lever malgré ses membres endoloris ; il claudique tout en regardant le précipice auprès duquel ils ont glissé. Le conducteur du bus est venu voir s’ils ont besoin d’aide, il est remercié. Cela va aller. « Cela va aller, demain, nous retournons à Varanasi, ville de notre rencontre. Rishikesh nous fait l’effet d’une ville mesquine aux passions molles et tristes, en un mot, tout cela est commun. Nos vies sont trop courtes pour cette tempérance bien libérale, bien propre… Nous allons à Varanasi parce que c’est une ville noire et blanche, où chaque couleur doit payer un tribut, parce que c’est une ville tragique. Le sacré et le croupi, la grandeur et la décadence. Oui, oui, demain, nous reprenons le train.»
0 notes
Text
Les Aventures de Benjamin Duronflan, chapitre 9 - Idylle à Delhi
« Ce mot fut dit avec un accent si vrai, avec une intimité si tendre ; il montrait tant d’amour, qu’avant qu’elle y songeât, les yeux de madame de Chasteller, ces yeux dont l’expression était profonde et vraie, avaient répondu : « J’aime comme vous. » Elle revint comme d’une extase, et, après une demi-seconde, elle se hâta de détourner les yeux ; mais ceux de Lucien avaient recueilli en plein ce regard décisif. Il devint rouge à en être ridicule. »
L’Américaine-aux-mains-blanches-et-potelées avait accueilli les confessions du jeune Duronflan avec compassion, sentant la douleur excessive qu’elles lui provoquaient. Il l’avait cherché toute la journée : heureusement, la ville n’était pas grande et il avait pu se confondre en excuses. Si ses yeux avaient répondu « J’aime comme vous », lorsqu’elle y songea, elle trouva sa situation étrange et un peu inconfortable. Elle avait beaucoup d’affection pour le jeune français, ,mais la passion de celui-ci le rendait dans un même mouvement beau, ridicule et un peu ennuyeux. Toutefois, lorsqu’il la supplia de quitter cette « ville terrible » (Jaisalmer, ville de tous ses péchés) avec lui, elle accepta. Elle n’était pas amoureuse, mais la compagnie de Benjamin (elle disait « Benjamine ») ne lui était pas désagréable ; elle se moquait gentiment de sa bêtise, et surtout, il la sortait d’une certaine solitude et mélancolie qu’elle éprouvait après plusieurs mois de voyage. Ils quittèrent Jaisalmer pour Delhi.
« Delhi. Main Bazaar. Cet endroit ne dort jamais, la foule, les vendeurs de street food, les panneaux lumineux. C’est La Ville. Ça grouille, urbain. Les panneaux lumineux à n’importe quelle heure. Je ne pensais pas trouver une ambiance hip-hop à Delhi, et pourtant, c’est ça que j’y trouve. Main bazaar a ce type d’activités sans trêve et sans pitié. Jungle humaine où tout est possible. Je ne voudrais être l’homme qui ne peut s’appuyer sur une amour humaine ici ‘amour’. Les niveaux inférieurs de Connaught place, les tatoos shops où je me suis fait percer les oreilles.
20/01/2017 New Delhi, grande mosquée. Les marches rouges foncées. Le mendiant qui mendie pointant le ciel du doigt. Il a une barbe tordu comme la queue du diable, des yeux perçants comme des oracles sous son petit bonnet vert kaki. Il tend le bras, légèrement courbé comme au théâtre. Il montre le ciel aux fidèles qui passent devant lui, l’index levé, un regard sombre ; entre l’homme qui demande pitié et celui qui présente le jugement de Dieu. Parfois, il se caresse la barbe.
Quelques femmes intégralement voilées en noir. Des enfants en kurta-pajama, longues chemises blanches et pantalons larges, jouent au cerf-volant dans la mosquée, sur l’esplanade intérieure. Les patangs (cerfs-volants) se mêlent aux oiseaux dans le ciel blanchâtre. Comme dans toutes les mosquées du monde : des robinets. Des femmes aux voiles en laine, noirs et brodés de motifs floraux. Bijoux sur les oreilles et les narines. Certaines montent les marches avec difficulté, lourdement, une jambe après l’autre et le souffle court.
Jeune, veste en cuir, basket jaune. Selfie avec ses amis. »
Journal de Benjamin Duronflan, vendredi 20 janvier
Elle et lui passèrent ainsi trois jours dans la capitale, flânant dans les rues agités et bondées du Old Delhi. Elle n’appréciait pas beaucoup cette ville si densément peuplé, si bruyante… elle se disait qu’il fallait vraiment vivre dans un autre monde comme le faisait Benjamin pour réussir à « flâner » dans cette ville, avec les connotations de légèreté et insouciance qu’on attribue communément à ce terme. Marcher dans le vieux Delhi signifiait avant tout s’adonner à un constant travail d’esquive des rickshaws, vélos, mobylettes, motos, voitures, charrettes à bras, vaches, brouettes… qui circulaient dans le centre. Benjamin le faisait avec un naturel étonnant et s’amusait comme un enfant de voir tout le monde autour de lui « porter des trucs » comme il disait. Il se sentait bien et souvent, l’Américaine l’abandonnait au milieu d’une rue pour rentrer à leur hôtel en rickshaw tandis qu’il continuait ses dérives dans le labyrinthique vieux Delhi. Pour fêter « cette vie nouvelle et leur amour », il avait décidé de se faire percer les oreilles comme un vrai rajasthani. Lorsque sur le chemin, un rabatteur avait tenté d’entraîner Benjamin dans un faux office du tourisme, le Français tenta un « chuis de la maison » amusé, mais le rabatteur ne comprit pas, et Benjamin dut utiliser une méthode plus traditionnelle pour se débarrasser de son homme. Benjamin planait encore plus que d’habitude, savoir que l’attendaient ces mains blanches et potelées chéries à son hôtel le rendait presque encore plus joyeux que de les voir pour de vrai. Sa passion exacerbait sa sensibilité : ses joies étaient plus vives et ses colères plus prononcées ; il distinguait mieux les odeurs à tel point qu’un passage au marché aux épices devenait un véritable envoûtement, tandis que celui devant les nombreuses pissotières qu’on trouve dans les rues de Delhi lui provoquait immanquablement un haut-le-cœur. Leur relation était faite d’un étrange jeu d’observations réciproques, et de finalement assez peu de communication. Elle s’amusait à observer Benjamin, à trouver de la poésie dans sa bêtise et sa naïveté, tandis qu’il la regardait avec le feu d’un idolâtre face à ses icônes. Le soir, il leur arrivait d’aller boire une bière dans un bar de main bazaar, la musique était bonne et l’on diffusait des matchs de cricket sur un téléviseur et des images de guerre sur l’autre. Il y avait un panneau qui indiquait que l’alcool ne pouvait être vendu au moins de 25 ans, les deux amants – pouvons-nous dire amants ? - n’avaient pas l’âge mais personne n’en avait cure. Ils prirent aussi des cocktails aux noms plein de fautes d’orthographes cocasses (comme le sex of beach) surtout parce qu’ils trouvaient ça drôle, Benjamin n’aimant pas spécialement les cocktails.
Au bout de trois jours, l’Américaine-aux-mains-blanches-et-potelées voulut quitter l’épuisante Delhi, et Benjamin Duronflan voulait aller à Rishikesh, capitale mondiale du yoga rendue célèbre par un voyage spirituel des Beatles en 1968. Le voyage n’était pas long pour rejoindre les contreforts de l’Himalaya où se situait la bourgade, ils y furent vite arrivés.
0 notes
Text
Les aventures de Benjamin Duronflan, chapitre 7 - Benjamin et les bactéries
Après ses aventures dans le fort d'Amber à Jaipur, Benfjamin avait fui la ville en prenant un bus de nuit. Il appréciait ces voyages de nuit, les arrêts nocturnes pour boire un chaï, la complicité silencieuse qu'il partageait alors avec les autres voyageurs. C'était finalement une des rares expérience qu'il partageait d'égal à égal avec les Indiens.
Bref, il arriva à Udaipur au petit matin. Il prit un rickshaw qui le mena près du lac, à travers les petites rues blanches et sinueuse qu'il voyait bleuté dans la lumière du matin. Le lac Pichola léchant le pied des palais qui s'étendent le long de l'eau l'émerveillait de calme et de beauté. Benjamin se rappelait ainsi doucement qu'on disait Udaipur la ville la plus romantique du sous-continent, tout en se dirigeant vers la seule échoppe ouverte à cette heure-ci pour aller déguster un thé près du lac. « Ce soir, c'est la nouvelle année » se disait-il, ravi d'être dans un endroit à la beauté si touchante pour le réveillon. Il trouva une guest house agréable avec vue sur le lac, il profita du lever du soleil allongé sur de moelleux coussins. « Tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté » se murmurait-il, observant des singes sauter sur le toit d'un vieux temple qui ressemblait à une meringue sculptée, dressée vers le ciel, le lac brillant de soleil en fond. Les mêmes singes à têtes noires qui l'avaient détroussé deux jours avant ; Benjamin eut un petit rictus avant de replonger dans sa rêverie poétique. Au milieu du lac, se tenait un palais au ras des flots. Il n'était pas très haut mais était comme délicatement allongé sur la surface du lac, un corps blanc ciselé d'arches et de fenêtre, inaccessible. Face à lui, sur la rive, un autre palais, le city palace s'appuyait contre la colline, les pieds dans l'eau. De loin, on aurait dit un grand immeuble de couleur ocre, mais en se rapprochant, on pouvait percevoir ces enchevêtrements de dentelles de pierre, d'arabesques, de fenêtres, balcons et colonnades. La demeure des rois mewars avait-il appris. Il se promenait ainsi le long de petits ghats ombragés par de grands arbres, où des hommes faisaient une toilette matinale. Il se sentait heureux et détendu et malgré quelques crampes d'estomacs, il se mit en quête d'un « bon resto » où « manger un bout » comme il disait. Il voulait trouver un endroit avec vue et s'installa à la table d'un petit restaurant à la déco branché, de la pop hindi passait en fond sonore. Le tout était assez « lounge » et il aimait cette impression. Il attendit plus d'une demi heure avant de voir quelqu'un arriver. Ce fut un groupe de touristes indiens qui lui firent comprendre qu'il ne pourrait avoir à manger ici, puisqu'il était dans un bar n'ouvrant qu'à partir de la fin d'après-midi. A la vision du regard déçu de Benjamin, le groupe qui venait en réalité de se rencontrer dans leur auberge de jeunesse quelques minutes avant, proposa à Benjamin de se joindre à eux. Ils avaient la vingtaine, comme lui, et appartenaient aux classes supérieures de Pune et Mumbai et surtout, affichaient un air heureux qui plut tout de suite à Benjamin. Et c'est ainsi qu'il trouva une « soirée » pour le nouvel an, après avoir passé une grande partie de l'après-midi à déguster des mets indiens ponctués de franches rigolades. Le soir, ils avaient décidé de se rendre dans une soirée très privée, videurs à l'entrée et invitation nécessaire. Comme il était en short, il avait peur de se faire « refouler » mais décochant son plus beau sourire, et grâce à sa nouvelle petite moustache qu'il s'était taillé quelques heures avant, il accéda sans trop de difficulté au dance floor. Benjamin qui s'attendait à entrer dans un club très select se retrouva finalement dans une fête qui lui faisait plutôt penser aux booms de ses années de collégien. Il n'était cependant pas dans un garage, mais bien sur le toit d'un hôtel avec vue sur le lac, les palais et les lanternes qui s'envolaient dans la nuit. Il dansa beaucoup et fit un nombre assez démesuré de selfies avec des gens qu'il ne connaissait pas. Il apprit les danses du Punjab et de l'Uttar Pradesh, puis insista pour que le DJ mette sa chanson préférée. Lorsque « Femme Like U » passa, il annonça fièrement à ses nouveaux amis « it's a French song ! ». Il dansait ivre de la joie du nouvel an, chantant à tue-tête « donne moi ton Corps babé ton Coeur babé, donne moi ton bon vieux Rock ta Soul babé, ta Funk babé, chante avec moi je veux une Femme, like U pour m'enmener au bout du monde ».
Après un petit feu d'artifices, quelques embrassades, tout le monde descendit au rez-de-chaussée pour un buffet. Il bouscula tout le monde pour accéder aux différents currys et remplir son assiette. Une fois terminée, ses crampes d'estomac reprirent avec une intensité qui ne lui permettait plus ni de danser ni de sourire sur les selfies, et puis de toute manière, la fête était terminée. Il s'éclipsa dans sa chambre pour profiter pleinement de la douleur qui lui transperçait le bas-ventre. Il se massa dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tout en chantonnant « Je vais prendre ta douleur… ti ta ta ta ta ta, tou tou ta ti ta ta ta je vais prendre ta douleur... ». Il sentait les bulles de gaz dans ses intestins, il s'amusait à distinguer les zones plus liquides et les autres. Ses abdominaux dorsaux étaient aussi étrangement endoloris, et il commençait à regretter les plats délicieux mais gras qu'il avait goulûment engloutis au buffet. « Bonne année » siffla-t-il entre ses dents, amère, tandis qu'il se tordait sur son matelas. Pendant la nuit, il ne dormit pas beaucoup et se leva souvent.
Le lendemain, le corps de Benjamin n'était qu'un grand champ de bataille dont l'épicentre se situait dans son bas-ventre. Les dieux s'affrontaient en lieu et place de son intestin : Benjamin implorait Shiva de vaincre les démons qui l'envahissaient jusque dans les hauteurs de son œsophage. « Vade retro » cria Benjamin alors qu'il entrait pour une énième fois dans les lieux d'aisance. Il resta toute la journée dans ce demi-délire stomacal, avalant à intervalles plus ou moins réguliers des médicaments aux noms latins, se palpant le corps de ses doigts fins pour tenter, par hasard, de toucher un point énergétique que la médecine ayurvédique connaît si bien. Pour repas, il se contraignait à une ascèse sévère, tout en étant attentif à ne pas se déshydrater. Il vidait ainsi des bouteilles de Coca-Cola les unes après les autres, profitant à chaque gorgé du liquide poisseux et brun, de son sucre et de son gaz. Régulièrement, il engloutissait à petites bouchées des bols de riz que lui amenait sa logeuse. Malgré ce régime, ses tripes ne lui laissaient pas une minute de répit : quand son ventre n'était pas mou comme du beurre au soleil, il devenait dure, buste contracté comme une statue de bronze. Son angoisse quant à sa maladie ne faisait en outre que ne rendre plus compliqué son transit. Le matin suivant, il s'était décidé à se rendre à l'hôpital, il était en effet inquiet de la « cochonnerie » qu'il avait pu « chopper ».
Sa logeuse le cala dans un rickshaw et l'envoya à l’hôpital privé le plus proche. Il la remercia beaucoup pour tous les soins et la gentillesse dont elle avait fait preuve ; il enlaça cette femme, son sari, son embonpoint, son sourire, ses boucles d'oreilles, son accent tranquille quand elle parlait anglais, sa manière simple et raffinée de cuire le riz blanc… la douleur lui faisait apparaître cette femme comme comme un ange venu du ciel, son sari lui rappelait le voile bleue de la vierge Marie… La route cahoteuse lui fit revenir à la réalité, la rédemption n'était pas pour maintenant, et chaque nid de poule était une étape d'un long calvaire. « Comme la croix du Christ sur Simon de Cirène, par le cheval tombé sous le chariot qu'il traîne, Je vous salue Marie... ». Il entra dans une petite clinique proprette, paya cinq cent roupies au comptoir et attendit sa consultation. Le cadre le rassura tout de suite, lui qui avait imaginé des horreurs quant aux hôpitaux indiens. Il ne se doutait pas qu'il ne ressortirait pas de cette sombre clinique avant une semaine.
En effet, après un rapide entretien, le médecin expliqua à Benjamin qu'il nécessitait des analyses de sang, et qu'il fallait qu'il soit interné pour la nuit. Le jeune français protesta, réexpliqua qu'il n'avait qu'une simple tourista. Le médecin prit un regard grave et lui dit : « Ici, vous pourrez recevoir vos médicaments par perfusion, si vous ne le faites pas vous n'aurez pas le temps de les assimiler… Vous savez, nous ne pouvons pas deviner la bactérie que vous avez contractée et il peut y avoir des complications, vous me dîtes que cela fait maintenant une semaine que vous souffrez… Par ailleurs, vous serez confortablement installé pour faire vos analyses. Passez d'abord une nuit, puis nous verrons. Si vous voulez bien me suivre ». Quand Benjamin entendit le mot « bactérie », il obtempéra rapidement. Il voyait ces petites bêtes roder dans le fond de son intestin, il les sentait presque. Oui, tout s'expliquait, il avait des « bactéries », il avait attrapé une « maladie bactérienne ». Les bactéries lui faisaient soudainement se sentir très mal, une forte nausée lui faisait perdre l'équilibre. Il passa d'abord par la caisse pour payer les deux premières nuits et les analyses, puis fut amené dans une chambre individuelle aux murs blancs et propres (il avait préféré avoir une chambre individuelle et y avait mis le prix). Il ne comprit pas grand-chose aux analyses qu'on lui montra, mais le médecin au regard grave lui expliqua qu'il valait mieux qu'il reste encore quelques jours supplémentaires. Il se serait ennuyé ferme s'il n'avait pas trouvé un vieil exemplaire en français de Werther, de Goethe sur une étagère de la salle d'attente de l'hôpital. Il lisait sur son lit, puis se répétait les lignes à haute voix tout en méditant sur son propre sort.
« Gouverneurs, pédagogues, instituteurs, tous sont d'accord que les enfants ne savent ce qu'ils veulent. Mais que nous autres, grands enfants, parcourons ce globe en chancelant, sans savoir d'où nous venons, où nous allons ; que comme les petits nous agissons sans but ; que, comme eux, nous nous laissons mener par des gâteaux, des bonbons et de la verge » « Héhé, on dirait qu'il parle de tous ces backpackers dont je fais partie… nous les pommés de la vie, les vagabonds... » « Oh ! Que je puis-je voler à ton cou, que ne puis-je t'exprimer par mes larmes, par mes transports, les sentiments confus qui bouleversent mon cœur ! Me voici seul, pouvant à peine respirer ; je cherche à me tranquilliser, j'attends le matin » « J'ai vraiment l'impression que ces médicaments ne fonctionnent pas ». « Le levain, qui mettait ma vie en mouvement, est sans force ; il est évanoui, ce charme qui m'animait au sein des profondes nuits, qui, le matin, m'arrachait au sommeil. » « Mon corps est si faible, et ce médecin qui me retient ici... ». « Comme mon esprit aventureux me présentait sous des couleurs romanesques les contrées qu'il allait arroser ; mais bientôt mon imagination rencontrait des bornes, et je la forçais cependant à s'égarer, de toujours s'égarer, jusqu'à ce que je me perdisse tout à fait dans la perspective d'un lointain imperceptible. » « Mouais… ça me rappelle la peste de Bénarès, qui s'égare de trop devient vite le plus grand pigeon que la terre est connue. » Malgré ce petit retour critique sur ses aventures et son esprit trop crédule par trop romanesque, Benjamin ne réussit pas à porter sa réflexivité sur sa situation présente, et se replongea dans sa lecture. « Je suis tel que l'ombre d'un puissant prince, qui s'échappant du tombeau pour aller revoir le palais somptueux qu'il bâtit pour un fils chéri, qu'il orna de toute la splendeur, de toute la magnificence des rois, ne trouve plus que d'affreux débris, que de tristes ruines ensevelies sous la cendre. » « Mon tombeau, mon lit d'hôpital, tandis que dehors s'élèvent les palais bâtis par des princes pour leurs épouses et leurs enfants. Et moi, je passe mes journées entre ces quatre mûrs à écouter les bip bip bip des machines médicales. » « Je divague, je badine avec mes douleurs ; j'aurais bientôt, si je m'y livrais, une litanie entière d'antithèses. » « Fichus médocs ! » « Non, jamais, jamais, je ne reviendrai à moi-même ! Partout où je porte mes pas m'apparaît un fantôme qui me jette hors de ma sphère ! » « Ça va faire deux semaines que je suis malade, j'ai l'impression que l'Inde m'a offert une de ces bactéries féroces qui ne me lâchera pas de sitôt. » « Ce n'est pas l'angoisse, ce n'est pas du désir. - C'est une fermentation interne, un transport inconnu qui menacent de déchirer ma poitrine, qui me serrent la gorge, qui me suffoquent ! Ah ! Douleur ! Ah ! Tourments ! Et dans ces moments affreux, je fuis, je vais m'égarer au milieu des scènes nocturnes et terribles qu'offre cette saison ennemie de l'homme. » Lire les souffrances d'un autre jeune homme semblait apaiser les siennes, il dévora Werther. « Mon heure n'a pas encore sonné : je le sens ! Oh ! […] ! Avec quel transport j'aurais abandonné mon existence d'homme pour déchirer les nues avec l'ouragan, pour soulever les flots ! Ah ! Ces délices ne seront-elles pas un jour peut-être, le partage de celui qui languit dans ce cachot ? »
Après une semaine, Benjamin qui se sentait largement mieux depuis plusieurs jours, annonça au médecin au regard grave qu'il voulait partir. Le médecin lui expliqua que les bactéries indiennes nécessitaient des soins très sérieux, qu'il ne pouvait pas partir en cours de traitement, et mit rapidement fin à la discussion. Toutefois, le petit Français ne se découragea pas, il rassembla ses affaires, arracha le cathéter qui lui perçait le bras depuis une semaine et fit mine de quitter sa chambre. Deux infirmiers tentèrent de le retenir, le menaçant de souffrance terrible s'il retournait à « son vagabondage dans les rues d'Udaipur ». Il poussa les deux hommes et se dirigea vers la sortie d'un pas assuré. Face à lui, une armada de médecins et d'infirmiers lui barrèrent l'accès à la porte, et s'attachèrent à lui faire une haie d'honneur jusqu'au comptoir d'accueil. Là, l'attendait sa facture. Benjamin n'avait pas le moindre instant imaginé l'ampleur des frais médicaux, il se mit à paniquer. Il avait passé une semaine dans une chambre Deluxe en pension complète… la note était salée, il paya. Désormais, Benjamin était fauché.
0 notes
Text
Les aventures de Benjamin Duronflan, chapitre 6 - Systèmes défensifs
Benjamin, les deux Allemandes et le Français-au-crâne-rasé passèrent les deux jours suivants ensemble. Le premier jour, ils visitèrent la « ville rose », ville à la teinte rose ocre encerclée par des remparts. Ils passèrent une grande partie de la journée happés dans des magasins par de sympathiques rabatteurs. L'Allemande-mère était ravie : elle voulait TOUT voir. Les deux Français commençaient à s'ennuyer mais profitaient de voyager avec leurs nouvelles compagnes pour voyager à l’œil. Soie, bijoux en argent, pierres précieuses, sculptures en bronze, imprimés, miniatures, soie. Tout y passa. Ils réussirent quand même in extremis à visiter le fameux palais des vents, petit merveille de Jaipur à la façade en alvéoles roses, ajourée de petites fenêtres.
Le lendemain, la compagnie s'entassa dans un bus pour monter à fort d'Amber, logé dans un col au dessus de la ville. La bousculade dans le bus était tellement « couleur local » qu'elle mit Benjamin de très bonne humeur ce qui agaça son compagnon cinéaste. Le fort apparaît au milieu du col, accroché à la colline, immense et jaune, imprenable tout en étant léger. En effet, si c'était le dispositif défensif le plus impressionnant que Benjamin ait vu (et il avait suivi un cours d'histoire des systèmes défensifs en Licence 2), l'Amber fort n'en demeurait pas moins un sublime palais à l'architecture fine et sensuelle. Sur le chemin pavé qui zigzaguait pour monter à la première porte, Benjamin qui voulait briller, tenta de donner des informations sur le système défensif (après tout, il avait suivi un semestre de cours sur ce sujet). Comme il ne se souvenait de plus grand-chose, il inventa de passionnantes anecdotes sur ce qu'ils croisaient, jusqu'à ce que Crâne-Rasé qui ne sortait jamais sans son smartphone se mette à le contredire, page Wikipédia à l'appui. Le tour de la discussion commençant à déplaire à Benjamin, il se lança dans une longue dissertation sur le ridicule et les mérites des selfies dont les touristes indiens qui les entouraient étaient amateurs. « Narcissisme ou autoportrait » répétait-il, « narcissisme ou autoportrait. Oui, oui, certes, bien souvent, ces photos semblent être de pâles reflets sans profondeur, pures apparences, pure représentation. Et ce geste, il ressemble vraiment à un… à un miroir tendu à sa propre image. Oui, oui… mais si on regarde bien, dans cette quête identitaire, justement par et grâce à la représentation n'y a-t-il pas aussi une tentative d'esthétisation du moi, de la réalité, une tentative aussi pathétique qu'elle puisse apparaître pour réenchanter le monde ? Déclarait-il. Ces autoportraits numériques capturent aussi les moments, le partage, les décors, les amours, les rencontres. Ce n'est pas anodin de se prendre devant un palais : pour quelques minutes, ce gars avec sa grosse montre, ses cheveux plaqués en arrière est un vrai raja. Il y croit. Je pense que ce qui nous fait peur avec le selfie est le côté enfantin, le lâcher prise dans une projection imaginaire. Le selfie familiale est un essai d'incarner, peut-être avec un filtre Instingram aussi, d'incarner… enfin, une sorte de sainte famille, quoi. Tout sourire… »
Avec sa diatribe, Benjamin avait réussi à disperser leur groupe au milieu des touristes et de leur forêt de selfie stick. Alors seulement, il se laissa aller. Sans réfléchir, il passa une porte, tourna à droite dans un couloir, monta des escaliers, émergea dans une cour dont les murs brillaient de mille miroirs… Il vivait son mythe orientaliste à plein, parcourant les couloirs en poussant des petits cris, s'imaginant tour à tour soldat, maharaja hélant la foule, concubine, marchands d'épices et soieries, serviteur complotant contre son maître, charmeur de serpents… A force, il s'était enfoncé dans des recoins du fort où aucun visiteur ne va d'habitude. Le palais était à lui, plus personne hormis quelques perruches qui nichaient sous les poutrelles de grès rose et il se permettait de parler à voix haute. « Quel endroit magique, quel labyrinthe ! Je me demande bien quelles histoires se sont déroulées ici ? Combien de sièges ? De femmes et de soldats ! ». La nuit était tombée et Benjamin se décida à retrouver ses amis et la sortie.
« Mais, il n'y a plus une âme qui vive ici ! » se disait-il en appelant. « Il y a quelqu'un ? Quelqu'un ? Eh oh ! Youhou ! ». La nuit enveloppait le fort ; des ombres s'allongeaient, couraient, sautaient de toits en toits. Benjamin tournait la tête à la recherche des êtres qui se cachaient derrière ses ombres. Il entendait des hurlements venant des remparts, se mit à courir dans les couloirs avant d'arriver sur la plate-forme où dans des temps anciens on montrait les butins et les prisonniers à la population. « Qui est là ? » demanda en tremblant le jeune homme, mais derrière lui, les hurlements redoublaient d'intensité. Les fantômes des hommes et femmes massacrés par un raja sanguinaire ; désormais, il les entendait, les plaintes des damnés. C'était à lui qu'ils en voulaient : la nuit, oui bien entendu, la nuit, le fort leur appartient, il faut fuir, maintenant. Et Benjamin se remit à courir à la recherche d'un moyen de s'échapper. Il fit le tour des remparts en courant mais ne se sentit pas de sauter les dizaines de mètres de hauteur de ces derniers, puis réussit à trouver la porte principale dont la lourdeur lui résista, et toujours ces ombres qui hantaient le fort. « Mon dieu, mon dieu, tu es grand et miséricordieux, protège-moi de ces âmes en peine... » se murmurait-il. Toutefois, il ne trouvait aucune issu possible. « Ces longues pierres jaunes, tombeau de ces malheureux et malheureuses, seront mon tombeau, le glorieux réceptacle de mes derniers souffles ». Il s'assit parterre pour méditer sur ce qui était en train de lui arriver tout en esquissant quelques mouvements de yoga. Grâce à ses astucieuses techniques de respiration ventrale, il fit baisser un peu son angoisse , puis farfouilla dans son sac à la recherche de quelque chose à grignoter. « On va pas se laisser abattre, vieille branche » se disait-il tout haut. Dans son sac qu'il vida entièrement, il trouva : un carnet en moleskine noir, un livre sur l'insurrection maoïste au Népal, du papier toilette, un livre d'apprentissage de l’hindi, un stylo, un blister vide de médicaments, un spray nasal, une barre de chocolat, quelques factures, un billet d'entrée pour la visite d'un palais, une lettre à moitié écrite, du gel hydroalcoolique, un petit paquet de biscuits brisés et une bouteille d'eau. Il but d'abord quelques gorgées puis ouvrit joyeusement sa barre chocolatée. Déluge sucré sur son palais, délice de caramel, bonheur du chocolat… son plaisir était grand et ses yeux roulaient dans leur orbite. Lorsqu'il avalait sa dernière bouchée, il eut un long soupire de contentement et s'affala de tout son long sur les marches où il était assis, devant la porte de la Lune. La porte de la Lune était la deuxième grande porte du fort Amber, amenant vers les appartements privés du raja. Cette grande porte était peinte de motifs floraux et animaliers aux couleurs vives, les paons et les tigres lui faisaient penser à un livre pour enfant. Cette pensée le rassura encore un peu plus, il ouvrit un paquet de biscuits. A peine avait -il commencé à l'ouvrir que les ombres se mirent à s'agiter autour de lui. Doucement, il porta un biscuit vers bouche, des miettes lui collaient aux doigts, il sentait déjà la forte odeur de beurre des biscuits indiens… Brutalement, il sentit la douceur lui échapper, il se leva, effrayé, tenta de percer l'obscurité mais ne put apercevoir les… La peur céda ensuite place à la perplexité. S'il avait voulu croire à la présence de spectres, il ne les croyait ni chapardeurs, ni affamés de nourritures terrestres. Il prit un second biscuit, il réussit à en croquer un bout lorsqu'une tête noir s'approcha du paquet entier pour tenter de le saisir. Benjamin eut tout juste le temps de poser sa main en même temps. Notre héros était soudain dans un face à face tendu avec un singe : grand corps souple couvert de poil blanc prolongé par une longue queue lui servant de balancier, une tête noir et poilu lui montrant de grandes dents jaunes. Le système nerveux autonome sympathique de Benjamin prit le dessus, il ne pensait plus, était guerrier, les sens éveillés, ses muscles tendus prêts à briller de toute leur puissance. « Surya bien qui Surya le dernier » s'écria-t-il ! Et il tira d'un coup sec le paquet de biscuit, tout en dessinant une courbe avec son bassin qu'il balança plusieurs mètres en arrière. Il fit trois roulades, son maigre dîner serré dans sa main droite. D'un petit bond souple, il se releva et fit face à son adversaire. « Eh oui mon coco, comme dirait mon pote pharmacien, je suis plutôt un sympathique quand je m'y mets ! ». Mais sur les toits se profilaient les ombres d'une vingtaine de singes… Trois bonds, un singe sur ses épaules, « Aaaaah ! », le paquet de biscuits. En une dizaine de secondes, un autre singe lui avait volé son repas. Mais les autres primates s'approchaient aussi, visant visiblement son sac à dos… de sympathiques, il passa parasympathétique et s'enfuit en courant, abandonnant son sac à la furie des macaques. Benjamin passa la nuit, recroquevillé dans une petite tourelle alvéolée.
Durant cette longue nuit, Benjamin Duronflan n'écrivit dans son carnet que ses quelques lignes :
« J'ai semé ces singes que j'avais pris pour des fantômes. Ils sont bien réels, et ils sont dangereux. »
0 notes