#enfants atypiques
Explore tagged Tumblr posts
Text
Plume-au-point s'expatrie – Réussir son expatriation aux Etats-Unis. Echanger et s'informer entre parents d'enfant neuro atypique. (wordpress.com)
#expatriation#états unis#parentalité#enfants atypiques#troubles psychiatriques#Troubles du neuro-développement#rédaction de contenus web#orthophoniste
2 notes
·
View notes
Text

Lin Zhao "Combattante de la liberté", Anne Kerlan
Introduction
L’Histoire a-t-elle le pouvoir de ramener les morts à la vie ?
“Lin Zhao : « Combattante de la liberté »” d’Anne Kerlan est une biographie historique publié en 2018. Elle retrace la vie et le combat de Lin Zhao (林昭) jeune intellectuelle chinoise, engagée et fidèle a ses idéaux sous le régime de Mao.
J’ai choisi de travailler sur cette biographie après avoir lu la “rencontre” entre Anne Kerlan et Lin Zhao. En effet, dans l’introduction du livre, l’autrice raconte qu’elle découvre Lin Zhao grâce à une projection à Paris en 2008 du film de Hu Jie (胡杰), un soldat devenu artiste indépendant et réalisateur de documentaires, : “À la recherche de l’âme de Lin Zhao “ (尋找林昭的靈魂).
Hu Jie décide de quitter son travail après avoir découvert Lin Zhao pour se consacrer entièrement à la réalisation d’un documentaire sur elle. Personnage majeur dont le destin semble ne faire qu’un avec une histoire de Chine que peut connaisse alors.
Son documentaire est un monument funéraire à la mémoire de Lin Zhao, ce travail fait naitre en lui une mission “remettre les victimes et leur histoire dans l’ordre du visible”. Mission réussie, car grâce à ce film et aux différents témoignages des proches de la jeune fille, Lin Zhao devient “Icône de la dissidence chinoise contemporaine”
Après avoir regardé le documentaire, Anne est bouleversée par le destin tragique de Lin Zhao. Elle doit raconter cette histoire. Donc, elle demande l’accord du réalisateur dés la fin de la projection. Il la lui donne volontiers, car il souhaite faire connaitre cette histoire au plus grand nombre.
La fascination pour Lin Zhao parait alors contagieuse, il fallait que je m'y intéresse !
Historienne et sinologue française, spécialiste notamment du cinéma chinois. Également directrice de recherche au CNRS et du CNRS-EHESS. Anne Kerlan s’intéresse aux figures oubliées de l’histoire de la Chine moderne ainsi qu’aux différentes formes de résistances face à l’oppression. Des sujets largement abordés dans la vie de Lin Zhao. Témoins des nombreux excès de la politique de Mao et victimes des répressions du régime qu’elle n’aura de cesse de dénoncer.
L’auteure souhaite, comme le film de Hu Jie faire connaitre l’incroyable destin de « La fleur de Beida », mais elle ne se limite pas à une simple reformulation du documentaire. Elle travaille autour des faits, des événements, des représentations, des souvenirs, des opinions, des rumeurs qui lui permettent de retracer la vie, la figure de Lin Zhao “ Étudier la formation et l’évolution”. Les fait deviennent aussi importants que l’image qu’elle a laissé dans les esprits pour celle qui veut raconter son histoire et son élévation au rang d’icône.
Pour cela, l’ouvrage nous fait suivre chronologiquement les grandes périodes de la courte vie de Lin Zhao.
Développement : Synthèse
La Première et unique partie du livre est titrée “Suzhou”.
Lin Zhao est souvent comparée à cette ville qui l'a vu naitre. En effet, l’apparence et la façon d’être de Lin marquait au fer rouge la mémoire de ses interlocuteurs du même effet que la beauté d’une des plus ancienne cité de Chine. Mais, au moment où Hu Jie s’y rend, Suzhou est en pleine transformation. Toutes les traces de Lin et de sa famille sont effacées. Il faut vite raconter l’histoire ! Avant qu’il n’en soit de même pour leurs vies.
Les trois chapitres qui suivent se concentre sur l’enfance de Penglin Zhao. De sa naissance dans une Chine en guerre, à son adolescence dans une Chine en guerre. Les ambitions de ses parents pour leur patrie et pour leurs enfants. La naissance de ses idéaux. Sa transformation en Lin Zhao.
Elle naît en 1931 ou 32 seulement un ou deux ans après le mariage de ses parents : Xu Xianmin (许宪民) et Peng Guoyeng (彭国彦). Couple de progressistes, engagés et activistes, le couple est atypique. Un fonctionnaire et une jeune révolutionnaire, lié entre autre par une même ambition : Sauver la nation “Grandir dans une Chine en paix, forte et juste. Une Chine enfin unie qui leur offrirait le meilleur des avenirs”.
Son père choisi son nom en référence à Ban Zhao, la première historienne chinoise. Première enfant du couple, Lin Zhao est fragile, elle tombe souvent malade et est choyée par ses parents qui s'inquiètent beaucoup pour elle. Sa petite-sœur la décrit comme âme sensible : “Elle aimait pleure[...], aimait avec passion, haïssait à l’excès” qui trouve le réconfort dans la lecture, la religion et l’amitié.
Elle grandit dans un pays et un environnement familial instable, en 1939 ses parents doivent se séparer à cause des affrontements entre la Chine et le Japon. En 1946, les affrontements entre KMT et PCC éclatent malgré un appel de la population à régler démocratiquement l’opposition.
Dans cette Chine en crise (monétaire et politique) détruite par les affrontements et des dirigeants corrompus, les espoirs d’un pays libre, démocratique et pacifié sont peu a peu balayé et la population se soulève. Le couple des parents de Lin se fracture pour raison idéologique. Le cercle familial est brisé. C’est dans ce contexte que naissent ses premiers engagements.
Xu Xianmin scolarise sa fille dans un collège catholique. Avec des camarades de classe, elle fonde la Bibliothèque de la grande Terre (大地圖書館) et la revue Naissance (出生), lieux de rencontre et de débat ou ses idées communistes peuvent fleurir. Pour la protégée face aux répressions du KMT, très dure face à la diffusion de ces idées, sa mère la change d’école dans l’espoir qu’elle cesse ses activités, mais rien n’y fait. Lin Zhao se convertit au communisme en été 1948, mais en est exclue peu après, avant les efforts de guerre, à cause de ses origines sociales qui porte la rende dangereuse.
La grande honte de ne pouvoir se battre au côté de ses camarades durant ce moment charnière de l’histoire du socialisme chinois va la torturer. Elle va jusqu’à se faire renier par sa famille pour pouvoir servir le parti en tant qu’étudiante en journalisme à Wuxi (無錫). Son désir de se faire accepter par “sa nouvelle famille” est plus fort que tout.
Elle s’épanouit totalement dans ces études, elles lui permettent de disposer “Toute son énergie et son talent au service de la Chine nouvelle”. Elle marque tout de suite ses camarades par son jeune âge, sa stature et son érudition. Durant les universités des champs, elle découvre les joies du travail rural ou chaque blessure qu’elle se fait devient un trophée, mais elle fait aussi face à la violence du parti. Lynchage des propriétaires, exécution.
Mais malgré tout, ses origines sociales la rattrapent. Elles portent le doute sur elle et sur la sincérité de son engagement. Bien qu’elle soit complètement investie et pleine de bonne volonté. Après avoir rappelé à l’ordre par le Parti pour avoir dénoncé ses parents, le parti lui demande de dénoncé ses parents. Elle ne comprend plus, commence à tenir tête, “ ne se soumet pas sans raison à l’autorité”. Elle va en payer le prix. Cible de nombreuse session d’attaque ou des cadres et d’autres étudiants l’accuserons de ne pas assez prouvé sa fidélité au parti, de ne pas lui être dévoué. Son seul refuge durant cette période et celles qui suivent sera son journal intime “Le petit paradis de mon âme” ou l’écriture, seul “endroit” où elle peut se dévoiler. Ses faiblesses, sa maladie, ses sentiments profonds qu’elle ne peut dévoiler aux vautours qui cherchent la moindre faille en elle pour détruire ses convictions.
En aout 1954, elle intègre l’Université de Pékin (北大) lieu majeur du pouvoir politique chinois du 20e siècle. Elle s’épanouit toujours dans le milieu intellectuel, impressionne par sa plume et sa culture classique. Rédige des poèmes à la gloire de Mao.
En 1956, le partit lance la “politique des 100 fleurs”, il s’ouvre aux intellectuels, malgré la haine de Mao a leurs égards, il a besoin de leurs talents. La parole des étudiants se libère à l’université. Des débats et des discussions animent le campus des universités de tout le pays. Lin Zhao participe à la revue Bâtiment rouge crée durant cette période de liberté, elle y publie des poèmes ou elle transmet avec prudence des messages d’espoir à ses camarades étudiants. C’est la renaissance de l’esprit libre et critique du 4 mai 1919, née au sein même de cette même Beida quelques décennies plus tôt.
Mais les beaux jours touchent à leur fin.
Le poème mural (大字報) “Le moment est venue” crée l’émulsion chez les étudiants de Beida. Les revendications, les critiques du parti, bien que sans réel remise en cause du socialisme, prolifère. Mais malgré les grandes ambitions de diffusion de ces idées par le biais de revues comme “Place publique (廣場)”. La réalité des rapports de force entre les étudiants qui ne remettent pas en question le Parti et les réformateurs est écrasante.
Le pouvoir se sent menacé. Lin Zhao est tiraillée entre sa conscience vis-à-vis de ses amis et sa fidélité au Parti face à la campagne anti-droitier de juin 1957. “Dans tout le pays, ceux qui aiment la justice, la liberté, la démocratie vont au-devant de la catastrophe”. À son tour, Lin est dénoncé par une de ses amie puis forcée à l’auto critique. Elle est condamnée à la rééducation par le travail. Suite à ça, elle va tenter de se suicider deux fois, mais n’y arrivera pas, alors elle entame complétement son chemin vers la rébellion.
Lin Zhao accepte son statut de droitière et met fin au conflit interne qui la torturait “ Jamais je ne me laisserais réduite à être esclave d’une tyrannie”
En mai 1958, Mao déploie le “Grand bond” en avant, “Guerre à la nature, à l’industrie, à la science, guerre aux Hommes”. Les communes populaires instaurées suite à cette politique seront le “socle organisationnel” de la famine de tout le pays et mèneront à un “ Peuple de fantômes affamés”.
Suite à l’épisode anti-droitier, Lin Zhao est renvoyée à Shanghai auprès de sa mère. Elle n’est pas décidée à faire taire ses idées.
En 1959, elle prend contact avec un groupe d’étudiants de l’Université de Lanzhou (蘭州) dans le Gansu (甘肅) loin de Shanghai. Ces étudiants projettent la création d’un journal. Pour éclairer les consciences du pays sur les causes de sa chute.
Le nom du journal, “Étincelle” (星火), est directement inspiré d’une citation de Mao : “ Une étincelle peut mettre feu à toute la plaine”. Les membres se rassemblent autour d’un idéal “Un parti qui ne se situerait pas au-dessus du peuple, des chefs qui n’étaient pas mieux traités que des ouvriers modèles.” D’abord opposés au projet par peur de passé pour une opposante de principe au parti, Lin finit par participer au projet. Elle publie un poème dans le journal sous pseudonyme. Le premier numéro parait en janvier 1960. Critique radicale, appel à la révolte, analyse de la situation du pays, messages d’espoirs, diffusion de documents confidentiels. Le poème de Lin “La passion de Prométhée” représente la moitié du journal, portant une dimension prophétique, il met en scène des prisonniers prêts à sacrifier leurs vies pour la liberté et du plus résolu d’entre eux qui écrit de son sang. Le poème galvanise ses camarades en donnant à leur engagement une dimension héroïque.
Ils sont vite rattrapés par le monstre sans tête du PCC. Dénoncé en pleine préparation du second numéro, les étudiants sont jugés et condamnés à des peines très lourdes. Lin est arrêté, elle aussi, peu après, son père se suicide, il semble connaitre le sort qui sera réservé à sa fille en prison et il sait qu’il ne pourra pas y faire face.
Pendant une année entière, elle est enfermée sans procès. Directement sujette à la torture, enchainée six mois d’affilée. Libérée pour raison médicale grâce à l’intervention de sa mère, elle sort de prison, convaincue de la nécessité de son combat. Sa réadaptation au monde extérieur est difficile, elle est seule, très peu ose la soutenir ou lui parler franchement, tous ont peur de la répression. Parfois, elle imagine une vie plus sereine, mais la réalité la rattrape et elle ne peut fermer les yeux. Elle a déjà commencé à écrire sur ses conditions de détention. Pour tenir le coup, pour dénoncer et elle utilise déjà son sang.
Le 8 novembre 1962, elle est ré-arrêtée et transférée en prison. Elle n’en sortira pas avant son exécution le 29 avril 1968.
Torture psychologique et physiologique. Menottée, affamée, mourant de froid, battue, interrogée des heures durant, violée. Les conditions de détentions sous le régime de Mao sont dures. Tellement que Lin Zhao multiplie les tentatives de suicide, elle attend l’exécution comme une délivrance. Mais son calvaire ne cesse. Alors, elle se bat. Lin Zhao écrit, elle dénonce le régime, elle dénonce le totalitarisme, elle dénonce ses conditions de détention “ L’histoire me jugeras innocente”. Elle refuse la réforme totale de sa pensée, objectif de la prison.
“Nous avons épuisé toute notre bienveillance à l’égard de Lin Zhao. Elle n’est pas réceptive à nos enseignements, résiste. La seule issue est la mort.”
Le chaos de la Révolution culturelle frappe jusque dans les murs de la prison. Ses conditions de détentions empirent. Faim perpétuelle qui l’obsède. Son esprit et son corps, les seules choses qu’elle a le pouvoir de conserver, seuls outils à sa disposition pour continuer sa lutte. Son corps comme forteresse, comme arme. Elle crie sa liberté, met à l’épreuve son corps avec de longues et nombreuses grèves de la faim. Pour lui retirer cette arme, elle est nourrie de force par un tuyau en plastique enfoncé dans le nez. Elle écrit de son sang. Car l’écriture la rend libre, une échappatoire et son sacrifice pour sa patrie et un moyen de rendre hommage à son père. C’est aussi un combat contre la folie pour ne pas perdre sa crédibilité politique. Elle crée son refuge dans la lutte qui lui permet de ne pas sombrer dans la folie et trouve dans la foi un réconfort.
Il nous est parvenu l’équivalent de 380 pages A4 remplie de caractères des cinq ans, quatre mois et sept jours de détention de Lin Zhao.
Le 1er mai 1968, après 6 mois sans nouvelle, car la prison avait interrompu les correspondances entre Lin et sa famille, un policier vient récolter la facture de 5 yuans pour la balle qui a servi à l’exécutée. Les conditions de son exécution restes floues, mais l’impact qu’elle a eu sur la famille a été dévastateur.
Sa mère n'a jamais cessé de se battre pour la libération de sa fille malgré qu’elle est était confrontée aux mêmes difficultés extrêmes que tous les citoyens chinois de l’époque. Lin avait conscience de la torture que causait sa condition sur la santé de sa mère. “Peu importe si je vis peu de temps, mais je vous en prie, accordez une longue vie à ma mère”. Elle en était désolée, mais ne regrettait pas son engagement. Après la mort de sa fille, Xu Xianmin vécu une vie misérable. Elle tente de suicider, mais rate, puis la fin de sa vie est rythmée par les coups portés par fils. Il la porte elle et sa sœur aînée comme responsable de ses échecs, elle meurt misérablement, en 1975, complétement abandonnée et méconnaissable. Emplie de rancœur pour sa grande sœur, le petit frère de Lin a complétement coupé les ponts avec sa famille et fait carrière aux États-Unis. Sa petite sœur, elle aussi, s’installe aux États-Unis. Après des années, elle voit que sous la présidence de Deng Xiaoping les conditions sont favorables pour essayer de réclamer une procédure de réhabilitation pour sa sœur et sa mère. Grâce à ça, elles sont déclarées innocente. Le 22 aout 1981, Lin Zhao est officiellement saine d’esprit et a été exécutée à tort.
Les derniers chapitres se concentrent sur la réapparition de la figure de Lin
Hommages et commémorations sont organisés en la mémoire des victimes du régime, Lin Zhao y est mise à l’honneur. Les gens qui l’ont connue se réunissent, se remémorent sa stature, racontent leurs souvenirs, expriment leurs regrets. En janvier 1981, un article retraçant son histoire est publié dans le “Quotidien du peuple”. Un autre article de Chen Weisi intitulé “La mort de Lin Zhao” retrace également le tragique destin de la jeune poète. Et ce malgré le licenciement de certains éditeurs qui ose aborder le sujet de sa condamnation.
Malgré la diffusion de son histoire, son dossier judiciaire reste solidement fermé, les autorités ont conscience de l’impact qu’ils pourraient avoir. Ses textes sont scellés ou détruit. Sans l’intervention d’un fonctionnaire bienveillant, la sœur de Lin n’aurait jamais mis la main sur une partie des écrits de sa sœur et ils ne nous seraient jamais parvenus.
Le récit du sacrifice d’une belle et précieuse vie pour la vérité émeut et se répand en grande partie grâce au film de Hu Jie. Portée au rang Déesse de la littérature du peuple chinois, “Elle devient un repère pour d’autres victimes d’injustice en Chine”, Les internautes s’emparent de la figure de Lin Zhao et s’inspirent de son histoire pour trouver la force dans leurs propres luttes.
Un symbole qui inquiète par la force de sa diffusion.
Analyse
Puisque la biographie est construite autour d’un parallèle entre la vie de lin et l’histoire de son pays. Nous pouvons suivre avec clarté les conséquence que l’un à sur l’autre. Je pense que certain événement majeur de l’histoire de Chine et de la vie de Lin auraient mérité plus de précision. Par exemple les université des champs et la confrontation de Lin et de son entourage avec les différentes politiques de Mao. Mais les ouvertures sur chaque événement des périodes abordées nous permettent de ne pas nous perdre dans la chronologie.
Les noms chinois sont transcrits en pinyin sans ton.
Le placement de notes à la fin de l’ouvrage rends leur consultation assez lourde, j’avoue en avoir sauté beaucoup pour ne pas rendre trop lourde ma lecture.
Les extraits de textes de Lin Zhao sont bien répartis dans le livre. C’est appréciable d’y avoir accès et chaque fois qu’ils apparaissent la lecture est mise en pause, car on se rend compte qu’ils sont précieux.
Contrairement au film de Hu Jie, la biographie d'Anne Kerlan ne se concentre pas sur la dimension de martyre chrétien du personnage de Lin Zhao. Grâce aux différentes sources et nombreux témoignages de proches de Lin qu’elle entrecroise, l’image de Lin qui nous est présentée est assez concrète. On suit l’évolution de ses émotions et de ses désirs comme plongé dans sa psyché, ce qui fait que l’on ressent presque l'injustice des événements qui la touchent.
Conclusion
Le destin de Lin Zhao est important et le livre d'Anne Kerlan est une parfaite manière de commencer à s’y intéresser. Son récit devient quasiment essentiel pour comprendre les enjeux des répressions politiques du régime de Mao et les différentes formes de résistance qui s’y sont opposées.
Comment une jeune fille brillante, sentimentale et passionnée de culture classique chinoise s'est retrouvé coincé dans un cercle de violence aussi puissant ?
Grande figure de la dissidence chinoise, Lin Zhao inspire et fascine. En Chine comme ailleurs, la vie de Lin Zhao ne cessera d’inspirer. “Le combat continu”, le pari est tenu.
3 notes
·
View notes
Text
Notre rendez-vous du mois!
Hello mes papivores 2.0, et bienvenue à notre rendez-vous du mois qui s'annonce riche en émotions comme le premier. Aujourd'hui, je vous garde dans le même univers que mon précédent article, mais celui ci est un peu plus je dirais … GLAUQUE! L'écrivaine Louise Mey, auteure engagée au style on ne peut plus percutant, sait nous captiver, nous lecteurs dès les premières pages. Et ce que j'adore par dessus tout avec cette grande dame bourrée de talents c'est le fait que la plupart de ses thèmes repose sur des sujets sensibles et d'actualité, tels que les féminicides, les manipulations psychologiques, les secrets de famille et les injustices sociales.
C'est exactement dans un thème comme ceux suscités que je me suis plongée récemment. Laissez vous submerger d'émotions (je vous promets très débordantes), dans ce thriller psycho dramatique de Louise Mey: LA DEUXIEME FEMME .
Le PITCH d'abord!
Sandrine a tout pour être heureuse : un mari aimant, deux enfants magnifiques, une vie paisible. Mais un jour, tout bascule. Son mari, Thomas, lui annonce qu'il a retrouvé son ex-femme, Clara, disparue depuis des années. Sandrine se retrouve alors en proie à un sentiment de jalousie et de peur qui va crescendo. Qui est vraiment Clara ? Que veut-elle ? Sandrine est-elle en danger ?
Mon avis, toujours HUMBLEMENT!
Louise Mey sait d'habitude comment tenir son lecteur en haleine. Dès les premières pages, on est happé par l'intrigue et on a du mal à lâcher le livre. L'auteure distille savamment les indices et les rebondissements, nous menant sur de fausses pistes et nous surprenant jusqu'au dénouement final. Par contre dans ce thriller, j'ai eu beaucoup de mal aux premières pages qui ennuyaient très vite et qui ont bien failli me faire laisser tomber ce livre (heureusement que non!). On nous présente Sandrine, jeune femme ordinaire envahie de complexes (sentiment normal je vous assure!), essayant de vivre sa vie paisiblement. Son univers bascule quand son mari Thomas (attention à tous les "Thomas" de votre entourage après ça!) lui annonce qu'il a retrouvé son ex femme auparavant mystérieusement disparue… Le retour de Clara (personnage très atypique), l'ex-femme de son mari, agit comme un tremblement de terre, ravivant des blessures enfouies et semant le doute et la peur dans son esprit. Le roman explore avec profondeur les sentiments complexes de Sandrine, tiraillée entre la jalousie, la colère et l'espoir de sauver son mariage. Sa confrontation avec Clara est électrique, chaque mot résonnant comme un coup de poignard dans une atmosphère de tension palpable.
La Deuxième Femme n'est pas seulement un thriller psychologique, mais également un récit poignant sur la place des femmes dans la société. Louise Mey met en lumière les injustices et les violences auxquelles elles sont confrontées, soulignant la douleur et la solitude ressenties par celles qui se retrouvent dans l'ombre d'une autre femme. C'est un livre poignant et bouleversant qui ne se résume pas à une simple intrigue policière. Il nous confronte à la complexité des relations humaines et aux répercussions profondes de nos choix. Un récit qui m'a profondément marquée et qui m'a amenée à réfléchir sur la force et la résilience des femmes face à l'adversité. Ce qui rend ce livre particulier est le partage incroyable de sentiments que l'on peu avoir avec Sandrine: l'insécurité, la peur à chaque fois que son mari rentrait du travail, la douleur des coups qu'elle recevait, l'humiliation servie par Thomas et surtout la RAGE de vaincre et de se sortir de là une fois le déclic eu… La fois de trop! Attention, les violences psychologique et physique peuvent être difficiles à lire pour certains.
J'ai clairement savouré avec amertume (pour être honnête) ce livre et je le recommande à tous les lecteurs qui recherchent un roman intense et poignant, les amateurs de thrillers psychologiques et les personnes sensibles aux questions de société et aux violences faites aux femmes.
Vous pouvez vous procurer cette merveille au Supermarché CARREFOUR à PLAYCE, quartier WARDA à Yaoundé au rayon bibliothèque.
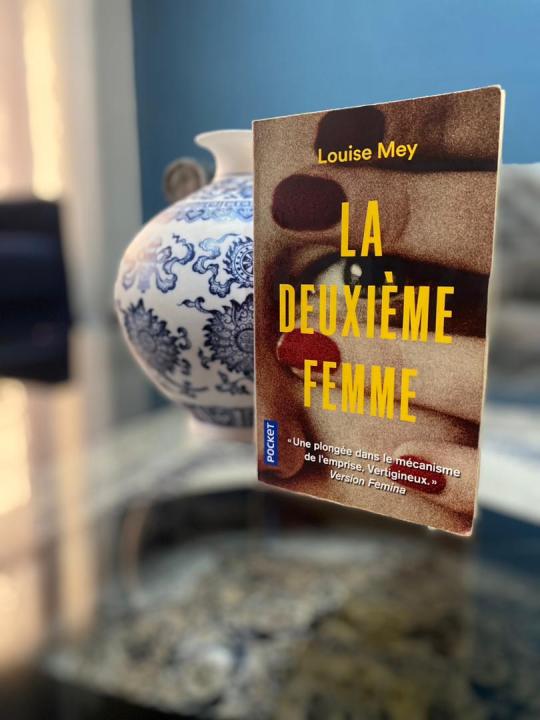
#booklover#bibliophile#roman#thriller#psychological thriller#feministe#blogger#litterature#carrefour#myplayce#cameroun#yaoundé#237booklover
12 notes
·
View notes
Text



Andromeda est une petite ville située au cœur de la forêt de Tillamook, dans l'Oregon, nichée entre océan et montagnes. Avec une population de 20 738 habitants, Andromeda est un endroit où l'histoire et les légendes urbaines ne font qu'un.
La ville est connue pour son atmosphère mystérieuse et ses légendes urbaines. D'aussi loin qu'on s'en souvienne, les habitants d'Andromeda racontent des histoires de phénomènes surnaturels et de rencontres avec des créatures étranges. Certains prétendent avoir vu de curieuses lumières dans le ciel la nuit, tandis que d'autres affirment avoir été témoin de manifestations paranormales dans les vieilles maisons abandonnées qui parsèment les environs. L'histoire d'Andromeda remonte à plusieurs siècles, les premiers colons ayant établi la ville dans les années 1800, attirés par les riches ressources naturelles de la région. Si à ses débuts la ville était très appréciée des nouveaux arrivants et dynamique pour l'époque, au fil du temps, Andromeda est devenue un endroit isolé, coupé du reste du monde. Les routes menant à la ville sont peu à peu abandonnées, faute d'entretien et de passage réguliers, contribuant à l'isolement de la bourgade déjà difficilement accessible.
La ville elle-même est un mélange unique d'architecture ancienne et de bâtiments plus modernes. Dans le centre historique, les rues sont bordées de vieilles maisons victoriennes et de boutiques atypiques, accentuant l'ambiance étrange et étouffante d'Andromeda. Les habitants sont fiers de leur patrimoine et de leur histoire, mais ils sont également conscients des légendes sombres qui entourent leur ville. La plus célèbre, celle racontée à tous les nouveaux venus, à toutes les soirées autour d'un feu de camp, à tous les enfants le soir d'Halloween, est celle de Lonely Maddie. On dit que son esprit hante la forêt environnante, apparaissant aux voyageurs égarés et aux curieux qui s'aventurent trop loin. Les habitants ont appris à respecter la nature et à éviter les zones les plus reculées, craignant de rencontrer le fantôme.
Malgré tout, Andromeda reste appréciée des familles y résidant, généralement présentes depuis des générations. La communauté locale est soudée et organise régulièrement des événements culturels et des festivals pour célébrer leur histoire et leur identité unique. Les marchés fermiers locaux proposent des produits frais et des spécialités régionales, tandis que les galeries d'art exposent des œuvres d'artistes locaux talentueux.
La nature environnante, même si parfois inquiétante, est un véritable trésor pour les habitants d'Andromeda. Les montagnes offrent des possibilités infinies de randonnées et d'explorations, avec des sentiers sinueux qui serpentent à travers la forêt dense. L'accès direct à l'océan Pacifique est parfait pour la pêche et les sports nautiques, attirant les amateurs de plein air de tous horizons.
#gravity falls#pacific northwest#pnw gothic#projet forum#projet rpg#rpg#rpg francophone#stranger things#twin peaks#forum rpg
13 notes
·
View notes
Text
La Nature portée par Daisuke Igarashi

Daisuke Igarashi (né le 2 avril 1969) est un mangaka qui a commencé son aventure au début des années 1990 avec des thématiques de prédilection : la nature et l'environnement tels que les Les enfants de la Mer, Sorcière ou plus récemment Designs. Il a d'abord démarré sa carrière dans la magazine de prépublication spécialisé dans le genre seinen Afternoon (Kodansha).
Quelques une de ses œuvres :
Petite forêt narre l'histoire de Ichiko qui vit dans le hameau de Komori. Elle partage son expérience de la cuisine naturel (elle aborde déjà le circuit court et le bien mangé) mais derrière ce personnage se camoufle une enfance tourmentée. Le personnage a souffert de l'abandon de sa mère… - Disponible en France chez Delcourt.
Le petit monde de Kabocha (One-shot) : Même s'il est est paru au Japon en 2007, il sera disponible en France en septembre 2024 dans la nouvelle collection Le Renard Doré des éditions Rue de Sèvres. Une exploration d'un chat dans son environnement… Sûrement quelques surprises durant ses vadrouilles.
Designs: Histoire originale sur l'hybridation des humains avec la nature ce qui donne des personnages dotés de facultés assez particulières. Le sujet traite donc de l'évolution de la civilisation avec de nouvelles capacités et de nombreuses questions se posent à travers cette histoire sur notre propre évolution avec le monde. Le tome 4 sort le 26 avril 2024.
Sorcières : comment des sorcières sont à la fois le bouclier de la nature ou bien encore des êtres destruteurs. Disponible en France aux Editions Casterman - Sakka.
Saru : Légende issu des profondeurs de la Terre qui a l'apparence d'une puissance singe. Un jour son pouvoir se divise en deux: une partie physique et une partie mentale. Mais au fur et à mesure que la partie physique prend de la force, la partie mentale décroit. Cette décroissance est liée à la magie noire. C'est là qu'intervient Nana et Nawan Namugyaru pour enrayer ce déséquilibre de la nature. Editions Sarbacane
Les enfants de la mer (dernière de couverture - Editions Sarbacane) : Ruka, collégienne éprise de liberté, vit au bord de la mer. Alors que les vacances d'été commence à peine, elle fait la connaissance de deux garçons, Umi et Sora. Ils lui dévoilent un formidable secret : depuis leur plus tendre enfance, ils sont élevés par des dugongs, étranges et doux mammifères marins menacés de disparition. Les deux garçons fascinent Ruka, ils nagent si facilement dans la mer, c'est comme s'ils volaient dans le ciel...
Ce même été, des milliers de poissons disparaissent, comme évanouis, partout dans le monde - en pleine mer, et jusque dans les aquariums. Quelle est la cause de ce phénomène mystérieux ? Et pourquoi tant de gens s'intéressent-ils à Umi et Sora ?
Un conseil : Découvrez cet auteur avec des histoires très atypiques dans l'univers du manga.
2 notes
·
View notes
Text
youtube

Quel beau livre que celui-ci, de Lola Lafon : La petite communiste qui ne souriait jamais. C’est un biographie atypique de Nadia Comaneci, dont je me souvenais, lors des Jeux Olympiques ultérieurs à ceux qui ont fait instantanément sa gloire, ceux de Montréal en 1976. Plus tard, en 1980 à Moscou, ou à Los Angeles en 84, elle était attendue, et je savais l’aura qui accompagnait.
Pendant la lecture du livre, j’ai regardé en parallèle ses prestations lors des moments phares de son parcours en compétition. Comme Lola Lafon, j’ai essayé de scruter son visage, j’ai vu ses sourcils bien droits, ses ombres sous les yeux. J’ai essayé de deviner ce qu’elle pensait, ressentait. C’est impossible. Elle est opaque. Et c’est vrai que ses sourires sont rares, même en 1976, même quand elle détraque la machine à afficher les notes qui n’arrive pas afficher le premier 10 de l’histoire correctement !
Que se passe-t-il dans sa tête lorsqu’au Texas, elle est sommée de monter sur la poutre alors qu’elle a le bras qui la fait souffrir horriblement ? Elle y va néanmoins, exécute la plupart de ses figures sans appui, sauf pour la sortie, ce qui l’emmène droit à l’hôpital juste après la fin de l’épreuve, hôpital où on lui fait comprendre la gravité de son infection, les conséquences possibles qu’elle a frôlées. Peu importe, elle a fait gagner son équipe.
Il y a quelque chose de militaire dans son abnégation, mais de mystérieux aussi. Profondément intime. Peut-être un combo de talent, de volonté et de discipline, un mélange d’égo et d’oubli de soi insolite.
Oui, son entraîneur était spécial, mélange de père débonnaire et de baratineur, mâtiné de tortionnaire. Mais elle l’a aimé, et probablement dominé, à sa manière. Dès son plus jeune âge, elle n’a pas dit ses limites, et elle s’est ainsi protégée des attentes excessives. C’est du moins ce qu’elle dit. Quand on l’écoute parler dans les interviews tardives où elle ressemble désormais à une américaine plus vraie que vraie, il y a quelque chose qui reste opaque. Une façon de ne rien révéler de ses sentiments, de ses émotions. Elle garde ses secrets.
Et pourtant quel destin incroyable. Être une étoile au moment même où le régime communiste du fou Ceausescu se durcit, ce fut au début une chance, avec cet entraîneur Belà qui décida d’égaler voire de surpasser les russes, puis une malédiction. Elle devint alors une vitrine du communiste. Elle vécut la dépossession de son corps. Qui devait rester performant malgré la puberté, la tristesse, la privation. De 1981 à 1989, vivre en Roumanie, c’était très dur, tout autant pour elle que pour le reste de la population. La peur de la délation, la Securitate partout, la nourriture nulle part, le chauffage à 14, des décrets qui condamnent l’avortement, qui exigent des femmes de faire des enfants (5 !) (on est là dans un « réarmement démographique » pur et dur qui fait frissonner). Elle finit par faire de l’ombre à Ceausescu et tomba en disgrâce ; elle était surveillée, traquée, devint le jouet de son fils, jusqu’à sa fuite, de nuit, à pied, à travers la Hongrie, encore mystérieuse, trop proche de l’effondrement du régime pour être bien vue, devenue suspecte. On l’a accusée, en Occident, d’avoir bien profité du système et de l’avoir fui pressentant qu’il était en phase terminale. Et une fois au USA, la traque à nouveau, par les journalistes qui commentent tous ses faits et gestes.
Dans la biographie, Lola Lafon renvoie dos à dos les deux acteurs de la guerre froide. Dans une interview, elle parle de peste et de choléra. Au fond, le capitalisme est-il vraiment synonyme de liberté ? Ici, nos téléphones nous géolocalisent, le corps des femmes est tout autant scruté et commenté, la réussite est tout aussi ardemment recherchée. Elle refuse de simplifier ce conte de fée qu’on voudrait nous faire avaler : la petite fée, l’écureuil bondissant a rejoint l’Occident pour devenir libre ? Pas si simple. Et dans cette biographie atypique où la narratrice fait comme si Nadia commentait ses chapitres, la gymnaste au téléphone ou par mail, nuance la grisaille de la dictature, le soleil des USA, l’absence de liberté. Elle minimise la souffrance. Elle ne s’apitoie jamais.
Plus elle parle, moins elle se révèle et reste une énigme, de celles qui font les mythes.
NB : ci-dessus, les 7 épreuves où Nadia Comaneci a obtenu un 10/10 en 1976 à Montréal, à l’âge de 14 ans et est entrée dans l’histoire, celle de la gymnastique, mais aussi dans la grande.
#nadia comaneci#gymnastique#littérature#livres#litterature#roman#livre#Lola Lafon#éditions actes sud#montreal 1976#jeux olympiques#Youtube
4 notes
·
View notes
Text

𐙚 𝐁𝐀𝐒𝐈𝐂𝐒 - Yuna est née à Incheon, le 13 octobre 2000, et réside désormais à Séoul, dans un appartement qu'elle partage avec Eun-Hee. Elle est INTP, et se démarque par son amour pour les genres alternatifs, ainsi que les soirées étudiantes. Elle suit des études de sciences humaine, bien qu'elle trouve ça particulièrement ennuyeux. Yuna est lesbienne. Elle possède également une peur irrationnelle des araignées.
𐙚 𝐁𝐈𝐎 -
Yuna n’était jamais faite pour rentrer dans le moule - une enfant avec des aspirations créatives dans une famille extrêmement conservatrice, elle avait besoin de crier pour se sentir exister, et ce depuis toute petite. Elle a toujours préféré colorier en-dehors des lignes, et s’affirmer haut et fort, même si ça ne fait pas bon genre pour une petite fille d’une si bonne famille. Mais Yuna a toujours été claire sur un point : sa famille, elle l’emmerde. Elle n’est pas aveugle, la jeune enfant, voit bien ce qu’il se passe chez elle. Son père joue les moralisateurs, mais s’il embauche des secrétaires différentes tous les mois, c’est parce qu’il les vire une fois qu’il a couché avec, et si sa mère a l’air amorphe la plupart du temps, passive à souhait, c’est parce qu’elle s’enfile des boîtes de cachetons pour tenir le coup et oublier le fait que son mari est un infidèle notoire. Et Yuna refuse de rentrer dans le rôle qu’ils ont prévu pour elle, refuse d’être malheureuse dans une vie de merde.
Elle est rapidement rebelle, donc, et ça s’intensifie à l’adolescence - quand elle explose à leur visage et qu'elle leur avoue qu’elle est homosexuelle et qu’ils peuvent d’ors et déjà oublier leurs rêves de mariage et de descendance. ça crée forcément un fossé difficile à franchir entre ses parents et elle, tandis que la brune semble de plus en plus incontrôlable. Toujours fourrée dehors, elle semble reprendre vie quand elle est au contact de la fête, des autres, des émotions pures et dures, pas celles qu’on cache derrière des grands sourires. Et puis, quand elle a dix-sept ans, elle rencontre Ryuk, qui chamboule sa vie. Elle lui fait découvrir les joies de la scène underground, l’alcool qui coule à flots, et un joint toujours �� ses lèvres, mais surtout, elle lui fait découvrir l’amour.
Jusqu’à ce que ça cesse, brutalement. Non seulement Ryuk n’a aucun problème avec l’idée de tromper ouvertement Yuna - mais elle arrive à retourner la situation pour la laisser penser que c’est de sa faute, qu'elle ne la méritait probablement pas. Et encore une fois, l’état d’esprit de Yuna est clair : ils peuvent aller se faire foutre, s’ils pensent qu’elle va se ranger. C’est sans réfléchir qu’elle fait ses valises pour Séoul, rejoignant l’université dans un cursus qui ne la passionne que très peu et dans lequel elle n’excelle pas particulièrement. C’est justement parce qu’elle ne brille pas en classe qu’elle est forcée de rejoindre un club, pour des crédits supplémentaires, histoire de rattraper son année.
Autant dire qu’entre son physique atypique, et le fait qu’elle fasse la gueule en permanence, la foule ne se précipite pas pour la recruter. Hormis le ciné-club. Ils ont besoin d’une nouvelle personne pour gérer leurs réseaux sociaux - et dieu merci, parce que Yuna n’avait pas la moindre envie de s’investir dans quelconque projet cinématographique - et c’est à bras ouverts qu’ils l’accueillent. Contre toute attente, Yuna trouve enfin sa place, et une famille qui lui plaît avec les membres du ciné-club, et ce même si elle râle constamment, et que plus d’une fois, il a fallu l’enlever physiquement de Taehyun, qu’elle menaçait de frapper. Parce que c’est ça, le truc avec Yuna - elle a beau avoir renoncé, très fièrement, à une vie amoureuse, elle aime sincèrement, avec chaque fibre de son corps, chacun de ses amis, pour qui elle donnerait tout, à commencer par Eun-Hee, avec qui elle vit.
Et puis, Jubee. Jubee, qui va venir chambouler tout ce en quoi elle croit, ses certitudes sur les relations amoureuses, et lui faire comprendre que peut-être, elle vaut un peu mieux que leurs ébats entre les draps de l’étudiant qui avait le malheur d’organiser la soirée à ce moment-là.

𐙚 𝐓𝐑𝐈𝐕𝐈𝐀
Lorsque Yuna est interrogée sur sa famille, elle parlera à coup sûr des membres du ciné-club, mais jamais de ses véritables parents, à qui elle n'adresse désormais plus la parole - si elle aime sincèrement, c'est presque effrayant la façon dont elle parvient à se détacher de tout ceux qui ont lui fait du mal un jour, les maintenant à distance sans sourciller.
Yuna a manqué l'exclusion de l'université à deux reprises - une fois parce que ses résultats étaient catastrophiques, et la deuxième fois pour agression physique sur Taehyun, après une de ses énièmes tromperies. Elle sait très bien qu'il n'y aurait pas de troisième chance - et elle fait l'effort de se tenir un minimum à carreaux au moins pour le club, histoire de ne pas se faire renvoyer définitivement.
Yuna est plus observatrice et attentionnée qu'il n'y paraît - elle a juste d'atroces façons de le montrer aux autres. Aussi, même si elle ne verbalise jamais son inquiétude, ou bien son affection, c'est pourtant bien évident dans la façon dont elle reste constamment proche des filles quand elles sont avec elle en soirée - notamment avec Hua. C'est ce qui lui vaut la réputation de chien de garde du groupe, dont elle s'amuse particulièrement.
𐙚 𝐀𝐏𝐏𝐄𝐀𝐑𝐀𝐍𝐂𝐄&𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋𝐈𝐓𝐘
Yuna est plus que consciente que, d'apparence, son physique en dit bien plus sur elle qu'autre chose. Entre son amour des tatouages, toujours aussi visibles les uns que les autres, que ça soit sur son buste, ses bras, ou ses jambes, ou bien son apparente aversion des pantalons, se baladant constamment en short ou en jupe avec ses célèbres collants résille, elle porte définitivement sa rébellion sur elle. Elle est également excessive percée - et ça, combiné aux tatouages, est également une raison pour laquelle elle préfère être derrière l'objectif, afin de ne pas nuire à l'image du ciné-club.
Yuna est tout ce dont on ne rêve pas généralement : elle est sèche, dure, et possède une franchise relativement brutale. Néanmoins, c'est aussi sa façon d'aimer les autres - et rapidement, elle sait transformer ces défauts en qualité. Yuna est également particulièrement séductrice, ce qui lui vaut entre autres une petite réputation sur le campus. N'ayant aucun mal avec la solitude, elle se plaît même, parfois, à avoir sa seule compagnie, pour ne pas se sentir bridée.

𐙚 𝐉𝐔𝐁𝐄𝐄. Jubee, ça devait juste être le coup d'un soir - et puis, le coup de plusieurs soirs. Les deux savent qu'elles se plaisent, mais elles jouent aussi suffisamment franc-jeu pour ne pas faire espérer l'autre. C'est sympa, mais c'est uniquement physique. ça se complique, évidemment, quand la jalousie rentre en compte, quand il devient évident, pour l'une comme pour l'autre, que l'envie de passer du temps ensemble, que la compagnie de l'autre, devient bien plus importante que n'importe quelle partie de jambes en l'air.
1 note
·
View note
Text
TDAH, HPI, DYS... Comment savoir si mon enfant est atypique?
Ton enfant est-il atypique? Comment savoir et quoi faire? Tu observes que ton enfant ne rentre pas dans le moule. Il est curieux, sensible, plein d’énergie ou, au contraire, il semble en décalage avec les autres. Parfois, il se déconcentre en un clin d’œil, a du mal à s’organiser ou ressent les émotions de manière intense. Tu te demandes si cela cache quelque chose de plus profond. TDAH, HPI,…
0 notes
Text

Recherchons la sainteté
« Celui qui déclare demeurer en lui, doit marcher aussi comme lui ( le Seigneur ) a marché. » 1 Jean 2:6
Grâce à l’œuvre de régénération accomplie par la Parole, le Saint-Esprit peut nous transformer à la ressemblance de Jésus et ce, quotidiennement. C’est pourquoi les rachetés déclarent volontiers, avec un cœur reconnaissant : « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles ! Amen ! » Apocalypse 1:5-6
Le chrétien est porteur d’un « label sainteté » et il est appelé à exporter ce « label » dans notre monde obscur afin que celui-ci puisse découvrir la gloire du Seigneur Jésus et la nature sainte de Dieu.
Je vous invite donc à maximiser votre niveau de sainteté, ce qui vous permettra de demeurer ferme en cette fin des temps ! La sainteté vous confère de l’autorité face aux nombreuses séductions et convoitises du monde !
Cherchez à ressembler à Jésus ! Laissez le Saint-Esprit changer votre nature, laissez-le inscrire au plus profond de votre cœur, les valeurs morales divines. Veillez sur vous-même, car vous êtes le meilleur gardien de vous-même. Ne vous est-il jamais arrivé de faire ce genre de prière : « Seigneur garde-moi ! »
Je crois qu’il nous arrive à tous de la faire à certains moments critiques de notre existence. Mais cette prière est une prière plutôt atypique, c’est-à-dire hors norme. Pourquoi cela ?
Je m’explique. En fait, Dieu ne peut garder ce qu’Il nous demande de garder nous-mêmes. Il y a des choses que Dieu Se refuse de faire à notre place. Si nous faisons ce qui est en notre pouvoir, Dieu fera ce qui est en Son pouvoir. Si je fais ce qui est possible, Dieu, quant à Lui, fera l’impossible. Dieu ne fait pas ce que nous pouvons faire !
Le Seigneur nous a créés libres. Il est donc de la responsabilité de chaque enfant de Dieu de veiller sur lui-même.
Nous devons veiller à conserver notre relation intime avec Dieu afin de ne pas tomber dans le péché, mais aussi afin de maintenir un haut standard de sainteté.
C’est l’unique chemin qui permet de faire face aux plus fortes tentations.
Une prière pour aujourd’hui
Oui Seigneur, garde moi de chuter, de toute tentation qui pourrait T’attrister car Tu es saint et Ton désir est que je le sois aussi. Aide-moi à veiller sur mon cœur. Amen
( Toutes les pensées quotidiennes sur : *viechretienne. net/pensee-du-jour* ). ☀️réduire l'espace entre le "point" et le "net"☀️ dans votre barre d’adresse.
0 notes
Text
Objectifs de l'Otoplastie
L'otoplastie est principalement réalisée pour corriger les oreilles proéminentes, asymétriques ou présentant une forme irrégulière. Les objectifs spécifiques de cette intervention incluent :
• Réduire la Proéminence : L'objectif principal est de replier le cartilage de l'oreille pour la rapprocher de la tête, créant ainsi un contour plus naturel et moins saillant.
• Corriger l'Asymétrie : En plus de réduire la proéminence, l'otoplastie peut également corriger les oreilles asymétriques, assurant une symétrie esthétique.
Préparation pour l'Otoplastie
Avant l'intervention, il est essentiel de se préparer adéquatement :
• Consultation Préopératoire : Lors de la consultation avec votre chirurgien plasticien, discutez de vos attentes, de vos préoccupations et des résultats que vous espérez obtenir. Le chirurgien examinera également vos oreilles pour évaluer la meilleure approche chirurgicale.
• Évaluation Médicale : Un examen médical complet sera effectué pour s'assurer que vous êtes en bonne santé pour subir l'intervention chirurgicale. Le chirurgien discutera également de vos antécédents médicaux et de tout médicament que vous prenez actuellement.
• Consentement Éclairé : Avant l'intervention, vous devrez signer un formulaire de consentement éclairé, confirmant que vous comprenez les risques potentiels de l'otoplastie et que vous êtes d'accord pour procéder à l'intervention.
Déroulement de l'Intervention
1. Anesthésie : L'otoplastie peut être réalisée sous anesthésie locale avec sédation légère ou sous anesthésie générale, selon la préférence du chirurgien et la complexité de l'intervention.
2. Incision et Correction : Le chirurgien fera une incision discrète derrière l'oreille, dans le pli naturel, pour accéder au cartilage. Ensuite, il remodelera le cartilage en créant des plis ou en retirant l'excès de cartilage selon le cas spécifique.
3. Fermeture de l'Incision : Une fois la correction terminée, l'incision sera fermée avec des sutures fines et dissolvables, minimisant ainsi les cicatrices visibles après la guérison.
Récupération Après l'Otoplastie
Après l'intervention, il est important de suivre les recommandations postopératoires pour une récupération optimale :
• Pansements et Soins Postopératoires : Des pansements doux seront appliqués sur les oreilles pour protéger les incisions et soutenir les nouvelles formes des oreilles. Vous devrez probablement porter un bandeau de compression pendant quelques semaines pour maintenir les oreilles en position.
• Activités Limitées : Évitez les activités physiques intenses pendant les premières semaines pour prévenir toute complication. Votre chirurgien vous indiquera quand vous pourrez reprendre vos activités normales.
• Suivi Médical : Des visites de suivi seront planifiées pour surveiller la guérison des incisions et pour s'assurer que les résultats de l'otoplastie évoluent comme prévu.
À Quel Âge Peut-on Pratiquer une Otoplastie ?
L'otoplastie peut être réalisée chez les enfants dès l'âge de 5 ou 6 ans. Voici les raisons principales :
• Développement du Cartilage : À cet âge, le cartilage des oreilles est généralement suffisamment développé pour permettre une correction chirurgicale efficace tout en étant suffisamment souple pour faciliter la manipulation chirurgicale.
• Impact Psychosocial : Corriger les oreilles proéminentes dès le jeune âge peut prévenir le développement de problèmes psychosociaux, comme l'intimidation ou la baisse de l'estime de soi, souvent associés à une apparence faciale atypique.
En choisissant un chirurgien plasticien expérimenté et en suivant attentivement les instructions pré et postopératoires, les patients peuvent s'attendre à des résultats esthétiques satisfaisants et à une amélioration significative de la confiance en soi grâce à l'otoplastie.
0 notes
Text
Lecture Le manoir Thorne - Tome 1 : Les mailles du temps

Service presse venant de NetGalley Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? Nous continuons le périple dans les mondes imaginaires en nous plongeant dans un autre roman. Parés pour de la découverte ? Nous sautons dedans. Le manoir Thorne a toujours été hanté... et a toujours hanté Bronwyn Dale. Petite fille, grâce à une brèche dans le temps dans le manoir de sa grand-tante, Bronwyn rendait visite à William Thorne, un garçon de son âge né deux siècles plus tôt. À la suite d’une tragédie familiale, la demeure a été fermée et elle s’est convaincue que William n’a existé que dans son imagination. Vingt ans plus tard, elle hérite du manoir, et à son retour, William est là et l’attend. Et il n’est plus le garçon de ses souvenirs. Alors qu’ils ravivent la flamme de leur amitié et déclenchent d’autres étincelles, Bronwyn doit affronter des fantômes dans la version contemporaine de la maison. Elle se rend vite compte qu’ils sont liés à William et au scandale qui a ramené ce dernier au manoir. Pour avoir un avenir, Bronwyn va devoir se confronter au passé. Une romance, des enquêtes, des époques se mêlant et le paranormal bien présent sont des éléments que l'on retrouve dans ce roman qui attise la curiosité, titille les sens et arrive à donner envie de tourner les pages. L'intrigue m'aura tenue en haleine du début à la fin, je réfléchissais en même temps, me demandais si tel élément avait ou non son importance par rapport à cette dernière. Les éléments touchant au 19ème siècle sont bien exploités également, compréhensibles, du moins pour moi et j'ai adoré les voir prendre place tout en retrouvant tout ce qui touche à notre siècle, le 21ème. Les deux se complètent étrangement à merveille. La plume de Kelley Armstrong que j'ai découverte sur le coup m'a transportée, m'a permis d'apprécier les personnages, les lieux. C'est une très bonne chose, je trouve, surtout que les protagonistes avaient un comportement mature, une maturité bien présente dû au fait que ce ne sont ni des enfants, ni des adolescents et encore moins de jeunes adultes. La vie, elle a déjà été vécue par l'héroïne qui pourra, finalement, avoir une seconde chance au niveau de ses sentiments. Les frissons, l'angoisse, le duo se mêle au fil des pages, de ce que l'on découvre ou apprend. La surprise également, n'ayant pas pu deviner avant la fin ce qu'il se passerait... Il faut croire que je ne suis pas du tout Sherlock Holmes ! Le côté atypique de l'histoire peut également laisser perplexe, au début, pourtant il fait mouche assez rapidement, rien ne semble venir tel un cheveux sur la soupe et, en tout cas, ça m'a paru cohérent lors de ma lecture même au niveau des manières de parler, bien différente entre William et Bronwyn. Même la romance n'était pas lourde à suivre, se créant petit à petit et ce même si c'est un amour de jeunesse pour notre personnage principal. J'avoue être réellement curieuse du second tome, de ce qu'il ajoutera, montrera avec d'autres personnages que l'on rencontre dans ce premier volume. Cela permettra un lien entre les deux, ce qui n'est pas toujours le cas lors de changement de protagonistes. Vivement celui-ci, je l'attends avec impatience tout en me demandant si je m'attacherai aux "nouveaux" venus autant qu'à ceux que j'ai découvert ici... Je verrai bien ! En bref, une très belle surprise que je recommande les yeux fermés pour ceux appréciant les romances paranormales. Je suis certaine qu'il plaira à ces derniers et vous tiendra également en haleine tout du long, comme moi ! Et vous, connaissiez-vous ce roman ? L'avez-vous lu ? Read the full article
0 notes
Text
Penser une école inclusive
Le numéro de septembre-octobre 2024 de la revue des centres de documentation et d'information, INTERCDI, était consacré à un dossier intitulé Penser le CDI inclusif. C'est dans ce cadre que Kaltoum Mahmoudi, maîtresse de conférence au laboratoire Geriico de l'Université de Lille et rédactrice en chef de la revue, m'a sollicité pour un entretien afin de présenter la question de la politique institutionnelle sur l'inclusion.

Voici cet entretien.
Dans vos écrits, vous montrez que le projet d’une école inclusive se heurte à la fois à la « forme scolaire » et à une vision néolibérale de l’école. Si les enseignants sont globalement favorables à ce projet, ils sont pourtant face à des difficultés de mise en œuvre (Enquête IFOP du 4 septembre 2023). Selon vous, le projet d’une école pleinement inclusive est-il vécu, par les enseignants, comme une injonction ?
J’aurais plutôt tendance à penser que la majorité d’entre eux le perçoivent comme un objectif à atteindre pour toute l’institution, au même titre que les programmes, le socle commun et la réussite aux examens de leurs élèves. Dans toute ma carrière, que ce soit comme enseignant ou comme inspecteur, je n’ai rencontré que très peu de professeurs résolument hostiles à la présence d’élèves en situation de handicap dans leur classe.
En revanche, si l’immense majorité des enseignants cherche à bien faire avec des élèves atypiques, ils souhaitent naturellement disposer des moyens nécessaires pour leur délivrer un enseignement efficace.
Or si l’institution réduit son action au seul fait d’affirmer que la scolarisation de ces élèves est une obligation et qu’elle n’octroie pas aux enseignants les outils professionnels et les conditions nécessaires pour le faire, alors il est évident qu’une situation de tension peut apparaître. Ces outils et ces conditions relèvent trop souvent de l’impensé pour les responsables politiques, que ce soit au parlement ou au gouvernement.
Pourtant, il s’agit là d’éléments éminemment constitutifs de l’enseignement scolaire. Ils touchent aux techniques didactiques, aux supports matériels, à l’organisation matérielle de l’enseignement.
Par exemple, exiger une individualisation de l’enseignement auprès d’un professeur de collège ou de lycée qui n’a jamais appris à le faire en fonction des besoins particuliers réels de ses élèves, et alors que dans chaque classe il dénombre souvent plus d’une demi-douzaine d’élèves avec PAP[1], PPS[2], PPRE[3] ou PAI[4], et qu’il enseigne chaque jour et chaque semaine, selon sa discipline, à six ou dix-huit classes de plus de trente élèves chacune, c’est de fait créer une situation de tension humainement et professionnellement très difficile pour ce professeur. Dans ce registre, alors oui, on peut envisager que la scolarisation inclusive soit perçue comme une injonction formelle et hors sol de l’institution auprès des enseignants. On ne peut pas faire croire aux parents que l’école est un service à la personne. L’école est une institution qui instruit des enfants et des jeunes pour en faire des citoyens, et cela dans une dimension collective qui est le ciment de notre république. Le professeur n’est pas un précepteur particulier. Il s’adresse à une classe. Il peut prendre en considération des adaptations particulières, mais ces aménagements doivent rester raisonnables par rapport à sa mission qui est d’enseigner à une classe.
On pourrait aussi développer cette réflexion dans le registre des élèves présentant des comportements très perturbateurs, élèves de plus en plus nombreux, bien au-delà du domaine du handicap. La récente enquête de l’Autonome de Solidarité laïque conduite par Éric Debarbieux a mis en évidence que pratiquement tous les enseignants y sont désormais confrontés. Ce phénomène souvent spontanément associé à l’école inclusive ne concerne en fait qu’une frange des élèves en situation de handicap, alors qu’il touche beaucoup d’élèves « ordinaires » qui ne présentent pas de troubles du neurodéveloppement. Que dit l’institution pour permettre aux enseignants de faire face sérieusement et systématiquement à ce phénomène ? Il y a là un impensé qui compromet de plus en plus lourdement l’école, bien au-delà de sa dimension inclusive ou même du phénomène du harcèlement. Or des travaux sur ces phénomènes existent[5], avec des pistes éducatives et institutionnelles qui ont montré çà et là leur efficacité. Il serait utile de les enrichir et d’assurer leur diffusion.
Dans vos écrits, vous montrez que les décisions politiques récentes (notamment la loi de finances de 2024 qui prévoit le passage des PIAL au PAS, le « choc des savoirs » annoncé par le gouvernement) ne vont pas dans le sens d’une école inclusive. Pourriez-vous préciser en quoi ? Et comment les enseignants peuvent-ils alors conforter leur adhésion au projet d’une école inclusive dans ce contexte ?
Répondre de manière précise à ces questions demanderait la rédaction d’un rapport de plusieurs dizaines de pages dans lequel on développerait soigneusement les éléments constitutifs de la problématique, mais aussi les mécanismes systémiques en jeu par rapport aux objectifs et aux choix tels qu���ils sont envisagés. Dans un entretien comme le nôtre, on ne peut que se limiter à un développement succinct. Je vais essayer d’être clair en le faisant.
Ce qui relativise la portée et l’efficacité des choix de politique éducative récents que nous évoquons ici, c’est le fait qu’ils semblent avoir été conçus dans l’ignorance par rapport à deux corpus pourtant indispensables à intégrer si l’on veut agir utilement : d’une part, les études scientifiques et les enquêtes institutionnelles nationales et internationales sur les systèmes scolaires, d’autre part l’appréhension systémique du processus d’élaboration des réformes éducatives. Ainsi, les réformes éducatives, pour être efficaces, doivent recevoir l’adhésion de la majorité des acteurs concernés dans toute leur diversité. Il ne s’agit pas de se soumettre à la démagogie. Il s’agit de concevoir des évolutions qui prennent en considération tous les aspects de la problématique, notamment quand cela remet en cause des us et coutumes que l’on pensait intangibles. Ce qui est notoirement le cas quand il s’agit de transformer un système scolaire classique fondé sur la compétition comme source principale d’émulation, avec orientation par élimination progressive, en système scolaire inclusif universel. Et comme les enjeux sont importants pour les acteurs directs et pour la société entière, on doit prendre le temps d’impliquer les acteurs opérationnels dans la réflexion tant pour la conception que pour la stratégie de mise en œuvre. Toucher à l’école, c’est toucher à la société. Promouvoir une école inclusive, c’est viser à l’instauration d’une société inclusive, ce que n’est pas notre société actuellement.
Bref, on ne réforme pas l’école pour qu’elle devienne pleinement inclusive avec des communiqués de presse démagogiques et hors sol ou des articles cachés dans une loi de finances elle-même adoptée par le biais d’une procédure constitutionnelle sans débats.
Les enseignants sont des citoyens qui ont la particularité de faire partie de la part de la population la plus éclairée et la plus performante pour appréhender et gérer les difficultés dialectiques de la société. C’est un fait. On ne les manipule pas facilement. Leur esprit critique fait partie des compétences intellectuelles indispensables à leur mission. Il en va de même pour leur adhésion aux valeurs civiques fondamentales qui irriguent le contrat social de notre société. Dès lors, leur capacité de résilience par rapport aux errements des réformes des politiques éducatives est impressionnante quand on regarde avec du recul l’histoire de notre système scolaire. Cela soulève le respect. Chaque jour, ils enseignent à des millions d’élèves dans les classes. Où seraient ces enfants sans eux ?
Sur le plan philosophique, les principes d’une école inclusive entrent en harmonie avec leur crédo en une école qui émancipe et qui construit l’avenir de notre société démocratique. C’est là qu’ils puisent leur force pour résister aux nombreuses adversités auxquelles ils sont confrontés.
Mais ce sont des êtres humains comme tout un chacun. Il y a des limites. Personne n’a intérêt à ce qu’elles soient franchies. La récente augmentation des démissions, notamment par rupture conventionnelle, et la désaffection de plus en plus patente des candidatures aux concours de recrutement nous montrent que les grands équilibres ont été rompus. Tout le monde doit s’en inquiéter.
Dans vos écrits, vous mettez en relief les contradictions, les impensés voire les �� insensés » de ces décisions politiques. Que faudrait-il changer concrètement pour que les enseignants soient en capacité de mettre en œuvre le projet d’une école pleinement inclusive ?
Je pourrais développer un catalogue profus de mesures susceptibles d’engager une évolution efficace pour que l’école française devienne véritablement inclusive. J’avais par ailleurs consacré un article à cette question dans la revue associative en ligne du Café pédagogique.
Mais pour répondre sans prendre trop de place ici, je me limiterai à quelques orientations qui pourraient constituer la charpente de l’édifice.
En premier lieu, il faudrait absolument réduire le nombre d’élèves par division au collège où désormais la jauge de plus de trente élèves constitue une moyenne dans l’immense majorité des établissements. Dans un collège inclusif, une jauge moyenne entre vingt et vingt-cinq élèves par division permettrait aux professeurs de prendre en compte de manière effective les besoins éducatifs particuliers de leurs élèves dans toutes les classes auxquelles ils enseignent dans la semaine.
Ensuite, il faudrait que dans l’école primaire comme au collège, l’institution instaure le principe dit du « plus de maîtres que de classes », en y incluant des professeurs titulaires du CAPPEI (certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive) à même d’apporter une réponse pédagogique aux cas les plus particuliers. Cela permettrait toutes les formes d’aide et de soutien pédagogiques en direct et en continu : groupes de besoins, remédiation, co-enseignement.
Par parenthèse, on retrouve ces deux éléments dans les systèmes scolaires des pays les plus inclusifs. Cela n’a rien de révolutionnaire en soi. En revanche, cela a un coût budgétaire. Mais c’est à la Nation de l’assumer en conscience ou de réfuter son intérêt, sachant qu’il s’agit d’un investissement sur l’avenir et non d’une charge improductive.
Fondamentalement, toute la formation professionnelle des professeurs, initiale ou continue, devrait être imprégnée de la scolarisation inclusive, c’est-à-dire de l’accessibilité universelle des enseignements délivrés à tous les niveaux. Cela ne devrait pas faire comme aujourd’hui l’objet d’un module « à part » de quelques heures. Toutes les dimensions de la formation devraient en être imprégnées : que ce soit la formation didactique dans chaque discipline ou la formation au fonctionnement du système scolaire.
Pour terminer ce rapide catalogue, il apparaît indispensable de penser la dimension partenariale inhérente à l’école inclusive, et cela dans ses deux dimensions : intermétiers et intercatégorielle. D’une part, il conviendrait que l’école dispose en nombre suffisant de médecins, de personnels infirmiers et sociaux scolaires, alors que leurs effectifs sont actuellement en pleine déliquescence. L’école devrait aussi, comme la PJJ (protection judiciaire de la jeunesse, partenaire dans les dispositifs relais pour décrocheurs), disposer dans ses effectifs d’éducateurs spécialisés membres à part entière de l’Éducation nationale. De même, elle devrait disposer de professeurs de LSF (langue des signes française) à tous les niveaux, mais aussi d’interprètes en LSF et de codeurs en LfPC (langue française parlée complétée). D’autre part, formation au partenariat et temps de concertation indispensable au partenariat devraient évidemment être pris en charge par l’institution et reconnus comme faisant partie du temps de service usuel.
Il y aurait encore bien des éléments à prendre en compte, notamment sur le rôle, le statut, la formation et la rémunération des AESH, sur les programmes scolaires pas toujours cohérents entre eux ni avec l’accessibilisation des savoirs, l’évaluation des acquis scolaires réels et progressifs des élèves au-delà de la seule gymnastique numérologique des notes et moyennes, ou encore la profusion décourageante des dispositifs et sigles incompréhensibles accompagnés de formulaires numérisés ou non qui exigent de remplir des dizaines d’indicateurs par élève jusqu’à l’absurde, tout cela pour satisfaire la soif de statistiques de quelques-uns.
Le nombre d’enfants en situation de handicap scolarisés ne cesse d’augmenter. Il est passé de 134 000 en 2004 à plus de 436 000 en 2022 (selon Le Monde, du 06 février 2024). Pensez-vous que cette augmentation croissante puisse devenir un facteur de dégradation des conditions de travail des enseignants ?
Sur le principe, cette augmentation engage de facto une modification des conditions d’enseignement dans les classes et dans les établissements scolaires. Si on ne donne pas aux enseignants les outils et les moyens pour y répondre, alors oui, on pourrait redouter que cela se traduise par une dégradation des conditions de travail.
Dans cet esprit, on ne peut que s’inquiéter de constater depuis plusieurs années une hausse des saisines des comités compétents en matière d’hygiène et de sécurité sur la thématique de l’évolution de l’institution vers plus d’inclusivité. C’est un signal d’alerte que l’institution a le devoir de prendre en considération pour l’analyser, le comprendre dans toutes ses dimensions et apporter les réponses nécessaires sans renoncer aux objectifs inclusifs.
La scolarisation inclusive ne peut être effective qu’avec les enseignants, et surtout pas malgré ou contre eux. S’il y a un malaise, l’institution a le devoir d’en prendre sa part de responsabilité et l’obligation d’y remédier. Une politique publique efficace, c’est aussi une politique susceptible d’être adaptée par le législateur et l’exécutif en fonction des obstacles qu’elle génère et des angles morts dans sa conception. Il ne suffit pas de conjuguer à l’envi la notion de société apprenante dans certains cénacles à la pointe de la réflexion. Il faut que cette notion concerne concrètement toute politique éducative qui se veut progressiste.
Sans accompagnement ni présence d’enseignants spécialisés à leurs côtés, les enseignants font comme ils peuvent pour mettre en œuvre au quotidien, le projet d’une école inclusive. Parmi eux, les professeurs documentalistes accueillent tous les élèves au CDI (Centre de documentation et d’information) et déploient beaucoup d’énergie pour rendre ce lieu plus inclusif. Selon vous, quel est l’apport du CDI dans la mise en œuvre d’une école pleinement inclusive ?
Je répondrai avec beaucoup d’humilité à cette question. Je ne suis pas un spécialiste des CDI ni du métier de professeur documentaliste. Je n’en ai qu’une vision théorique, enrichie de quelques entretiens avec les principaux intéressés. Ce que je peux en dire pour essayer de répondre à votre question suscitera peut-être des agacements ou des appréciations ironiques.
De mon point de vue, une chose m’apparaît primordiale : les établissements du second degré ont la chance de disposer d’un CDI avec un professeur documentaliste qui est un vrai professionnel dans son domaine. C’est un atout considérable pour donner de la vie, de l’intelligence et du dynamisme aux actions d’enseignement.
J’ai pu constater que de nombreux professeurs documentalistes ont souhaité acquérir le CAPPEI. Ce n’est pas anodin. Rien ne les y a contraints sur le plan institutionnel. En revanche, comme tous les professeurs de leur établissement, ils sont conduits à exercer leur mission avec des élèves qui sortent du schéma moyen en raison de besoins éducatifs particuliers à plus ou moins long terme : élèves en situation de handicap avec toute la variété des troubles, élèves présentant des troubles spécifiques des apprentissages et du langage avec des PAP, élèves allophones, élèves de Segpa, élèves des dispositifs relais. Ces élèves peuvent venir au CDI avec leur classe ou individuellement, dans le cadre d’un projet temporaire ou de manière régulière, seuls ou accompagnés.
Le professeur documentaliste est d’emblée confronté à une problématique pédagogique primordiale de la scolarisation inclusive : l’accessibilité des situations. En raison des besoins particuliers de l’élève, considérés du point de vue éducatif, des adaptations peuvent s’avérer nécessaires, soit sur les supports documentaires, soit sur les modalités d’accès aux supports documentaires, ou encore sur les modalités de traitement de la documentation.
Cela suppose pour le professeur documentaliste l’appropriation de deux corpus de références à parti desquels il pourra engager son action pédagogique : d’une part, une bonne identification du profil particulier de l’élève sur les plans moteur, sensoriel, langagier, cognitif ou psychique ; d’autre part une bonne connaissance des possibilités techniques matérielles ou virtuelles d’adaptation en vue de permettre une accessibilité la plus opérationnelle possible à l’élève. Cela concerne aussi bien les supports documentaires dans toute leur variété que les espaces du CDI ou même la gestion du temps. Enfin, le professeur documentaliste aura tout intérêt à pouvoir encadrer son action par un partenariat éclairé avec ses collègues qui connaissent bien l’élève ou les élèves présentant des profils atypiques, qu’ils soient professeurs de la classe, coordonnateur d’Ulis, professeurs spécialisés de référence, professeurs de Français langue seconde, etc. Parfois, il faudra étendre ce partenariat à des professionnels non-enseignants qui accompagnent l’élève : AESH, évidemment, mais aussi PsyEN, rééducateurs des services médico-sociaux partenaires, éducateurs spécialisés, interprètes LSF et codeurs LfPC.
Pour terminer, j’évoquerai aussi une action professionnelle qui ne peut qu’être appréciée par l’équipe pédagogique de l’établissement : la mise à disposition d’un corpus documentaire relatif aux besoins éducatifs particuliers des élèves de l’établissement, qu’il s’agisse des outils pédagogiques adaptés ou des références documentaires à l’attention des enseignants et accompagnants. À cet égard, le professeur documentaliste a tout intérêt à s’abonner à la lettre de l’Insei, l’Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation inclusive.
En considération de ces quelques éléments, on comprend aisément pourquoi des professeurs documentalistes souhaitent bénéficier de la formation préparatoire au CAPPEI.
Je souhaiterais revenir sur la notion de partenariat nécessaire à l’école inclusive que vous évoquiez précédemment. Lorsque j’étais professeure documentaliste en lycée, j’accueillais des classes pour développer les apprentissages informationnels des élèves, en partenariat avec les enseignants de disciplines. Je me suis retrouvée, plus d’une fois, face à des élèves à besoins particuliers, sans jamais avoir été prévenue de leurs situations. Tous les enseignants, nous y compris, sommes de plus en plus sollicités, « noyés » sous diverses tâches notamment administratives. Nous ne prenons pas toujours le temps nécessaire à la transmission des informations. Comment favoriser un partenariat visant l’inclusion des élèves alors que cette logique de cumulation des tâches ne cesse de s’accentuer ?
Ce que vous évoquez ici est une réalité qui s’impose à nous : la capacité inclusive de l’institution scolaire implique que ses acteurs – quelles que soient leurs fonctions et leur place – soient en mesure de se concerter et d’échanger rapidement des informations diverses pour adapter leur action et rendre accessible l’enseignement en fonction des besoins des élèves. Or notre civilisation ne cesse de soumettre ces mêmes acteurs à une avalanche d’informations tous azimuts, avec l’obsession systématique de vouloir tout embrasser et de rendre compte de tout, à tout moment, et cela dans une logique qui associe les exigences économiques, le meilleur rendement et une efficacité absolue au regard des attentes supposées de l’usager et de la hiérarchie administrative et politique.
Deux facteurs historiques ont accentué ce phénomène. Évidemment, l’irruption au début de ce siècle de la numérisation totale de l’information et de ses canaux d’échanges avec cette sorte de dictature cognitive des tableaux et feuilles de calcul qui transforment la vie humaine en données quantifiées analysables à l’infini. Et à la même période, en France, est arrivée l’adoption de la loi organique sur la loi de finances, celle du budget de l’État, qui soumet le service public à des indicateurs chiffrés, des cibles annuelles, et des objectifs de performance.
L’école inclusive n’échappe pas à cette obsession : la dictature du chiffre pour rendre compte en permanence des budgets dépensés s’impose aux établissements scolaires, aux directions académiques, aux rectorats comme à la Dgesco. Au mieux, cela se traduit par de belles infographies flatteuses sur le nombre d’élèves handicapés scolarisés, d’AESH, d’Ulis, etc. Mais la réalité pédagogique dans la classe et dans l’établissement n’est pas représentée dans ce travail de production de données chiffrées qui est pourtant censé rendre compte de la vie à l’école.
Ainsi, pour notre école inclusive et la nécessité d’échange de l’information entre les acteurs, le gouvernement a mobilisé la CNSA[1] (tutelle des MDPH) et l’Éducation nationale pour développer le LPI (livret de parcours inclusif), une application en ligne censée faciliter la mise en place rapide et effective des aménagements et adaptation. Concrètement, la mise à disposition de cette application s’est heurtée à une multitude de difficultés techniques dans le cadre de l’interopérabilité avec les systèmes d’information qui existaient déjà, tant du côté de l’école que du côté des MDPH, mais aussi des obligations liées à la protection nécessaire des données personnelles et médicales. Cela a pris plusieurs années pour obtenir une application à peu près stabilisée. Et au final, on a un produit qui veut compiler tant d’informations qu’il y a là une véritable usine à gaz aussi chronophage pour ceux qui doivent entrer les innombrables données requises qu’inopérante pour le travail quotidien dans l’établissement et dans la classe.
Prenons encore l’exemple des PAP qui sont réduits à des listes de cases à cocher sans âme. Le concepteur a voulu être tellement complet dans la recension du champ des possibles adaptations qu’il a construit un formulaire roboratif dénué d’appel à l’intelligence pédagogique et éducative : c’est désormais une liste de courses avec des produits à cocher machinalement. Pour être sûr de ne pas se tromper, on aura naturellement tendance à en cocher le plus possible, quitte parfois à cocher des choses complètement inutiles, voire parfaitement inadaptées aux besoins réels de l’élève. Comment s’étonner alors que certains professeurs n’y prêtent pas attention ? « Qui trop embrasse, mal étreint », nous rappelle le dicton.
Concrètement, je pense que le partenariat doit être assumé par l’institution en incluant dans le temps de service de ses agents un volume horaire hebdomadaire annualisable et consistant pour toutes les concertations indispensables à la capacité inclusive de l’école : entre collègues, avec les parents, avec les partenaires internes et externes, pour les réunions institutionnelles afférentes, etc. Et puisque que notre civilisation est celle du chiffre, il faut que ce temps soit effectivement comptabilisé et valorisé. C’est du temps entre être humains indispensable pour donner de la vie à l’école inclusive.En conclusion, pour répondre de manière pragmatique à votre question, prenez le temps de discuter avec vos partenaires dès que l’occasion s’en présente. Ce temps est rare. Il faut le préserver et le soigner. C’est souvent gratifiant sur le plan humain. Ce n’est pas du temps perdu. C’est du temps pour la vie.
[1] Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie créée par la loi handicap de 2005 : c’est le gestionnaire de la 5e branche de la Sécurité sociale, la branche Autonomie.
[1] PAP = Plan d'Accompagnement Personnalisé
[2] PPS = Projet Personnalisé de Scolarisation
[3] PPRE = Programme Personnalisé de Réussite Éducative
[4] PAI = Projet d’Accueil Individualisé
[5] Quelques exemples :
Comment gérer les comportements en classe ? – Le Passeur, lettre nº 11 du Conseil scientifique de l’Éducation nationale, mars 2024
Prévenir et gérer les problèmes de comportement en classe : préparation perçue de futurs enseignants suisses et québécois – Revue suisse des sciences de l’éducation, septembre 2018
La scolarisation des élèves présentant des difficultés comportementales : analyse écologique des conditions relatives à leur intégration au secondaire – Revue canadienne de l’éducation nº 41:2, 2018
Les comportements difficiles en classe : pistes de solutions pour mieux former les enseignants en exercice et favoriser la réussite des élèves – La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation nº 53, 2011
0 notes
Text



Les enfants du fleuve, Yohanne Lamoulière, rencontre d'Arles 2023
La photographe a réalisé un long trajet sur le Rhone à bord d'une embarcation qu'elle avait elle même réalisé (en mélangeant une péniche et une caravane) et a naviguer le long du Rhone (depuis la suisse jusqu'a Marseille) en prenant des photos des riverains, atypiques ou non, qu'elle croisait.
Crédit photos : Rencontre d'Arles 2023
0 notes
Note
Coucou ! :D Pour le jeu des questions, les questions 10, 20 et 29 pour Ismène ou Zoé selon ce qui t'inspire le plus ? Merci d'avance ! :D
OC asks that reveal more than you think
Coucou et merci pour les questions 👋 Du coup j'ai fait les deux :D. Surtout que ça m'a permis de partager des extraits de ma fic interrompue et de l'histoire de Zoé.
10. What age do they want to be the most right now?
Ismène est satisfaite de l'âge qu'elle au début de l'histoire (21 ans) même si elle sait qu'elle a encore beaucoup à apprendre. Là où ça coince, c'est en côtoyant les autres agarthais. Elle se voit souvent rappeler qu'elle est face à des gens qui ont vécu des centaines d'années, voire un millénaire, et que son existence n'est qu'un grain de sable dans la leur. D'ailleurs, certains continuent de la traiter comme une enfant à cause de ça.
C'est pour ça qu'Anselma disait qu'il fallait qu'Ismène puisse interagir avec des gens de son âge. Et quel que soit la route, elle en retire aussi beaucoup de bien.
C'est aussi une source d'inquiétudes pour Stéphanos qui, après la mort d'Anselma, se prend le caractère éphémère de la vie humaine en pleine face :
"Il la garderait (Anselma) avec lui pour les siècles à venir. Un jour, Ismène mourrait aussi. Il était l’urne de leur souvenir, le spectateur silencieux de la pièce. Cette pensée donnait parfois envie à Stephanos d’ouvrir la réserve de tsípouro. L'eau-de-vie n'emporterait cependant pas l'inévitable."
-Zoé à 27/28 ans au début de l'histoire. Elle regrette parfois l'année de ses 25 ans. Elle était alors sur le point de se marier avec son fiancé, Démétrios (quel que soit l'univers, c'est le prénom des gens bien !), et se pensait être la femme la plus heureuse du monde. Zoé se sent maintenant comme un arbre touché par l'hiver. Elle est aussi nostalgique de son enfance, lorsque ses parents étaient vivants. Le plus gros enjeu était alors de faire une bataille de boules de neiges ou un concours de tir à l'arc avec son grand-frère Manuel (qui a 3 ans de plus qu'elle).
20. What do they like that nobody else does?
Je sèche pour cette question ^^. Je ne leur vois pas de goûts vraiment atypiques. J'ai essayé de regarder des plats grecs étranges ou insolites (vu que ça collait pour les deux) mais rien ne correspondait (végétarienne ici). Même si je n'ai aucun soucis à décrire mes personnages en train de manger de la viande, ça allait trop loin pour moi et je me voyais mal écrire "elles aiment ce truc envers et contre tout !!!".
29. What recurring dreams do they have?
Ses yeux vitreux fixaient le vide. Zoé chercha le métal froid de l'amulette à son cou. Sa compagne de chambrée la laissa sans jugement. Zoé étant une guerrière, elle devait certainement avoir vu des choses.
-Zoé revit souvent en rêve les différents combats dans lesquels elle a été impliquée. Notamment un combat où elle a tué une jeune guerrière ennemie qui avait la même couleur de cheveux qu'elle et dont c'était sans doute la première bataille. Cet épisode a agi comme une sorte de rappel de la vacuité et de l'absurdité de la violence.
Elle rêve aussi souvent de Démétrios, souvent avec des cauchemars (et c'est d'un de ces rêves qu'elle se réveille dans l'extrait du dessus).
Elle l’enlaça, le tint contre son sein palpitant, le frictionna et le réchauffa de toutes ses forces. Le corps resta de pierre. Et soudain, elle sentit un ressac salé et amer, une caresse froide. L’eau était là, au pied de son lit.
-Ismène rêve parfois d'Anselma de manière plus ou moins heureuse. La chanson que je lui associe est Only if for a night de Florence and the Machine qui a été inspirée à la chanteuse par un rêve fait à propos de sa grand-mère décédée.
And I heard your voice, as clear as day And you told me I should concentrate It was all so strange, and so surreal That a ghost should be so practical Only if for a night
Elle fait aussi parfois des cauchemars inspirés par tous les récits qu'elle a pu entendre sur le déluge, en mélangeant avec les événements de son quotidien :
C’était fini. Aucun abri n'existait face à la colère du ciel. L’orgueil de Shambhala ne contiendrait cette puissance furieuse. La cité serait leur tombe aquatique. Sylvain l’attira à lui. Elle l’agrippa. Ils ne se détournèrent pas et affrontèrent ensemble ces dernières secondes déchirantes. La vague les engloutit.
(Oui, j'aime le mythe de l'Atlantide).
#answered asks#lilias42#my ocs#ismène#zoé dame du palais#for those who want to ask questions you can browse my “my ocs” tag#écriture
1 note
·
View note
Text
youtube
👪 𝗜𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘𝗥 𝗔𝗖𝗛𝗔𝗧 ⤵⤵
Vente Appartement F4 exceptionnel proche 7ème Km 🏢🌟
Ne manquez pas cette opportunité unique de devenir propriétaire de cet appartement atypique d'environ 100 m2 ! 💎
Cet F4 vous offre :
🍽 1 cuisine équipée pour régaler vos proches 🛋 1 salon spacieux et accueillant 🛏 2 chambres enfants avec leur salle d'eau et WC, idéal pour leur intimité 🚽 1 WC séparé pour vos invités 👑 1 chambre parentale avec sa salle d'eau pour votre confort 🧺 1 buanderie pratique et fonctionnelle 🌞 1 terrasse pour profiter des beaux jours
Profitez d'un appartement climatisé, équipé de placards intégrés et de volets roulants pour un confort optimal. 🌡
En plus de ces prestations, bénéficiez d'un grand cellier et de deux places de parking sécurisées et fermées. 🚗
⏳ N'hésitez plus, venez le visiter ! Contactez-nous dès maintenant pour prendre rendez-vous 🗓📞📩
📑 Fiche descriptive : https://immobilier-noumea.nestenn.com/appartement-f4-au-7eme-km-dernier-etage-ref-38495378
Son prix : 28 900 000 XPF ( Frais d'agence inclus)
☎ Contact : Angélique au 74 33 88
Noumea #NouvelleCaledonie #NewCal #Nestenn #AcheterMaison #Immobilier #appartementnc #Nestenn #NestennNc #VenteAppartement #F4 #Immobilier #7èmeKm #AppartementAtypique #CuisineÉquipée #ChambresEnfants #ChambreParentale #Buanderie #Terrasse #Climatisation #VoletsRoulants #Cellier #ParkingSécurisé #AVisiter #Opportunité #InstaImmobilier #DevenezPropriétaire
0 notes
Text
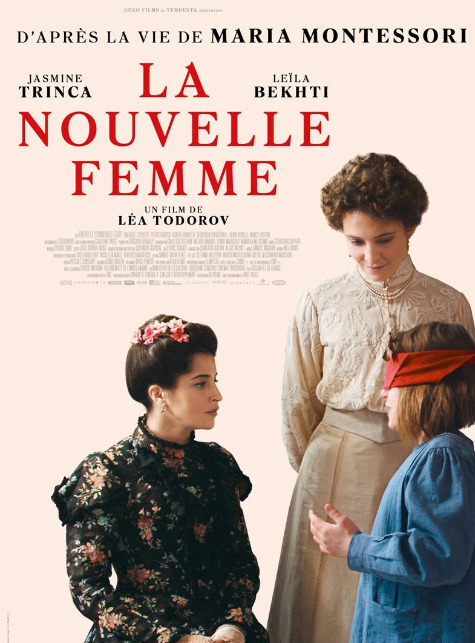
LA NOUVELLE FEMME - En 1900, Lili d’Alengy, célèbre courtisane parisienne, a un secret honteux - sa fille Tina, née avec un handicap. Peu disposée à s’occuper d’une enfant qui menace sa carrière, elle décide de quitter Paris pour Rome.
Elle y fait la connaissance de Maria Montessori, une femme médecin qui développe une méthode d’apprentissage révolutionnaire pour les enfants qu’on appelle alors «déficients». Mais Maria cache elle aussi un secret : un enfant né hors mariage. Ensemble, les deux femmes vont s’entraider pour gagner leur place dans ce monde d’hommes et écrire l’Histoire.
A la fin du XIXème siècle et au tout début du XXème apparaissent en Europe plusieurs expériences de pédagogie alternatives, recentrées sur l’apprenant, plutôt que sur le contenu, renonçant à la compétition pour s’adapter à l’intelligence et au rythme de l’élève. Ces pédagogies séduisent encore aujourd’hui des parents qui y voient une réponse aux carences de notre système éducatif.
La grande majorité d’entre elles sont pratiquées par des écoles privées et n’ont d’autre ressources financières que celles des parents d’élèves, ce qui induit des frais scolaires mirobolants… A l’origine on retrouve Célestin Freinet, un instituteur en France, Rudolph Steiner, un philosophe en Autriche, et deux médecins, Ovide Decroly en Belgique et Maria Steiner en Italie. Au point de départ ces pédagogues se sont intéressés au sort des enfants «irréguliers» et souhaitaient une réelle émulation entre les enfants de toutes origines, considérant l’école comme vecteur d’évolution et d’autonomisation….
Dans « La nouvelle femme » Léa Todorov, formée à l’origine au documentaire, se penche sur les début de Maria Montessori : une Nouvelle Femme, selon l'expression qu'utilisent communément les historiens pour désigner ces femmes féministes, éduquées et indépendantes de 1900 qui avaient réussi à accéder à des fonctions professionnelles et à des carrières universitaires, et qui affirmaient une place dans la société par le savoir. Maria Montessori est médecin, un métier pour laquelle elle a dû lutter contre les préjugés familiaux.
Méprisée par ses confrères, considérée par une éternelle mineure par sa famille, à qui elle a caché l’existence d’un fils né hors mariage, placé chez une nourrisse à la campagne, subissant de plein fouet le joug d’une société patriarcale y compris dans son travail, puisque son compagnon et associé Giuseppe, est le seul qui attire la lumière et reçoit un salaire !! Son compagnon est aussi le père de son enfant, elle ne veut pas l’épouser considérant le mariage comme une aliénation. Dans le film, Léa Todorov a choisi de se porter sur les débuts de la carrière de Maria Montessori, quand elle développe une méthode d'apprentissage adaptée aux enfants mentalement déficients qu’elle transposera ensuite en tant que méthode d'enseignement pour tous les enfants, « la méthode Montessori » avec le but qu'ils deviennent des adultes indépendants et capables de s'adapter.
Mais pour raconter cette histoire, Léa Todorov a fait un choix dont on est en droit de se demander s’il est vraiment judicieux : introduire auprès de Maria Montessori un autre personnage féminin, le personnage fictionnel de Lili d'Alengy (Leila Bekhti), une courtisane parisienne, mère honteuse d'une petite fille neuro-atypique et qui, à ce titre, va chercher à se rapprocher de Maria, laquelle l’incitera à regarder sa fille avec toute a tendresse qu’elle mérite; et tout simplement à l’aimer.
Pourquoi choisir une de ces femmes qualifiées à l’époque de « cocottes » comme autre personnage féminin important du film ? Afin d’incarner un autre modèle de femme indépendante de cette époque, répond Léa Todorov, une femme puissante et libre sans pour autant avoir le savoir académique de Maria Montessori. Cela donne un certain décorum un peu superfétatoire, et qui fait passer la Méthode Montessori au second plan …
Toutefois, malgré les réticences qu’on peut avoir vis-à-vis de cet aspect du film, on ne peut que louer le jeu de Jasmine Trinca et de Leïla Bekhti, les interprètes de Maria et de Lili, ainsi que les prestations très émouvantes et d’une grande vérité des enfants neuro-atypiques choisis pour incarner ce qui est plus ou moins leur propre rôle, avec une mention particulière pour Rafaëlle Sonneville-Caby, l’interprète de Tina, la fille de Lili.
NOTE 13/20 - Biopic féministe aussi pédagogique que son sujet, le premier long-métrage de fiction de Léa Todorov n’échappe pas à la démonstration ni aux scènes d’émotion attendues (et surlignées).
0 notes