#marchand de journaux
Explore tagged Tumblr posts
Text

Vivian Maier, marchand de journaux, New York, mars 1954.
84 notes
·
View notes
Text

Bon jour ,bonne semaine à tous ☕️ 📰
Au coin, les journaux🗼Paris
Photo de Paul Child 1960
#photooftheday#photography#vintage#paul child#paris#marchand de journaux#journal#newspaper#bonjour#bonne semaine#fidjie fidjie
60 notes
·
View notes
Text

en vente dés maintenant chez ton marchand de journaux !
#silu's art#mlb la terreur au#miraculous ladybug#miraculous ladybug and chat noir#mlb fanart#adrien agreste#mireille caquet#xavier yves roth#lt galattaca girls#nino lahiffe
1K notes
·
View notes
Text
“Ciebie mała panienko z Antyli pamiętam chyba najlepiej. Widziana raz jeden chez le marchand des journaux, patrzyłem oniemiały, wstrzymałem oddech – aby nie spłoszyć i przez chwilę myślałem – że idąc z tobą odmienilibyśmy świat.”
– Zbigniew Herbert, “Przysięga”
#zbigniew herbert#przysięga#wiersz#poezja#herbert#polski cytat#polska#po polsku#polski tumblr#polski blog#polish literature#polish#literary quotes#polska literatura#polskie cytaty#cytaty po polsku#cytaty o miłości#cytaty#cytat po polsku#miłość
7 notes
·
View notes
Text
Whumptober 06 : Healed Wrong
Mal remis, Sherlock Holmes 2009
Holmes ne lui avait pas adressé un mot depuis qu'ils étaient rentrés en fiacre du Midland Grand.
Sa jambe blessée, que John avait soignée d'autorité à leur arrivée à Baker Street, privait le détective des sorties mal famées auxquelles il se livrait généralement dans ses accès de mélancolie. Son violon aussi était resté silencieux, à la surprise du médecin, qui s'était, bien qu'à ses oreilles défendantes, accoutumé aux geignements torturés que son colocataire arrachait à l'instrument lorsqu'il broyait du noir, ou qu'il voulait se venger de Watson pour une raison ou une autre.
Holmes avait claqué la porte de sa chambre et n'en était plus ressorti.
« Quel calme ! » s’extasia une patiente en sortant du cabinet de John. Quel repos pour les tympans ! Quel apaisement de l’esprit !
Le temps passé en silence et dédié aux malades du quartier fila vite et on fut bientôt le soir. Peu désireux de braver la colère de Holmes, John sortit acheter du tabac chez un marchand qui l’importait d’Afghanistan et dont la boutique se trouvait à l’arrière de Regent’s Park. Il prit son temps pour revenir et se roula plusieurs cigarettes sous la porte cochère de la Oliver Inks Company, dont les charmantes employées finissaient leur journée à cette heure. Plusieurs le saluèrent d’une œillade appréciatrice et il leur répondit en soulevant son chapeau.
Mais ces galanteries sans enjeu ramenèrent sa pensée sur la dernière victime de Miss Adler… et il se résolut à rentrer.
La porte de la chambre de Holmes était toujours fermée ; il toqua avec vigueur. Pas de réponse. Il tourna la poignée. Les rideaux tirés filtraient la lumière qui provenait des becs-de-gaz allumés dans la rue, et plongeaient la pièce dans une obscurité confuse.
Holmes était allongé de tout son long en travers du lit, les pieds pendant à l’extérieur. La jambe de son pantalon noir était restée roulée au-dessus du genou, sans doute pour ne pas irriter son mollet mâché. Dormait-il ?
John s’approcha pour le réveiller, quand une canne s'interposa. Il soupira.
« Holmes, laissez-moi examiner votre blessure. Il va falloir changer le pansement.
– Merci, Watson, vos soins ne sont pas requis ici. Vous en avez bien assez fait.
– Je ne m’excuserai pas de vous avoir sauvé la vie.
– S’il s’agissait de cela ! rétorqua le détective d’un ton de mépris suprême. Mais vous vous montez la tête. L’an dernier, deux femmes ont survécu alors qu’elles ont été vaccinées trois jours après leur morsure. Les recommandations de vos journaux de praticien trahissent la frilosité de vos confrères, car les constats de la science…
– Les constats de la science sont que beaucoup trop de gens meurent parce qu’ils n’ont pas été vaccinés assez vite, Holmes. Si vous regrettez de n’être pas de leur nombre, il ne tiendra qu’à vous d’y remédier en courant les animaleries pour vous faire épouillé par un macaque contaminé ! Cela ne changera guère de votre ordinaire. En attendant... »
Il posa une main sur l’épaule noueuse de son ami, bien décidé à finir ce pour quoi il avait navigué les écueils du capharnaüm sans nom qui lui servait de chambre, quand celui-ci se retourna vivement.
Holmes lui jeta un regard qu’il voulait certainement indigné, prélude au deuxième mouvement de ses récriminations, mais qu’il peinait à fixer. Ses iris presque noirs s’étaient troublés comme un mauvais goudron et le blanc de ses yeux brillait d’un éclat de fièvre.
John s’empressa d’autant plus d’examiner le pansement ; ce dernier s’était imbibé de sang et devait être refait, mais les bords de la morsure n’avaient pas gonflé et les muscles n’étaient pas échauffés. La fièvre ne venait pas de là.
Restaient l’autre hypothèse. John avait espéré que la constitution plus que solide de Holmes – laquelle résistait quotidiennement aux assauts des criminels, de la boxe, de l’alcool et de la cocaïne, pour ne citer qu’eux – lui aurait épargné ce type de réaction au vaccin, mais ils n’auraient pas cette chance.
Il n’y avait malheureusement rien d’autre à faire que d’attendre que ça passe. Une chose que John avait répétée à des centaines de familles inquiètes au cours de sa carrière, qui recevaient ce conseil avec un air de perplexité dont il ressentait aujourd’hui les échos dans ses nerfs irrités. En réponse, il détaillait en général une liste d’instructions, qui servaient davantage à les occuper qu’à accélérer la guérison de leurs proches – des efforts palliatifs à tout le moins.
Donner à boire : ce qui impliqua de se lancer dans la quête d’un verre à eau propre, mission qui exigea un examen attentif des résidus suspects qui adhéraient trop souvent au fond des gobelets, des flasques et autres brocs qui traînaient sur les étagères et les tables dans la chambre de Holmes, comme dans tout l’appartement. Il s’agissait de ne pas abreuver le détective avec l’un des poisons qu’il s’ingéniait lui-même à répliquer ou à inventer. D’ordinaire, John contournait ce risque en ne buvant que les boissons apportées au moment des repas par Mrs Hudson, mais il n’avait guère l’énergie d’affronter leur logeuse revêche. Il se contenta de laver trois fois le verre qu’il trouva sur sa propre table de nuit avant d’obliger Holmes, qui était retombé dans une somnolence marmottante, à le boire.
Réduire la température de la pièce : une bonne excuse pour ouvrir la fenêtre de la chambre de Holmes et pour dissiper, en aérant, la fumée de pipe et les odeurs chimiques qui empestaient l’air et semblaient vous brûler les poumons.
Surveiller la fièvre : cette veille régulière plaça John dans la situation peu commune de lutter lui-même contre le sommeil tandis que son ami sombrait dans les bras de Morphée – d’ordinaire, la discipline militaire qu’il avait durement acquise lui permettait au contraire de maintenir des heures de coucher raisonnables, même quand Holmes se livrait à d’improbables entreprises aux improbables horaires. Cette fois-ci, le médecin resta en alerte jusqu’à minuit pour prendre la température de son ami et constata avec inquiétude qu’elle continuait de grimper.
Calmer le malade et l’inciter au repos : une entreprise qui se révéla difficile au matin, lorsque la léthargie de Holmes fut remplacée par une agitation confuse. Sa fièvre n’avait pas baissé, mais elle paraissait en revanche lui insuffler une énergie nouvelle et trompeuse, qui l’avait incité à déployer carnets, encre et porte-plume au milieu de son lit, depuis où il se livrait désormais à des spéculations cabalistiques dont John ne pouvait percer un seul mot, quoiqu’il imaginât bien qu’elles concernassent la retraite actuelle de Miss Irene Adler. Il grimaça en voyant les taches noires projetées sur les draps comme une constellation destinée à enrager Mrs Hudson.
La négligence de Holmes à l’endroit de la literie, que sa maladie aurait pu excuser si elle ne s’était pas manifestée déjà si fréquemment dans d’autres circonstances, l’arrangeait d’autant moins qu’il allait lui falloir solliciter l’aide de la matrone : il avait trop perdu aux cartes la semaine dernière pour s’autoriser à négliger sa patientèle un second jour d’affilée, car Mrs Hudson ne serait certes pas plus contente s’il manquait de lui payer le loyer dû dans trois jours.
La logeuse, venue porter le petit-déjeuner, demeura de marbre lorsque John lui expliqua en quoi il avait à nouveau besoin de son aide (en lui exposant ses raisons dans une version expurgée des considérations pécuniaires), avant d’accepter avec un unique soupir.
Même un joueur invétéré comme John savait reconnaître quand il s’en tirait à bon compte… et il fila sans demander son reste, avec l’espoir que son cabinet ne lui apporterait ce jour-là rien de plus grave que des rhumes et des entorses.
Hélas, son vœu ne fut pas exaucé.
Il ne put rentrer qu’à la nuit tombante, après une visite à domicile harassante et dont la triste conclusion l’emplissait d’un souci funeste. S’il avait sous-estimé le danger de la fièvre de Holmes ? Si Mrs Hudson était descendue chercher John pendant qu’il était sorti ?
Il s’imaginait tant de drames qu’il fut surpris par l’expression sereine de la vieille dame, qu’il retrouva assise sur le sofa, la posture impeccable comme toujours. Elle tenait un livre à la main, qu’elle abaissa en souriant tandis qu’il fermait la porte d’entrée.
Il en reconnut le titre à l’envers : c’était Les Mille Manières ingénieuses de faire disparaître un voisin, par le lieutenant de police Adam Bloosburry, anciennement en poste dans les Cotswold.
Son étonnement augmenta encore quand il parcourut du regard le reste de la pièce : le sol était recouvert de journaux dépliés et d’articles découpés, parmi lesquels on reconnaissait les manchettes du Times et du Strand, mais aussi les caractères raffinés de revues artistiques et la couverture d’un livret d’opéra. Un dossier en carton brun ouvert, destiné à accueillir cette sélection, éparpillait pour le moment son contenu sur le tapis aux pieds du canapé. Enroulé comme un chat autour de son trésor, Holmes s’était endormi à même le sol. Son dos reposait contre la jupe impeccable de Mrs Hudson, qui avait visiblement glissé un oreiller sous sa tête et jeté une couverture sur ses épaules.
« Sa fièvre est tombée dans l’après-midi et j’ai pensé qu’il valait mieux le laisser dormir. »
Le sourire qu’elle échangea avec John trahissait son amusement, ainsi qu’une bonne dose d’affection, qu’elle n’aurait jamais rendue perceptible si son locataire avait été conscient.
John s’effondra dans le fauteuil libre en face d’elle et l’observa qui reprenait sa lecture. À mesure que le soulagement le gagnait, une égale envie de rire le prenait : qui aurait cru qu’en deux jours, il découvrirait une facette nouvelle, non seulement de l’insaisissable détective, mais aussi de leur irréprochable logeuse ?
#whumptober 2024#no.6#healed wrong#sherlock holmes 2009#fanfiction#fanfic#tw warning severe illness#tw blood#john watson#sherlock holmes#mrs hudson
3 notes
·
View notes
Text
L'admiration
Il était une fois l’admiration. Il y a la musique et les mots, la beauté et la grâce, l’intelligence et la persévérance, la force et le courage.Il y a des chanteurs, des acteurs, comédiens et danseurs, des auteurs, écrivains, peintres et illustrateurs. Il y a les activistes, les féministes, les philosophes et les scientifiques, les astronautes et les sportifs, les passionnés, les ambitieux, les victorieux. Ceux dont on parle, ceux qu’on acclame, à la télé, dans les journaux, les magazines. Une petite fille, elle les regarde, elle les admire, elle les envie. Marchand de sable et de désirs, rêves de paillettes, contes de fée... À son réveil, le coq chante, les oiseaux volent, une montagne et des collines, chauds dans ses mains tous ces croissants, la sonnette pousse la chansonnette, c’est la voisine et ses tomates, si rouges, si grosses, comme des pastèques, et puis tiens voilà ce vieil ami, champion de Plants vs Zombies, et puis voilà aussi la sœur, prête pour Mario Party, dans sa voiture, elle les emmène et les ballade, après Zelda c’est la zumba, une vieille dame avec son chat, un vieux monsieur avec son chien, celui qui saute et c’est la fête, une petite fille fait du poney, une petite fille joue du violon, la petite sœur et sa guitare et tous ses amis à la maison, papi qui siffle dans la voiture, le disque tourne, papa qui rit, papa qui chante lui aussi, il est content et c’est marrant, et puis maman, dans le colis, un gros carton, son petit mot, plein de cookies. Et tous ces gens, tout ce beau monde, petites vies, autres récits, la petite fille, elle les regarde, elle les chérit.

#my art#my post#art#illustration#illustrator#artists on tumblr#digital art#artwork#my art stuff#story#short story#dreaming#drawing#drawings#hand drawn#tumblr draw#my draws#my text#my artwork#my#my writing#writers on tumblr#writing#illustragram#illustrative art
4 notes
·
View notes
Text
Écrire comme Susan Sontag
Vous connaissez peut-être ces vidéos Youtube où le ou la vidéaste choisit d'essayer la routine d'écriture d'un•e écrivain•e célèbre : récemment, Dakota Warren a essayé celles de Virginia Woolf et d'Ernest Hemingway. C'est ce concept que j'ai décidé d'adapter pour inaugurer la partie labo d'écriture de ce journal en ligne. Et pour commencer, qui de mieux que Susan Sontag, dont j'ai dévoré Reborn (1947-1963), le premier volume de ses journaux — et à ce jour un de mes livres préférés ?
C'est dans le deuxième volume de ces fameux journaux, As consciousness is hardened to flesh (1964-1980) que Sontag prend, en 1977, une résolution :
Starting tomorrow — if not today: I will get up every morning no later than eight. (Can break this rule once a week.) I will have lunch only with Roger [Straus]. (‘No, I don’t go out for lunch.’ Can break this rule once every two weeks.) I will write in the Notebook every day. (Model: Lichtenberg’s Waste Books.) I will tell people not to call in the morning, or not answer the phone. I will try to confine my reading to the evening. (I read too much — as an escape from writing.) I will answer letters once a week. (Friday? — I have to go to the hospital anyway.)
Pour résumer : se lever avant 8h, cultiver sa solitude matinale, ne pas sortir pour le déjeuner, écrire dans son journal, attendre la fin de journée pour lire.
Concernant l'écriture dans son journal, Sontag identifie comme modèle les Waste Books de Lichtenberg. Ces Waste Books consistent en de petits carnets dans lesquels le philosophe traçait chacune de ses pensées, même les plus brèves, même les inachevées, même les moins intellectuelles. À l'origine, un waste book désigne un cahier de comptes, celui dans lequel les marchands britanniques notaient leurs transactions au cours de la journée pour ensuite les réécrire au propre dans leur livre de comptes. L'idée de Lichtenberg est donc de garder une trace des mouvements de la pensée au cours de la journée, mouvements qui pourront être ensuite abandonnés ou approfondis.
Pour "écrire comme Susan Sontag", telles seront donc les marches à suivre : se lever avant 8h, écrire le matin et en début d'après-midi, garder une trace dans un journal des différentes pensées qui nous traversent (même les plus insignifiantes), puis lire en fin d'après-midi.
une journée dans la peau de Susan Sontag

J'ai commencé ma journée à 8h, à la lueur des bougies : en prenant mon petit-déjeuner, j'ai relu l'idée de nouvelle tracée dans mon carnet pour pouvoir en commencer la rédaction dans la matinée, puis j'ai lu un chapitre de ma lecture en cours (Le Fantôme de l'opéra de Gaston Leroux) le temps de boire mon thé.
À 9h a commencé ma première session d'écriture, pendant laquelle je me suis concentrée sur mon projet du moment, un recueil de nouvelles. J'ai relu les nouvelles déjà écrites puis j'ai écrit le début de la suivante (un peu plus de 400 mots).

Pendant une (courte) pause, je suis tombée sur cette citation d'Éluard que je vous partage aussi :

Vers 10h, j'ai enchaîné avec une deuxième session d'écriture. Pour changer un peu de sujet, j'ai décidé de faire le dernier atelier d'écriture de Laura Vasquez (je rêve d'en ouvrir un!). Coïncidence pratique pour l'unité de cet article, l'atelier en question était fondé sur une réflexion de Lichtenberg, dans Le Miroir de l'âme. La consigne était de partir d'énoncés tautologiques pour arriver à l'expression d'un "je" en lien avec ces évidences, en se laissant porter par ce qu'elles évoquent. C'est loin d'être l'un de mes meilleurs poèmes (je commence même déjà à le détester), mais voici ce que ça a donné pour moi :
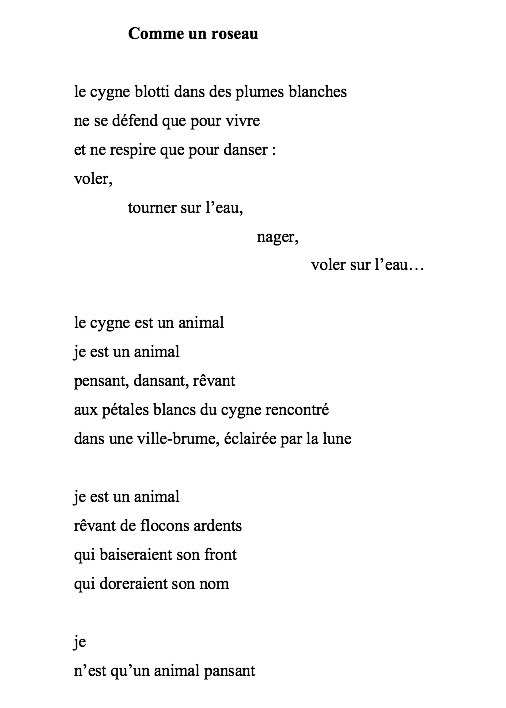
J'ai profité d'avoir fait cet atelier pour envoyer ce texte et les précédents à la revue des Ateliers d'écriture pour lesquels je devais aussi rédiger ma biographie d'auteur. (Gardez l'œil ouvert — un de mes poèmes y sera publié le 8 novembre !)
Enfin, j'ai terminé cette matinée d'écriture en me penchant, sur les coups de 11h, sur la rédaction de cet article, écriture beaucoup plus simple pour garder un peu d'énergie créative pour l'après-midi.

En début d'après-midi, dernière session d'écriture de la journée : j'ai commencé celle-ci par un peu de scrapbooking pour m'inspirer. Pour cette page, je suis partie d'un extrait d'article du magazine Lire sur Paul Valéry et son amour de la mer. On peut y lire que pour lui, la nage, « qui se soutient et se meut en pleine poésie », devient « le jeu le plus pur » qui donne son rythme à l'écriture ; ou encore qu'il décrit la mer Méditerranée comme la « scène d'un théâtre où ne viendrait agir, chanter, mourir parfois, qu'un seul personnage : la lumière ! ». À partir de ce thème assez large, j'ai écrit un court texte en écriture automatique, intitulé La Traque :
Nager c'est donner son corps aux monstres, le leur offrir en pâture, un acte gratuit de générosité pure : prenez ce que j'ai de plus cher et morcelez-le jusqu'à faire disparaître ses mots. C'est l'abandon avant d'être le néant, le don avant la destruction. Comme tout sacrifice, la nage a son rituel : dévêtir le corps de ses artifices quotidiens ; "goûter l'eau", comme la grenouille entrant dans sa marmite ; accepter de laisser son esprit au plongeoir puis partir, vite — partir où ? fuir quoi ? Fuir le carnage des émotions humaines, convaincus que l'eau viendra lécher nos plaies. Fuir l'atrocité sociale en laissant sa langue à la surface. Surtout, se fuir soi, chaque claquement d'un bras contre l'eau turquoise nous obligeant à ressentir, à toucher, à croire. C'est bien de croyance qu'il s'agit : croire que l'on soigne sa tête malade en poussant les membres dans une tension animale ; croire que l'on fuit (pour de bon, cette fois) les mots qui nous hantent, comme s'ils ne nous attendaient pas, sagement, au bout de la ligne ; croire que perfectionner, jour après jour, les techniques les plus complexes nous sauvera, le jour venu, de la noyade.
Enfin, j'ai terminé ma journée par de la lecture : je suis presque à la moitié du Fantôme de l'opéra qui pour l'instant me plaît beaucoup ; c'est une lecture (très) facile et parfaite pour la période automnale.

Quant à ma soirée, je l'ai passée à nager dans une piscine à l'eau turquoise...
Littérairement vôtre,
Ève
P.S. : Rendez-vous dimanche prochain pour une autre routine d'autrice...

me trouver ailleurs :
♤ threads ♤
♧ instagram ♧
10 notes
·
View notes
Text
« Il y avait eu des manifestations presque tous les jours pendant le mois de janvier 1934. (…) Pourtant, l’habitude aidant, on ne pensait pas que le 6 février serait plus grave que d’autres journées. (…)
À onze heures et demie, en sortant du théâtre, un spectacle singulier nous arrêta soudain : à l’horizon, quelque chose de lumineux dansait, au-dessus des têtes, semblait-il. Nous regardions sans comprendre ce feu balancé et noir : c’était un autobus, au Rond-Point, que l’on renversait. Et soudain, comme nous avancions, une foule énorme reflua soudain sur nous, des automobiles chargées de grappes d’hommes et de femmes roulèrent à grands sons de trompe, de vieilles dames se mirent à courir, les jambes à leur cou. Nous comprîmes que ce n’était pas une manifestation, mais une émeute.
Il y avait longtemps que Paris n’avait pas vécu une nuit pareille. Des milliers de gens, cette nuit-là, ne se couchèrent pas, ils erraient dans le vent froid, tout le monde se parlait, les ouvriers, les bourgeois, et des hommes disaient :
– Nous reviendrons demain avec des grenades.
Et il n’y avait plus d’opinions, et les communistes s’accordaient avec les nationalistes, et le matin l’Humanité avait publié un appel pour demander à ses troupes de se joindre aux Anciens Combattants. Une immense espérance naissait dans le sang, l’espérance de la Révolution nationale, cette Révolution dont le vieux Clemenceau avait dit qu’elle était impossible "tant que des bourgeois ne se seraient pas fait tuer place de la Concorde".
Elle se formait à travers cette nuit tragique, où couraient les bruits les plus divers, la démission du Président de la République, l’annonce de centaines de morts, la griserie, la colère, l’inquiétude. Au Weber, les blessés étaient étendus, et Mgr de Luppé, avec ses ornements épiscopaux, venait les bénir. Le couple divin, le Courage et la Peur, comme l’a écrit Drieu la Rochelle qui a si bien senti cette nuit exaltante, s’était reformé et parcourait les rues.
Aujourd’hui, nous pouvons penser que le 6 février fut un bien mauvais complot. Ces troupes bigarrées, jetées dehors sans armes, écoutaient leur seul instinct et non pas un ordre précis. Au centre, où aurait pu se trouver une direction, il n’y avait rien. On saura peut-être plus tard les négociations, les entrevues, auxquelles s’étaient décidés quelques chefs, dans les jours qui avaient précédé, ou ce jour même. Mais la foule les ignorait, et la suite montra bien que tout était vain et mal préparé.
Au matin du 7, Paris lugubre comme nous ne l’avons jamais vu, les marchands de journaux assiégés (beaucoup de feuilles n’avaient pas eu le temps d’adopter une version officielle des événements, donnaient leur première page à la majorité de la Chambre), on apprenait peu à peu la démission du ministère, et, contradictoirement, les perquisitions ou les enquêtes auprès des chefs nationalistes. L’après-midi, comme j’étais seul à Mil neuf cent trente-quatre, Paul Bourget me téléphonait pour me demander s’il était exact que Maurras était arrêté : c’est la seule fois où je l’ai entendu, il avait une voix essoufflée où tremblaient des larmes.
Mais déjà on annonçait l’arrivée du pacificateur, de M. Doumergue, ancien président de la République, dont le sourire était aussi célèbre que celui de Mistinguett. Le régime usait de l’un de ses vieux tours favoris.
C’était fini. Le 9, les communistes essayaient encore de sauver au moins la Révolution sociale. Jacques Doriot, chef du "Rayon communiste de Saint-Denis" lançait sur la gare du Nord de rudes garçons sans peur, qui tombaient sous les balles de la police. Mais déjà la pègre envahissait Paris, le 12 serait sa journée, tout était oublié de l’unanimité sociale et nationale.
Quelques jours plus tard, en ouvrant les journaux, on découvrait qu’à la veille de déposer dans l’affaire Stavisky, un magistrat, M. Prince, était trouvé mort sur une voie de chemin de fer près de Dijon, au lieu-dit de la Combe-aux-Fées. Là encore, il suffit de se reporter au moment même pour se rappeler l’unanime sentiment des Français : M. Prince avait été assassiné. Mais cet assassinat mettait en cause trop de gens, trop de seigneurs du régime. Au bout de quelques jours, on n’y comprenait plus rien, la thèse du suicide paraissait la plus forte, les experts se disputaient, les rapports de police remuaient d’étranges boues, et la mort du malheureux magistrat allait rejoindre dans l’ombre les autres morts mystérieuses de la IIIe République, de Syveton à Almereyda, à Maginot.
De ces querelles énormes, la France sortait irritée, sombre et prête, semblait-il, à toutes les aventures, – y compris les plus belles. Henri Béraud publiait dans Gringoire un admirable article sur "le Fusilleur" Daladier, et les journaux allemands annonçaient : "L’aube du fascisme se lève sur la France."
Pour nous, nous n’avons pas à renier le 6 février. Chaque année nous allons porter des violettes place de la Concorde, devant cette fontaine devenue cénotaphe (un cénotaphe de plus en plus vide), en souvenir de vingt-deux morts. Chaque année la foule diminue, parce que les patriotes français sont oublieux par nature.
Seuls les révolutionnaires ont compris le sens des mythes et des cérémonies. Mais si le 6 fut un mauvais complot, ce fut une instinctive et magnifique révolte, ce fut une nuit de sacrifice, qui reste dans notre souvenir avec son odeur, son vent froid, ses pâles figures courantes, ses groupes humains au bord des trottoirs, son espérance invincible d’une Révolution nationale, la naissance exacte du nationalisme social de notre pays. Qu’importe si, plus tard, tout a été exploité, par la droite et par la gauche, de ce feu brûlant, de ces morts qui ont été purs. On n’empêchera pas ce qui a été d’avoir été. »
Robert Brasillach, Notre avant-guerre, 1941

« 21 mars 1946. Hier nous avons lu à haute voix les poèmes de Robert Brasillach. Tout le monde avait la larme à l’œil. Nous étions écrasés par ces choses prodigieuses, tremblants d’émotion et de rage. Jamais encore, de ma vie, une œuvre poétique avait provoqué en moi pareils tressaillements. Alors, on passe aux autres, à ceux qui ont permis que Robert ne soit plus. Comme il est dit dans Macbeth : tous les parfums d’Arabie ne suffiront pas à laver cette tache de sang. »
« 13 avril 1946. Trois mois et un jour que je suis à Fresnes. (…) Hier les nouveaux jurés, les "bons" jurés qui ont remplacé les méchants des mois révolus ont encore condamné à mort deux policiers dont le crime est d’avoir fait consciencieusement leur devoir. On les y reprendra, les Français, à faire leur devoir, à obéir au gouvernement, être fidèles et loyaux. Puisque désormais, le fin du fin du civisme est de déserter devant l’ennemi ou de s’insurger contre le chef de l’État. Puisqu’on fait juge de mon manque de patriotisme un Ukrainien. Puisqu’on confie à un Letton le soin de rédiger (même pas en français) le monstre qui va servir de constitution à la IVe République. Puisque les tortionnaires du maquis ont décidé une bonne fois pour toutes que les nazis – et seulement les nazis – ont le monopole des tortures. Puisqu’on n’a indulgence et compassion que pour les pourris de la Collaboration, pour ceux qui n’ont marché que pour le tric et qu’on envoie au poteau systématiquement, les purs, les durs, les gonflés, les idéalistes. Puisqu’on flingue Robert Brasillach et qu’on souille les rues de Paris du nom de Mandel. Puisqu’on acclame Marty et qu’on accable les marins qui voulaient conserver une flotte à la France. But who cares ? comme disait Ruth, sophistique. Moi, je m’y intéresse encore un petit peu. Ça serait vexant que mes persécuteurs ne fussent que médiocrement infâmes et modérément imbéciles. Mais ils sont complets. Je les aurais faits sur mesure qu’ils ne seraient pas autrement. »
« 13 juin 1946. Je viens de lire un roman "existentialiste" écrit par la propre femme de l’héroïque M. J.-P. Sartre [Simone de Beauvoir]. Ou plutôt j’en ai lu 200 pages et je n’ai pu aller jusqu’à la 400e et dernière. Comment qu’ils sont ces messieurs-dames des Lettres de la Résistance ! Coucherai-je ? Ne coucherai-je pas ? Coucherai-je complètement ou un petit peu ? Ou sur les bords ? Ça ne te fait rien, surtout, ma chérie, que je couche avec ta petite copine ? Si ça te fait quelque chose, n’hésite pas à me le dire. Moi tu sais ça ne m’amuse pas. Mais la pauvre enfant ça l’aidera à se "réaliser". Et si ça te permet de te "réaliser" tu peux, toi aussi, coucher avec elle. Car le tout est de se "réaliser". Et pour se "réaliser", il faut coucher en long, en large et en travers, à pied, à et cheval et en voiture, dans le métro et sur la tour Eiffel. Etc. Etc. Un pays qui fusille Brasillach et qui met au pinacle une pareille littérature est assuré des plus glorieuses destinées. En somme tout va bien. Bien content de penser que les enfants grandiront loin de l’existentialisme et de ces fier-à-bras tondeurs de femmes. »
« 28 mars 1947. Je reprends ce cahier après des semaines d’interruption. Parce qu’il faut tout de même que j’exprime ma rage quelque part. Parce que tout le reste, je le dis à Fernande tous les jours. Parce que ce soir l’amiral de Laborde arrive à la cellule 77. Parce qu’on a condamné à mort, de sang-froid, sadiquement, sans l’excuse de la passion, un des plus glorieux marins français. Parce qu’on a revêtu ce héros d’une défroque de singe savant et emprisonné ses chevilles dans les fers des réprouvés. Parce que le pays qui tolère ça, qui approuve ça, se situe au-dessous de la plus barbare des tribus canaques. "Mon pays me fait mal", écrivait Robert Brasillach. Lui, du moins, il n’a pas vécu pour voir cette dégringolade dans l’ignominie, dans l’abjection. Le pays lui faisait mal pour bien peu de choses... » « 28 mars 1947. Je reprends ce cahier après des semaines d’interruption. Parce qu’il faut tout de même que j’exprime ma rage quelque part. Parce que tout le reste, je le dis à Fernande tous les jours. Parce que ce soir l’amiral de Laborde arrive à la cellule 77. Parce qu’on a condamné à mort, de sang-froid, sadiquement, sans l’excuse de la passion, un des plus glorieux marins français. Parce qu’on a revêtu ce héros d’une défroque de singe savant et emprisonné ses chevilles dans les fers des réprouvés. Parce que le pays qui tolère ça, qui approuve ça, se situe au-dessous de la plus barbare des tribus canaques. "Mon pays me fait mal", écrivait Robert Brasillach. Lui, du moins, il n’a pas vécu pour voir cette dégringolade dans l’ignominie, dans l’abjection. Le pays lui faisait mal pour bien peu de choses... »
Pierre-Antoine Cousteau
2 notes
·
View notes
Text
Les personnages du jeu à incarner.
Professeurs et membres du personnel de Poudlard
Cuthbert Binns – Histoire de la magie Phineas Nigellus Black – Directeur, prédéfini Prénom Blainey - Infirmière Mirabelle Bulbille - Botanique Dianah Hecat – Défense contre les forces du mal Prénom Howin – Soins aux créatures magiques Prénom Kogawa – Vol Gladwin Moon – Concierge Mudiwa Onai - Divination Abraham Ronen – Sortilèges Agnès Scribe – Bibliothécaire Satyavati Shah - Astronomie Aesop Sharp - Potions Matilda Weasley – Métamorphose
Commerçants de Pré-au-Lard
Thomas Brown – Tomes et parchemins Jenima Collins - Marchande de journaux Otto Dibble – Gaichiffon Jasper Fario – Tenancier à la tête du sanglier Béatrice Green – Amanite et chiendent Augustus Hill – Gaichiffon Gerbold Ollivander – Baguettes magiques Ellie Peck – Pick & Peck Parry Pippin – Potions Pippin Calliope Snelling – Coiffure Prénom Steepley - Maison du thé Timothy Teasdale – Navet Magique Albie Weekes – Balais volants
Commerçants de la région
Edgar Adley – Aranshire Léopold Babcocke - Itinérante Claire Beaumont – Campolard-en-haut Pàdraic Haggarty – Irondale Bernard Ndiaye – Felcroft Jalal Sehmi – Campolard-en-bas Eddie Thistlewood – Bourg-Garenne Priya Treadwell - Itinérante Indira Wolff – Pitt-upon-ford
Anciens élèves de Poudlard
Cressida Blume Lucan Brattleby Everett Clopton Astoria Crikett Constance Dagworth Samantha Dale William Dale Adélaïde Duchêne Lenora Everleigh Ominis Gaunt Duncan Hobhouse Hector Jenkins Andrew Larson Violette Mcdowell Charlotte Morrisson Eric Northcott Nellie Oggspire Natsai Onai Sebastian Pallow - prédéfini Grace Pinch-Smedley Arthur Plummly Léandre Prewett Imelda Reyes Nerida Roberts Poppy Sweeting Amit Thakkar Priscilla Wakefield Garreth Weasley
2 notes
·
View notes
Text

Les Vivenefs
Navire presque vivant, la vivenef est un bateau construit dans un matériau solide, quasiment indestructible appelé : bois sorcier. C'est un navire particulièrement maniable grâce à sa vie propre. Aucun marchand ne connaît la véritable nature d'une vivenef et du bois-sorcier, ni même de l'étrange vie qui l'habite...
Fabrication
Toutes les vivenefs sont construites à Feyr par des familles de charpentiers marins. Ces charpentiers utilisent le bois sorcier qui est une ressource très importante sur l'île. On ne sait pas d'où provient ce bois unique et aux propriétés magiques. Les Feyrborn détiennent le monopole sur cette matière et s'en servent uniquement pour construire des navires marchands.
La vivenefs n'a presque pas d'entretien, le bois sorcier repousse l'envie aux berniques et autres coquillages de se coller à la coque, il est également résistant au sel. Le bois sorcier est très solide et possède un aspect un peu argenté. Il est comme un bouclier quasiment indestructible. Les boulets de canon cependant peuvent endommager sa coque. Seuls les charpentiers de Feyr peuvent réparer les vivenefs. Mais cela arrive assez rarement. Si le navire est abandonné, sa coque ne pourrit pas, et peut rester en excellent état des décennies durant.
Figure de proue
Comme dit plus haut, la vivenef possède une vie propre grâce au matériau qui la compose. Dans toutes les vivenefs nous retrouvons une figure de proue qui possède une forme humaine de la tête à la taille et fait partie intégrale du vaisseau. La figure est endormie lors de sa fabrication, elle a en général les yeux fermés. Elle peut être féminine ou masculine.
Lorsque la vivenef est livrée, son premier capitaine la baptise. Son nom est très important, c'est sont identité et elle le gardera pour toujours peut importe combien de fois le propriétaire du navire change. En général la vivenef est liée à une seule famille...
Au début la vivenef est presque un navire comme les autres, mais il n'est pas impossible de ressentir certaines choses étranges à son bord. Comme si le bateau était imprégné d'une vie particulière, d'une conscience qui le guide.
Lorsque le navire voit trois génération de capitaines mourir à son bord, la figure de proue s'éveille. Elle ouvre littéralement les yeux et peut communiquer. Elle peut bouger les bras et le haut du corps, ses cheveux ondulent au vent, la tête peut tourner vers la droite et la gauche. Elle ne peut évidemment pas se détacher du navire. La figure est animée d'une conscience qui lui est propre, elle peut développer quelques traits de personnalité. Bien sûr elle parle, elle pense aussi et est capable de donner son avis. Sur les ports ils n'est pas rares de croiser des vivenefs amarrées à quai et discuter entre elles...
Sa mémoire lui est propre, elle est liée au navire mais aussi aux journaux de bord rédigés par le capitaine. Si le capitaine abandonne le navire et part avec les journaux de bord, sa mémoire peut s'affaiblir.
Sur les mers elles veillent à leur propre sauvegarde et peuvent même avertir l'homme de barre en cas de danger imminent. On raconte que certaines ont pu naviguer seules...
Commander une vivenef
La vivenef est commandée par une famille de marchands de l'archipel, directement auprès des familles de l'île de Feyr. La vivenef est donc intrinsèquement liée à la famille qui la commandée. En général un membre de la famille en devient le capitaine et c'est ainsi lui qui la commande elle et son équipage. Lorsque elle est endormie au début de son utilisation, elle se dirige comme n'importe qu'elle navire. Elle possède des voile,s une barre, etc. Elle ne se déplace pas seule.
De façon héréditaire la vivenef se transmet à la mort du capitaine à l'héritier que celui-ci à désigné. En général au premier né, mais il est possible de la transmettre à un genre par exemple. Pour les marchands ce qui est essentiel c'est que la vivenef reste au sein de la famille.
Les marchands sont d'ailleurs très superstitieux, on dit qu'on ne laisse jamais une vivenef seule. Il faut toujours qu'il y ait un membre de la famille à son bord, même lorsqu'elle est au port.
La vivenef et sa proue sont très liées au capitaine qui la dirige. Il y a un lien très fort qui se noue entre eux et qui permet de faciliter la navigation. En général dès l'enfance le futur capitaine côtoie la vivenef et se lie à elle. Le capitaine est rarement choisi au hasard.
Céder une vivenef
Dans plusieurs cas il est possible qu'une vivenef soit séparée de la famille qui la commandée à l'origine. Il est donc possible pour des non marchands de pouvoir en posséder une. Il ne faut pas oublié qu'elle est toujours liée d'une certaine manière à cette famille et qu'elle fait partie de son histoire.
✵ Si un capitaine se fait assassiner à bord de son navire, l'assassin pourra prétendre à devenir le nouveau capitaine de la vivenef. Ces assassinats sont rarissimes mais pas impossibles avec le déploiement de la piraterie au sein de l'archipel.
✵ Si la famille marchande propriétaire du navire se retrouve totalement ruinée, la vivenef peut-être vendue à une autre famille ou pas. Certains acquiert donc des vivenefs "d'occasion" mais s'ils ne sont pas adoubés par la guilde ils ne pourront pas commercer comme ils le souhaitent et se rendre hors la loi comme des pirates. Ces ventes sont extrêmement rares, par fierté certaines familles préfèrent laisser le navire en cale sèche.
✵ Certains propriétaires peuvent être "déçu" de leur vivenef. Certaines subissent des maltraitances, voire des mutilations. Il n'est pas impossible de croiser des vivenefs maltraitées, voire abandonnées totalement sur une plage déserte. Les marins sont des gens superstitieux s'ils jugent que le navire porte malheur ils peuvent s'en prendre à eux. Encore une fois ceci est assez rare mais pas impossible.
✵ Le vol de jeunes vivenefs qui ne sont pas encore éveillées est possible. Mais en général le bateau étant très très couteux, les propriétaires en prennent grand soin, et la superstition veut qu'un membre de la famille propriétaire soit toujours à son bord.
Pour nous suivre : PRD : https://www.pub-rpg-design.com/t140551-au-dela-des-vagues#2403865 Discord : https://discord.gg/vKzu9nsMZ7
1 note
·
View note
Text

Roger Schall, La marchande de journaux, Paris, 1942.
109 notes
·
View notes
Text

🗞 "O Jornaleiro" 📰
Huile sur toile 🎨 de Santana
Bel après-midi 👋
#artwork#art#art et talent#huile sur toile#santana#peinture#journal#newspapers#news#marchand de journaux#belaprèsmidi#fidjie fidjie
21 notes
·
View notes
Text






📌[ÉCHO] LA GAZETTE DE L’AVENTURE (4/7) Un peintre carnivore, un explorateur à cœur joie, un autre en pôle position ou encore le sens de l'aventure. Lisez chaque vendredi sur cette page une rétrospective de l’actualité de l’exploration de ce premier semestre 2023.
Une rubrique estivale concoctée par Stéphane Dugast.
Pour en savoir plus, partez explorer le monde avec le dernier hors-série de Terre Sauvage disponible en ce moment chez votre marchand de journaux. Embarquez sur les mers et les océans du monde avec nombre d'articles, chroniques et portraits que j'ai écrits. 100 pages d'explorations et d'aventures iodées.
Avec en prime, un grand reportage dédié à la dernière mission en océan Indien orchestrée l'automne dernier par Monaco Explorations.
#vendredilecture#mer#océans#oceans#exploration#actualités#explorateurs#terresauvage#aventures#articles#stéphanedugast#presse#nicolasvial#peintredemarine#astrolabe#taafchaudes#tropiques#borgeousland#aventure#rfi#Alpinsime#henrybizot#sociétédesexplorateurs#chronique
1 note
·
View note
Text
Comment trouver les meilleurs vide-greniers en France : un guide complet

La France est réputée pour sa culture, son histoire et sa cuisine raffinée, mais il existe un autre aspect de la vie française qui a gagné en popularité auprès des habitants et des touristes : les vide-greniers. Connus sous le nom de « vide-greniers », ces vide-greniers proposent un véritable trésor d’objets, des objets de collection vintage aux essentiels du quotidien, le tout à des prix avantageux. Si vous êtes nouveau dans les vide-greniers en France ou si vous cherchez simplement à améliorer votre expérience, ce guide vous expliquera tout ce que vous devez savoir.
Pourquoi les vide-greniers sont populaires en France
Les vide-greniers en France sont plus qu’un simple lieu d’achat et de vente d’objets d’occasion ; ils sont un phénomène social et culturel. Ils constituent un excellent moyen pour les gens de désencombrer leur maison tout en offrant aux autres des trouvailles abordables et uniques. Au-delà des avantages pratiques, ces événements favorisent un sentiment de communauté et prennent souvent une atmosphère festive, avec des stands de nourriture et des divertissements qui ajoutent au charme. Pour les touristes, c’est aussi un moyen fantastique de rapporter chez soi des souvenirs authentiques sans se ruiner.
Où chercher les vide-greniers
Trouver les meilleurs vide-greniers en France nécessite un peu de planification et de recherche. Voici quelques ressources clés pour vous aider à démarrer :
1. Journaux locaux et panneaux d’affichage communautaires : de nombreux vide-greniers sont annoncés dans des publications locales ou sur des panneaux d’affichage dans les centres communautaires, les bibliothèques ou les épiceries.
2. Plateformes en ligne : des sites Web comme flanerbouger.fr fournissent des informations complètes sur les vide-greniers à venir, notamment les lieux, les dates et les horaires.
3. Médias sociaux : les groupes Facebook et les forums locaux partagent souvent des informations sur les vide-greniers dans des zones spécifiques.
4. Bouche à oreille : ne sous-estimez pas le pouvoir des relations locales. Demandez à vos voisins ou amis s’ils connaissent des événements à venir.

Conseils pour trouver les meilleures affaires
Pour tirer le meilleur parti de votre expérience de vide-greniers, tenez compte de ces conseils pratiques :
• Arrivez tôt : les meilleurs articles ont tendance à se vendre rapidement, alors essayez d’arriver dès le début des soldes.
• Apportez de l’argent liquide : bien que certains vendeurs acceptent les paiements par carte, il est préférable d’avoir de petites coupures et des pièces de monnaie à portée de main.
• Soyez prêt à marchander : la négociation fait partie du plaisir, mais soyez toujours poli et raisonnable dans vos offres.
• Sachez ce que vous recherchez : avoir une liste mentale (ou écrite) des articles dont vous avez besoin peut vous aider à rester concentré et à éviter les achats impulsifs.
• Inspectez soigneusement les articles : étant donné que la plupart des articles sont vendus « en l’état », vérifiez qu’ils ne sont pas endommagés ou défectueux avant de procéder à un achat.
Les meilleures régions pour les vide-greniers en France
Bien que les vide-greniers se déroulent dans tout le pays, certaines régions se distinguent par leurs marchés d’occasion dynamiques :
• Paris et Île-de-France : la capitale et ses environs abritent de nombreux vide-greniers, mettant l’accent sur les articles vintage et anciens.
• Provence : connue pour son patrimoine artistique, cette région propose souvent des vide-greniers avec des produits artisanaux uniques.
• Bretagne : paradis des chasseurs de trésors, les vide-greniers bretons proposent souvent des objets de collection à thème maritime et de l’artisanat régional.
• Alsace : cette région est célèbre pour ses charmants villages, où les vide-greniers prennent souvent une ambiance festive et pittoresque.
Pourquoi choisir les vide-greniers plutôt que les magasins traditionnels
Les vide-greniers offrent une expérience d’achat distincte que vous ne trouverez pas dans les magasins de détail traditionnels. Ils permettent de découvrir des articles uniques, souvent avec des histoires fascinantes derrière eux. De plus, acheter d’occasion est respectueux de l’environnement, réduit les déchets et favorise la durabilité. Et n’oublions pas les prix imbattables qui font des vide-greniers un paradis pour les acheteurs soucieux de leur budget.
Planifiez votre prochaine chasse aux trésors
Que vous recherchiez des meubles vintage, des livres rares ou des objets de collection originaux, les vide-greniers en France ont quelque chose à offrir à tout le monde. En utilisant des ressources comme flanerbouger.fr, vous pouvez facilement trouver tous les détails dont vous avez besoin pour planifier votre prochaine aventure de chasse aux trésors. Alors, prenez votre sac de courses, enfilez des chaussures confortables et plongez-vous dans le monde délicieux des vide-greniers français.
Bonne chasse !
#fêtes foraines#fêtes locale et de village#votre agenda des fêtes locales#parcs d'attractions france#tournois de joutes nautiques
0 notes
Text
La Belgique a perdu les 3/4 de ses #marchands de #journaux en 20 ans !
En 20 ans, le nombre de marchands de journaux en Belgique a diminué de trois quarts. Leur nombre diminue d’année en année, tout comme les revenus qu’ils tirent de la vente de journaux et même de cigarettes. Un cinquième de moins en cinq ans En 2005, la Belgique comptait 4.103 magasins de journaux ; fin 2024, il n’y en aura plus que 1.518. C’est ce que rapporte l’association professionnelle…
0 notes
Text

Stepan Chahoumian
Stepan Chahoumian (1878-1918), en arménien Ստեփան Շահումյան, était un bolchévik arménien. Son rôle en tant que dirigeant de la révolution russe dans le Caucase lui a valu le surnom de « Lénine du Caucase ».
Bien que fondateur et rédacteur en chef de plusieurs journaux et revues, Chahoumian est surtout connu comme commissaire de la commune de Bakou. Il était connu sous divers pseudonymes, dont « Souren », « Sourenine » et « Ayaks ».
1 Biographie
1.1 Débuts
Stepan Georgievitch Chahoumian naît le 1 octobre 1878 à Tiflis (actuellement en Géorgie), dans ce qui est alors l'Empire russe, au sein d'une famille de marchands de vêtements.
Il étudie à l'Université polytechnique de Saint Pétersbourg et à l'Université technique de Riga, où il rejoint le Parti ouvrier social-démocrate de Russie en 1900. Il est arrêté par le gouvernement tsariste pour avoir pris part à des activités politiques étudiantes sur le campus et est exilé en Transcaucasie.
Chahoumian s'enfuit vers l'Allemagne, où il rencontre des exilés de l'Empire russe comme Lénine, Martov et Plekhanov. Il se range du côté bolchévik dès le congrès de 1903. En 1905 il obtient un diplôme du département de philosophie de l'Université Humboldt de Berlin.
De retour en Transcaucasie, il devint professeur et leader des sociaux-démocrates locaux à Tiflis, produisant beaucoup de littérature marxiste. En 1907, il déménage à Bakou pour diriger l'important mouvement bolchevique de la ville. En 1914, il dirige une grève générale dans la ville, qui est écrasée par l'armée impériale. Chahoumian est arrêté et envoyé en prison. Il s'échappe au moment où commençait la révolution de février 1917.
1.2 La Commune de Bakou
Un comité de courte durée désigné par Lénine en mars 1918, avec l'énorme tâche de diriger la révolution dans le Caucase et en Asie occidentale. Son mandat en tant que commissaire de la Commune de Bakou a été entaché de nombreux problèmes, y compris la violence ethnique entre les populations arménienne et azerbaïdjanaise de Bakou, mais aussi l'avancée de l'armée turque vers la ville, tout en essayant de répandre la cause de la révolution dans toute la région. Contrairement à beaucoup d'autres bolcheviks au moment cependant, il préférait résoudre bon nombre des conflits qu'il a affrontés pacifiquement, plutôt que par la force et la terreur.
Il est contraint à la fuite par la mer Caspienne à la suite de la dissolution de la commune de Bakou. Cependant, lui et le reste des commissaires sont capturés et exécutés par les forces anti-bolcheviques le 20 septembre 1918 à Krasnovodsk, en Transcaspie.
2 Hommages
Après la mort de Chahoumian, le gouvernement soviétique le dépeint comme un martyr de la révolution russe. Cela tend fortement les relations avec les britanniques complices, d'autant plus que Chahoumian était proche de Lénine.
Heydar Aliyev, leader de l'Azerbaïdjan soviétique, déclarera :
« Aujourd'hui nous disons avec fierté et amour, que Stepan le grand fils du peuple arménien est aussi le fils du peuple azerbaïdjanais, de tous les peuples de Transcaucasie, de tout le peuple soviétique multinational et uni . »
Les autorités soviétiques renommèrent Khankendi (la capitale du Haut-Karabagh) en Stepanakert, en hommage à Chahoumian. En 1992, l'Azerbaïdjan rétablit l'ancien nom, mais les autorités du Haut-Karabagh l'appellent toujours Stepanakert.
La ville de Jalaloghli en Arménie a également été renommée en Stepanavan, nom qu'elle conserve aujourd'hui. Des rues à Lipetsk, Yekaterinburg, Stavropol et Rostov-sur-le-Don (Russie), ainsi qu'une avenue de Saint Petersburg portent le nom de Chahoumian. Une statue de lui a été érigée en 1931 à Erevan, la capitale de l'Arménie.
3 Bibliographie
Ronald Grigor Suny, The Baku Commune, 1917-18. Princeton: Princeton University Press, 1972. (ISBN 0-691-05193-3).
1 note
·
View note