#Georges Fontenis
Explore tagged Tumblr posts
Text
Georges Fontenis - Μανιφέστο του Ελευθεριακού Κομμουνισμού
Το μανιφέστο του ελευθεριακού κομμουνισμού Περιγραφή: Το «Μανιφέστο του Ελευθεριακού Κομμουνισμού» γράφτηκε το 1953 από τον Georges Fontenis για την Federation Communiste Libertaire (F.C.L. – Κομμουνιστική Ελευθεριακή Ομοσπονδία) της Γαλλίας. Αποτελεί ένα από τα βασικά κείμενα του αναρχικού κομμουνιστικού ρεύματος. Ακολούθησε τις καλύτερες εργασίες των Μιχαήλ Μπακούνιν, Τζέϊμς Γκιγιώμ, Ερρίκο…
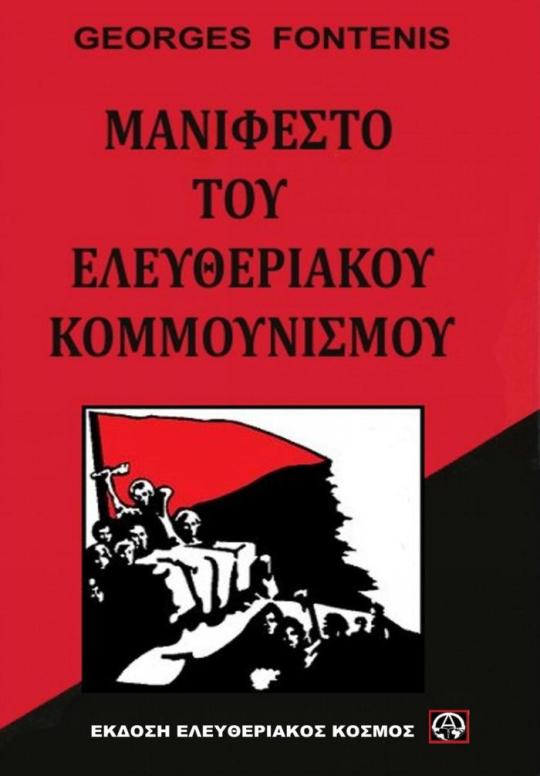
View On WordPress
0 notes
Text
Georges Fontenis - Μανιφέστο του Ελευθεριακού Κομμουνισμού
Το μανιφέστο του ελευθεριακού κομμουνισμού Περιγραφή: Το «Μανιφέστο του Ελευθεριακού Κομμουνισμού» γράφτηκε το 1953 από τον Georges Fontenis για την Federation Communiste Libertaire (F.C.L. – Κομμουνιστική Ελευθεριακή Ομοσπονδία) της Γαλλίας. Αποτελεί ένα από τα βασικά κείμενα του αναρχικού κομμουνιστικού ρεύματος. Ακολούθησε τις καλύτερες εργασίες των Μιχαήλ Μπακούνιν, Τζέϊμς Γκιγιώμ, Ερρίκο…
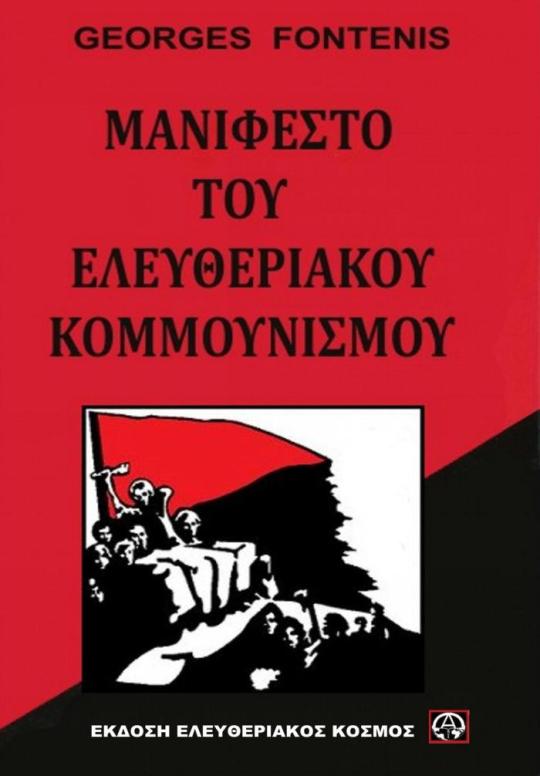
View On WordPress
0 notes
Quote
What is Capitalism? [a] It is a society of rival classes where the exploiting class owns and controls the means of production. [b] In capitalist society all goods — including the power of waged labour — are commodities. [c] The supreme love of capitalism, the motive for the production of goods, is not peoples needs but the increasing of profit, that is the surplus produced by workers, the extra to what is absolutely necessary for them to stay alive. This surplus is also called plus-value. [d] Increase in the productivity of labour is not followed by the valorisation of capital which is limited (under-consumption). This contradiction, which is expressed by the ‘tendency to fall of the rate of profit’, creates periodic crises which lead the owners of capital to all sorts of carry-ons: cut-backs in production, destruction of produce, unemployment, wars and so on.
Georges Fontenis, Manifesto of Libertarian Communism
37 notes
·
View notes
Text
Michel Desmars (1942-2021), militant de Mai
Michel Desmars est décédé le 21 décembre, à 79 ans. Figure rouge et noir du mois de mai 1968 à Tours, cheminot et syndicaliste révolutionnaire, internationaliste, il fut tout cela à la fois.

En 1968, le mouvement de Mai saisit Michel Desmars, cheminot affilié à FO, mais surtout à l’Union des anarcho-syndicalistes. Entré à la SNCF en 1961, il est agent de conduite, attaché au dépôt de Saint-Pierre-des-Corps (37), et participe activement à la grève avec occupation, ainsi qu’il a raconté pour la revue de l’Union syndicale Solidaires à l’occasion du cinquantenaire de mai [1]. Les assemblées générales rythment le mouvement, outils de libération de la parole et d’auto-organisation. En parallèle de cet engagement dans la grève, il anime, au côté de Georges Fontenis, le Comité d’action révolutionnaire (CAR) de Tours.
Exclu de FO en 1969, Michel Desmars traverse une phase antisyndicaliste, et très marqué par l’esprit de Mai, il cherche à promouvoir l’expression d’une forme d’autonomie ouvrière, que ce soit en participant aux Cahiers de Mai ou au bulletin Action-Cheminots. En 1969, il est, avec Georges Fontenis, un des cofondateurs du Mouvement communiste libertaire (MCL), et sera directeur de publication de son journal, Guerre de classes.
Animateur de la gauche CFDT
Alors que le MCL – devenu OCL dite « première manière » en 1971 – décline, Michel Desmars rejoint la CFDT en 1974 et y prend très vite des responsabilités. Il sera un des animateurs de la gauche syndicale de cette centrale vingt années durant. Révolutionnaire et autogestionnaire, il est de toutes les aventures de regroupement de cette gauche syndicale, au travers notamment des revues Résister, Collectif et jusqu’aux Cahiers syndicaux [2]. En 1986, il est parmi ceux qui lancent la grève reconductible à la SNCF et mettent l’outil syndical à disposition des assemblées générales cheminotes et de la coordination des agents de conduite, non sans échanges houleux avec la direction de la CFDT, qui condamne l’auto-organisation [3].
Sans surprise, et alors qu’il a pris sa retraite en 1992, il participe à la création de SUD-Rail en 1996 puis au développement de l’Union syndicale Solidaires, notamment au travers de son activité internationaliste comme dans l’Union départementale de Haute-Garonne.
Militant de l’UTCL
Après l’expérience du MCL-OCL, Michel Desmars avait rejoint l’Union des travailleurs communistes libertaires (UTCL) en 1980 et participé à sa branche Transports. Il fut parmi les signataires de l’Appel pour une Alternative libertaire qui allait déboucher sur la création de l’organisation du même nom en 1991. Mais il n’allait pas poursuivre dans cette voie et cessa d’adhérer à une organisation communiste libertaire.
En 2001, il participa à l’expérience de la liste Motivé-e-s à Toulouse, où il figurait en 3e position, et fut élu au conseil municipal. En 2007, quand les militantes et militants syndicalistes et libertaires critiquaient la « fausse bonne idée de la candidature Bové » à la présidentielle, il participait au contraire à l’équipe de campagne de l’ex-syndicaliste paysan.
Maire du Verdier, son petit village du Tarn, à la fin de sa vie, Michel Desmars n’en était pas moins resté un homme du camp de l’émancipation, l’un des nôtres.
Théo Roumier
Article du site web de l’Union communiste libertaire
0 notes
Text
Révolutionnaires et ouvriers contre la Première Guerre mondiale

La revue de critique sociale Ballast n°3 (automne 2015) publie un entretien-fleuve autour du livre Trop jeunes pour mourir.
Guillaume Davranche, né en 1977, est journaliste et chercheur indépendant en histoire sociale. Avec Trop jeunes pour mourir. Ouvriers et révolutionnaires face à la guerre (1909-1914), une somme de 500 pages éditée par Libertalia et L’insomniaque, il donne à lire la mobilisation qui s’enclencha dans les rangs radicaux contre la Première Guerre mondiale. Son étude est également l’occasion de mettre en lumière la Fédération communiste anarchiste : elle n’exista que quatre années mais jura l’insoumission et la désertion aux autorités qui s’apprêtaient à envoyer les peuples de France et d’Allemagne s’entretuer au front.
Après avoir participé, avec d’autres, à l’ambitieux Maitron des anarchistes, voilà que vous publiez Trop jeunes pour mourir. Qu’est-ce qui vous incite à vous lancer dans d’aussi colossaux chantiers ?
Honnêtement, c’est surtout le fait qu’on ne mesure pas du tout, au départ, qu’ils le sont autant ! Plus sérieusement, mon intérêt pour l’histoire du mouvement libertaire et révolutionnaire est, c’est évident, lié à mon engagement politique. Pendant longtemps, je me suis contenté des grands épisodes les plus connus du mouvement libertaire : la Commune de Paris, la Révolution russe, la Révolution espagnole… Sorti de là, généralement, pour le militant moyen, c’est souvent terra incognita ! Certes, il y a la somme de Jean Maitron en deux tomes, Le Mouvement anarchiste en France. C’est une mine d’informations mais, plus de soixante ans après sa première parution, il faut reconnaître qu’on en sent les limites.
À partir de 2000, j’ai eu envie d’en savoir davantage sur l’histoire du courant communiste libertaire, et j’ai commencé par la période récente (avant tout parce qu’il y avait une certaine urgence à recueillir les témoignages d’actrices et d’acteurs déjà âgés). C’est ainsi que j’ai fait la connaissance d’un certain nombre d’anciennes et d’anciens de la Fédération communiste libertaire, de Noir et Rouge, de l’Organisation révolutionnaire anarchiste (ORA)… et que j’ai réalisé des entretiens qui ont été publiés ici ou là : avec Georges Fontenis, bien sûr, que j’ai côtoyé dans le groupe tourangeau d’Alternative libertaire en 1997-1998 ; avec Gil Devillard, un ancien de l’Organisation Pensée Bataille et du groupe Makhno de Renault-Billancourt1 ; avec Guy Malouvier et Rolf Dupuy, de l’ORA2 ; avec Patrice Spadoni et Thierry Renard, de l’ORA et de l’Union des travailleurs communistes libertaires3 ; avec des anciens de Noir et Rouge, comme Jean-Max Claris4 ; et encore, récemment, avec Daniel Guerrier5…
Tout cela m’a, disons, mis en appétit. Et m’a donné le goût d’une histoire écrite « à hauteur d’homme », d’une histoire qui s’approche autant que possible d’une compréhension des acteurs du passé.
Pour Trop jeunes pour mourir, tout a commencé par une visite aux archives de la Préfecture de police de Paris, en 2006. J’avais lu quelque part (sans doute dans la partie bibliographique du site de Fabrice Magnone consacré au Libertaire) qu’il existait là-bas un carton concernant la Fédération communiste anarchiste — la FCA. Je faisais alors des recherches sur l’origine du courant communiste libertaire qu’on faisait, à l’époque, communément remonter à la Plate-forme de Makhno et Archinov, datant de 1926. Avant cette date, le grand flou. Et dans ce grand flou : la FCA ! Intrigué par cette mystérieuse organisation fugacement évoquée par Maitron, je me suis donc rendu au musée de la Préfecture de police, dans le Ve arrondissement. Derrière ses vitrines, on peut admirer, entre autres, un pittoresque arsenal de poignards et de pistolets saisis sur des « apaches » des années 1900. Les brassards hérissés de Liabeuf, le « tueur de flics »6, y sont également exposés. Les archives de la Préfecture de police étaient consultables dans des locaux attenants7.
C’est là que j’ai découvert l’existence non pas d’un, mais de deux cartons libellés « FCA », particulièrement volumineux, et contenant des centaines de rapports de mouchards : au moins un par semaine pendant trois ans ! Un gisement d’informations totalement inexploité, complété par des cartons annexes — sur la Fédération révolutionnaire et sur le Comité de défense sociale. Sans trop savoir où j’allais, j’ai commencé à dépouiller cette masse désordonnée. J’ai noirci des feuilles de notes, plusieurs jours de suite, ignorant l’étendue de ce qu’il restait à découvrir.
Et plus j’en apprenais, plus je peinais à comprendre ce qu’il se passait au sein de cette FCA : les rapports faisaient référence à des personnages, des luttes et des débats, qui m’étaient largement étrangers. Je me suis rapidement rendu compte qu’il était impossible de comprendre le mouvement anarchiste de ces années-là sans comprendre, en même temps, l’influence de l’hervéisme, la trajectoire de la CGT, et, plus généralement, le climat militariste de l’époque. Ça a été le point de départ. J’ai commencé à rédiger, tout en défrichant en parallèle, de plus en plus passionné par ce que je découvrais.
C’est ainsi que j’ai commencé à travailler les week-ends, la nuit, ou très tôt le matin, pendant mes périodes de chômage, tout en menant, en parallèle, le chantier du Maitron des anarchistes dans lequel je m’étais laissé entraîner, et l’activité au sein d’Alternative libertaire, puisque, par principe, je ne fais jamais passer la politique au second plan — le passé ne doit pas dévorer le présent, ni l’avenir. Malgré tout, j’étais loin d’imaginer que je n’achèverais ce travail que huit ans plus tard !
Pourriez-vous, déjà, résumer pour nos lecteurs le paysage politique de l’époque, les tensions et les enjeux ?
En 1899, la clôture de l’affaire Dreyfus avait ouvert une période nouvelle : la droite conservatrice, nationaliste et cléricale, s’était vue durablement affaiblie, et l’Assemblée nationale était dominée par la bourgeoisie de gauche (républicains, radicaux, radicaux-socialistes…). Las, dix ans plus tard, le clivage droite/gauche s’estompait déjà : sur le plan économique, bien sûr, mais aussi sur celui des valeurs, notamment à partir d’octobre 1909 et de la politique centriste dite de l’« apaisement ». Cet « apaisement », voulu par le président du conseil, Aristide Briand, consistait à amadouer la droite en reprenant une partie de ses thèmes. La gauche au pouvoir mit donc en œuvre une politique de plus en plus réactionnaire, parfois à la stupéfaction et sous les applaudissements de la droite. Cette dérive réactionnaire s’accéléra après le coup d’Agadir qui, à l’été 1911, avait vu la France et l’Allemagne à deux doigts d’entrer en guerre. À partir de février 1912, le nouveau président du conseil, Raymond Poincaré, lança la politique de « fermeté nationale », qui visait au réarmement matériel et moral du pays face à l’Allemagne. Son ministre de la Guerre, Alexandre Millerand, aurait alors déclaré vouloir remettre l’armée française « dans l’état où elle était avant l’Affaire Dreyfus » 8. Pas mal, pour un ex-socialiste et ex-dreyfusard ! Il s’attira rapidement les hommages de Maurras qui, dans un édito de L’Action française, assura que « pour un patriote qui se respecte, la question politique cesse de se poser devant un ministre de la Guerre qui fait son devoir » 9. On voit le niveau de confusion politique de l’époque !
Face à cela, seul le mouvement ouvrier démontrait de la cohérence et de la rigueur. À l’époque, on admettait communément qu’il se composait de trois grandes tendances : le socialisme, l’anarchisme et le syndicalisme (considéré comme un courant politique à part entière). Malgré ses divisions et ses querelles, ce mouvement ouvrier se retrouvait uni sur la question de la guerre : contre l’aventure coloniale au Maroc, contre la militarisation de la société et pour la dénonciation des rivalités impérialistes qui faisaient de l’Europe une véritable poudrière…
La période méconnue que vous avez mise en lumière (1909-1914) correspond à une phase de déclin de la CGT avec, en parallèle, l’émergence de ladite Fédération communiste anarchiste. Comment et pourquoi cette organisation est-elle née ? Quelle fut son influence réelle ?
Fondamentalement, la FCA est née de la conjonction de deux crises : primo, celle du syndicalisme, débutée en 1909, qui donnait à penser que la formule « le syndicalisme se suffit à lui-même » n’était pas si opérante ; secundo, celle de l’anarchisme. Faisant ce constat, une poignée d’anarchistes parisiens étaient convaincus que si l’anarchisme ne se dotait pas d’une organisation de référence, qui serve de point de repère, il était condamné à n’être qu’un supplétif.
Au printemps 1910, les élections législatives avaient été l’occasion de mener une grande campagne abstentionniste, qui avait mobilisé l’ensemble des fractions du mouvement libertaire — excepté les individualistes —, et même au-delà, puisque certains révolutionnaires du PS s’y étaient associés. C’était en fait la première fois que le mouvement anarchiste français parvenait à mener une campagne nationale concertée. Après ce relatif succès, il est apparu que la situation était mûre pour mettre sur pied une véritable organisation révolutionnaire, qui pourrait associer les anarchistes, l’extrême gauche du PS, et un certain nombre de syndicalistes.
Cependant, les débats concernant l’orientation qu’on pourrait donner à cette organisation furent vifs. Une question stratégique était celle de son rapport au PS : d’un côté, l’équipe de La Guerre sociale aurait voulu un parti révolutionnaire qui ne soit pas strictement « anti-votard » et qui n’aurait pas gêné l’action parlementaire du PS ; de l’autre, l’équipe du Libertaire refusait cette idée d’une complémentarité des tâches entre réformistes et révolutionnaires, et militait pour une organisation strictement anarchiste-communiste. Au terme de plusieurs mois de controverses, c’est finalement la seconde orientation qui l’emporta.
En décembre 1910 fut fondée la Fédération révolutionnaire communiste, dont Le Libertaire allait devenir l’organe officieux. Peu à peu, elle rallia à son drapeau noir la majorité des groupes libertaires qui comptaient, tandis que La Guerre sociale amorçait un virage droitier. On peut considérer qu’à l’été 1912, La Guerre sociale avait perdu l’essentiel du crédit dont elle jouissait dans la gauche de la CGT, et que la FRC, rebaptisée Fédération communiste anarchiste (FCA), constituait le nouveau pôle révolutionnaire de référence.
Je pense qu’elle atteignit son apogée à l’été 1913, lorsqu’un congrès national lui permit d’unifier autour d’elle la plupart des groupes anarchistes du pays (dont ceux de la mouvance des Temps nouveaux et un certain nombre de groupes locaux). Elle compta alors peut-être les 1 000 adhérent.e.s. Quelle fut son influence réelle ? Comme elle ne se présentait pas aux élections, son audience dans « les masses » ne peut se mesurer qu’au tirage de ses journaux : 10 000 exemplaires pour Le Libertaire en 1913, 5 000 pour Les Temps nouveaux, auxquels il faut ajouter les journaux régionaux (principalement dans le quart nord-est du pays) : les hebdomadaires Germinal (Somme et Oise), La Vrille (Vosges), La Cravache (Marne), Le Combat (Nord), L’Avant-garde (Pas-de-Calais)… Ça peut sembler considérable aujourd’hui, mais ce n’est pas tant que ça en ces années 1910 où la presse écrite était reine.
Les meetings de la FCA en région parisienne rassemblaient communément 200 à 400 personnes, 1 200 quand elle y mettait de grands moyens. Là aussi, ça peut sembler impressionnant au regard des critères actuels. Mais c’était dans la norme des meetings d’une époque où la télévision n’existait pas, et où les gens assistaient aux conférences pour s’instruire ou se distraire.
Cette audience restreinte dans les masses, la FCA la compensait en exerçant une influence stratégique au sein du mouvement ouvrier. Dans plusieurs départements industriels (Somme, Rhône, Loire, Maine-et-Loire, Finistère…), les anarchistes pesaient fortement dans la CGT. Dans la Seine10, il y avait une véritable connivence entre la FCA et certains syndicats du Bâtiment, des Métaux. Avec les Jeunesses syndicalistes, aussi. Plusieurs de ses militantes s’activaient dans le syndicat des couturières. Certains militants de la FCA (comme Benoît Broutchoux ou Jules Lepetit) étaient de populaires orateurs syndicalistes.
Enfin, des liens directs et privilégiés existaient entre, disons, le « premier cercle » de la FCA et plusieurs dirigeants confédéraux de la CGT (notamment Léon Jouhaux, Georges Yvetot, Pierre Monatte, Georges Dumoulin, Pierre Dumas et François Marie). Hormis avec Yvetot, ces liens se rompirent cependant à partir de l’été 1913 lorsqu’une violente crise d’orientation opposa la gauche de la CGT à la direction confédérale. La FCA, dans sa majorité, prit le parti de la gauche de la CGT.
À l’intérieur du mouvement syndical, vous discernez deux sensibilités libertaires. D’une part, ceux que vous qualifiez d’« anarchistes syndicalistes », comme Broutchoux ; d’autre part, ceux que vous nommez les « syndicalistes libertaires », comme Émile Pouget ou Pierre Monatte…
… Mais il me faut commencer par souligner que cette distinction n’a jamais été formulée à l’époque. C’est moi qui l’opère, et qui la soumets au débat historiographique. Elle s’inspire en partie de Jacques Julliard — un des meilleurs historiens du syndicalisme révolutionnaire, dans une autre vie — qui, dans son Autonomie ouvrière11, évoquait deux types de syndicalistes révolutionnaires : les « ultras » et les « politiques ». Comme Julliard ne proposait pas de définition de ces catégories, je me suis permis de le faire.
Pour moi, la sensibilité « politique » regroupait ces militants issus des vieilles écoles socialistes — blanquiste, allemaniste et anarchiste — dont la coalition avait engendré, entre 1903 et 1906, le syndicalisme révolutionnaire. Mais on y trouvait aussi des militants sans étiquette, purs produits de la CGT. Les « ultras », eux, étaient presque exclusivement des anarchistes ou des jusqu’au-boutistes qualifiés d’« anarchisants » par les modérés. Mais dissipons tout de suite une équivoque : les « politiques » n’étaient pas nécessairement d’habiles stratèges préparant minutieusement des grèves victorieuses, et les « ultras » n’étaient pas nécessairement de brouillons braillards appelant à la grève générale à tout bout de champ. On trouvait, dans chaque sensibilité, de tenaces bâtisseurs de l’organisation ouvrière.
On peut néanmoins noter, chez les « politiques », une prudence que n’avaient pas les « ultras », plus habités par la théorie des minorités agissantes. En appliquant cette catégorisation politiques/ultras aux anarchistes actifs à la CGT, je distingue donc les syndicalistes libertaires et les anarchistes syndicalistes.
Pour schématiser, le syndicaliste libertaire aura tendance — il faut se garder de toute systématisation — à faire prévaloir l’unité ouvrière sur ses propres préférences partisanes et même idéologiques. C’est en cela qu’il est « politique ». Par souci d’unité, il se dit simplement « syndicaliste révolutionnaire », même s’il ne fait pas mystère de ses convictions anarchistes. L’anarchiste syndicaliste, lui, aura tendance à faire prévaloir ses préférences idéologiques et partisanes, parfois au risque d’affaiblir l’unité ouvrière. Et en cela, c’est un « ultra ». Il appartient également au courant syndicaliste révolutionnaire de la CGT, mais n’hésite pas à s’enorgueillir de l’épithète d’anarchiste. Il s’autocensure moins. Il laisse volontiers libre cours à son aversion pour le PS, quitte à provoquer des conflits, voire des scissions, dans la structure syndicale. L’un n’est pas moins libertaire que l’autre. Il est important de le préciser, car si le premier choisit tactiquement de ne pas mettre en avant son étiquette anarchiste, cela ne veut aucunement dire qu’il a renoncé à ses idées. Cela signifie simplement qu’il juge plus conforme à la politique anarchiste de préserver l’unité ouvrière.
Peut-on y voir les prémices de la différenciation entre anarcho-syndicalistes et syndicalistes révolutionnaires ?
Bien qu’appartenant à la même majorité syndicaliste révolutionnaire, ces deux sensibilités anarchistes n’avaient pas tout à fait les mêmes priorités, et pouvaient donc avoir des divergences. Ce fut le cas au congrès d’Amiens, en 1906, sur la question de l’antipatriotisme, et, de façon très violente, dans la polémique sur l’orientation qui déchira la CGT à partir de l’été 1913.
La sensibilité anarchiste syndicaliste portait des positions bien à elles : pour un syndicalisme ouvertement anti-étatiste, pour la rotation du permanentat, pour la limitation du rôle des fédérations au bénéfice des unions régionales… En cela, elle fut bien la matrice du courant anarcho-syndicaliste qui devait voir le jour dans les années 192012, et préférera façonner sa propre centrale syndicale — la CGT-SR en 1926, la CNT-F en 1946 — quitte à ce qu’elle soit squelettique. Un autre courant libertaire fit le choix inverse et, au fil des décennies, militera là où il lui semblera qu’il est le plus utile à la lutte de classes : à la CGT dans les années 1930, à la CGT-FO dans les années 1950, à la CFDT dans les années 1970, à SUD dans les années 1990…
Mais, avant 1914, la question se posait dans un contexte radicalement différent puisqu’il n’y avait qu’une unique confédération syndicale en France, et que tout le monde s’y retrouvait, dont les deux sensibilités libertaires évoquées.
L’époque, c’était aussi La Guerre sociale, ce journal qui mêlait anarchistes, socialistes insurrectionnels et syndicalistes « ultras », sous la houlette de Gustave Hervé. Ce dernier allait virer nationaliste et sera même, en 1919, un des fondateurs du fascisme français, avec son Parti socialiste national. Peut-on y voir le début de ce logiciel « confusionniste », alliant « national » et « social », qui remporte aujourd’hui un succès certain à l’extrême droite ?
En réalité, ce logiciel « socialiste national » existait bien avant Hervé. Il avait marqué un profond mouvement populaire : le boulangisme, entre 1887 et 1889. On le retrouva ensuite dans La Libre Parole d’Edouard Drumont et dans le syndicalisme jaune de Pierre Biétry. L’historien Zeev Sternhell a dit l’essentiel sur cette question13, même s’il en a profité pour écrire de grosses bêtises sur le syndicalisme révolutionnaire14. À partir de 1911, on voit ce logiciel « socialiste national » ressurgir dans Terre libre, le journal d’Emile Janvion. L’antisémitisme était, à l’époque, un élément indissociable de ce logiciel. À ce sujet, il faut noter que Gustave Hervé aura toujours eu l’antisémitisme en horreur (ce qui sera une vraie singularité dans l’extrême droite de l’entre-deux-guerres).
Le problème que l’on a communément avec Hervé, c’est qu’on est tenté de lire ses positions de 1910-1912 à la lumière de sa trajectoire ultérieure : le socialisme réformiste, l’union sacrée, le nationalisme, le proto-fascisme, le pétainisme. Or, il ne faut pas commettre d’erreur de perspective : on ne peut pas prendre l’Histoire à rebours. Le Hervé de 1912 s’explique par celui de 1901, de 1905 et de 1910… pas par celui de 1914, 1919 ou 1940 !
Dans mon livre, je me suis efforcé d’être honnête avec Gustave Hervé. J’ai vraiment cherché à comprendre son évolution. Le directeur de La Guerre sociale n’a en effet nullement attendu 1914 pour réviser ses idées et se faire huer par l’extrême gauche.
C’est dès la fin de 1910 que, par glissements successifs, s’est amorcé un recentrage qui le conduisit, en un peu plus de deux ans, de la gauche antiparlementaire du PS à sa droite « blocarde » — c’est-à-dire partisane du « bloc » électoral avec le Parti radical. Comment l’expliquer ? Jusqu’à preuve du contraire, Hervé n’a jamais été un « vendu ». Toute sa vie, il aura défendu ses propres convictions dans son journal, en toute indépendance. L’ambition personnelle ne l’aura guidé que dans la mesure où il avait un besoin viscéral de provoquer, de parler haut et de n’en faire qu’à sa tête.
Mais il y a un point de départ à son recentrage : sa désillusion vis-à-vis du syndicalisme révolutionnaire. Printemps 1909, première déception : crise de direction à la CGT, puis échec lamentable d’une tentative de grève générale. Automne 1910, seconde déception, très douloureuse : l’échec de la grève des cheminots, qui avait soulevé un immense espoir. Dans les semaines suivantes, Hervé commença à réviser ses idées. C’est la clef de tout. Personnellement, je pense qu’à mesure qu’il a perdu confiance dans l’action autonome du prolétariat, Gustave Hervé a adopté les codes de la politique bourgeoise, de façon de plus en plus assumée et arrogante.
Au printemps 1914, la CGT s’est inquiétée d’une vague d’immigration massive, alors qu’elle peinait déjà à organiser les travailleurs étrangers. Les syndicalistes craignirent des réactions xénophobes dans certaines corporations exposées à la concurrence de la « main d’œuvre étrangère ». Pouvez-vous revenir là-dessus ?
Avant 1914, la CGT avait une activité non négligeable en direction du prolétariat immigré (essentiellement italien, espagnol ou belge). Les fédérations les plus confrontées à la question étaient les mineurs, les métaux et le bâtiment — notamment la corporation des terrassiers, car leur travail, non qualifié, attirait beaucoup les migrants.
Rappelons qu’à l’époque, il n’existait pas de salaire minimum garanti, et que le patronat sous-payait systématiquement les étrangers : parlant mal la langue, privés de droits, vivant avec l’épée de Damoclès d’une expulsion du territoire, ils se défendaient peu. L’enjeu, pour la CGT, était donc de les aider à arracher de meilleures conditions de travail, pour empêcher la baisse générale des salaires.
Les syndicats déployaient tout un répertoire d’actions pour s’adresser aux migrants. Ils pouvaient éditer des publications en langue étrangère, faire venir de l’étranger un orateur syndicaliste pour les aider… Ils pouvaient salarier un militant, pendant une ou plusieurs années, pour aider les migrants à organiser leurs propres syndicats. C’est ce qu’ont fait Boudoux, Alphonse Merrheim et Marius Blanchard, en Lorraine (entre 1905 et 1907), ou Frago et Roueste, sur le littoral méditerranéen (en 1913). Ils allaient de mine en usine, d’usine en chantier, à pied, pour implanter des syndicats. Ils s’adressaient aux milliers d’Italiens et d’Espagnols exploités dans des conditions misérables. Il leur fallait d’abord trouver un interlocuteur parlant français, puis former un premier noyau d’ouvriers désireux d’agir, monter un petit syndicat, enfin lancer une grève, soutenir la répression, le harcèlement des jaunes, tenter de maintenir le syndicat en vie…
Cela ressemble beaucoup à la pratique des organizers développée aux États-Unis depuis les années 1930 (et que Ken Loach a mis en scène dans son film Bread and Roses). En France, la presse bourgeoise les avait surnommés les « gréviculteurs ».
Il y avait également des pratiques, aujourd’hui oubliées, comme la « tournée hivernale », que la Fédération du bâtiment expérimenta en 1912-1913 (en s’inspirant de son homologue allemande) : deux hivers de suite, un propagandiste italophone fut envoyé dans les zones d’émigration de la péninsule, pour sensibiliser les travailleurs à la question sociale avant leur migration printanière. La tâche était ardue : dans certains villages analphabètes et pétris d’obscurantisme, l’émissaire de la CGT était accueilli avec des cailloux ! Il lui fallait payer des tournées au café pour faire passer son discours sur la nécessaire solidarité de classe.
Loin de tout protectionnisme, la CGT avait donc inventé des pratiques internationalistes très concrètes pour lutter avec les travailleurs migrants.
La situation se compliqua à partir du 2e semestre 1913, en raison de l’allongement du service militaire à trois ans, qui mobilisa une classe d’âge supplémentaire à la caserne. Pour compenser cette perte de main d’œuvre, le patronat importa massivement des ouvriers étrangers, encadrés par ce qu’on appelait des mercantis (ou « marchands d’hommes »), chargés de recruter dans les régions pauvres. On n’a évidemment pas de chiffres fiables, mais La Bataille syndicaliste évoqua à l’époque 300 000 immigrés liés à la loi de trois ans (dont 200 000 rien qu’en région parisienne). La nouveauté, c’est que le patronat recruta bien au-delà des traditionnels pays limitrophes : Russes, Arabes, et même Chinois, firent leur apparition.
Pour les cégétistes, c’était un véritable défi : ils avaient déjà du mal à organiser les Espagnols, les Italiens ou les Belges. Avec des immigrés venus de pays non industrialisés, où le syndicalisme était inconnu, de même que la pratique du français, ils se sentirent dépassés. En mars 1914, la CGT désigna une commission d’étude pour plancher sur la question. Ce fut un des débats importants du congrès fédéral du bâtiment, en avril 1914, et il était également inscrit à l’ordre du jour du congrès confédéral de septembre 1914, prévu à Grenoble. L’irruption de la guerre et le retour de centaines de milliers de travailleurs immigrés dans leurs foyers rendit cette question provisoirement obsolète.
En août 1914, quand la guerre éclata avec l’Allemagne, ce fut la « trêve des partis » (bientôt rebaptisée « union sacrée » contre l’ennemi commun). L’idéologie de la défense nationale devait faire des dégâts jusque dans les rangs libertaires. Quelle fut alors l’attitude de la FCA ?
Raconter l’attitude militante de la FCA pendant la Grande Guerre, ce serait amorcer un nouveau livre qui raconterait la désespérance, les reniements, mais aussi la résistance à la guerre et à l’union sacrée, en suivant les personnages de Trop jeunes pour mourir sur la période 1914-1919. Je le ferai peut-être un jour, d’autant qu’il y aurait bien des épisodes épiques à raconter. Je pense par exemple aux réunions secrètes des Amis du Libertaire ; au groupe des terrassiers révolutionnaires de Longjumeau qui constitua un des premiers foyers de contestation de ligne majoritaire de la CGT ; à la controverse qui déchira l’ancienne rédaction des Temps nouveaux ; à l’aventure de l’hebdomadaire pacifiste CQFD, avec un Sébastien Faure louvoyant en permanence pour éviter la censure ; à la conférence de Zimmerwald, à laquelle le militant de la FCA Henri Bécirard fut empêché d’assister par la police ; à l’action avant-gardiste et presque d��sespérée d’un noyau de militants de la FCA autour de Louis Lecoin ; à la création du Comité de défense syndicaliste (avec Jules Lepetit), pour regrouper les syndicats minoritaires ; au congrès irrégulier de Saint-Étienne qu’ils ont tenu ; à la tentative de grève générale pour la paix en mai 1918 ; à la grève de la métallurgie parisienne en juin 1919…
Il y a là tout un pan de l’histoire du mouvement ouvrier révolutionnaire qui n’a jamais été raconté, même pas par Alfred Rosmer. Un peu parce qu’il n’en a pas eu le temps — il est mort avant de rédiger le tome III de son livre15 —, un peu parce que les anarchistes communistes n’étaient pas vraiment ses amis.
Vous racontez la peur qui s’abattit sur la CGT en juillet 1914 : la crainte du Carnet B, du fossé d’exécution. Raymond Péricat relatera, plus tard, l’ambiance qui régnait au comité confédéral du 28 juillet : « Beaucoup de délégués suent la peur. […] Certaines faces blêmes sont déjà marquées du stigmate du reniement. » Cette peur d’une répression impitoyable explique-t-elle l’inaction de la CGT durant la crise européenne ?
La peur est un élément explicatif, mais il ne faut pas l’isoler de son contexte si on veut comprendre l’attitude des militants de la CGT. Je pense que, fondamentalement, c’est surtout l’idée de faire en vain le sacrifice de sa vie qui les a paralysés. Appeler à la grève générale, si personne ne suivait, à quoi cela servirait-il… hormis à se faire coller au poteau pour trahison nationale ? Entrer dans les livres d’histoire comme martyr de la cause ? Avec un minimum d’empathie, on peut comprendre l’hésitation des militants de la CGT, et éviter de les juger avec une condescendance mal placée.
Comme je le montre dans le livre, les responsables de la CGT étaient d’authentiques révolutionnaires, qui assumaient leurs actes et leurs paroles, jusqu’en prison s’il le fallait. Quand ils prônaient la grève générale en cas de guerre, cela n’avait rien d’une posture rhétorique. Cependant, leur persévérance en la matière n’avait guère été récompensée. Pendant quinze ans, ils avaient fait la propagande de cette idée dans les masses (et ils l’avaient fait avec une ardeur renouvelée à partir de l’été 1911). Cependant, ils ne se racontaient pas d’histoires : ils savaient que seule une avant-garde, au sein de la classe ouvrière, adhérait à cette idée. Cela leur fut confirmé en décembre 1912, pendant le conflit balkanique, avec la grève générale d’avertissement qu’ils organisèrent contre la guerre. Son bilan mitigé ramena à sa juste mesure l’influence réelle de la CGT.
Autre problème, et de taille : l’attitude de la social-démocratie, qui tenait le syndicalisme allemand entre ses mains. Pendant dix ans, les cégétistes avaient demandé que les questions de l’antimilitarisme, de la guerre et de la grève générale soient inscrites à l’ordre du jour des congrès syndicaux internationaux — une demande systématiquement rejetée par leurs homologues allemands.
En juillet 1914, la situation n’était donc pas brillante : la CGT était affaiblie — elle avait sans doute perdu un tiers de ses effectifs depuis trois ans —, elle traversait une crise morale, et sortait à peine d’un an de violentes polémiques internes. Ses dirigeants pensaient qu’elle était, moins qu’en 1912, capable de mobiliser. Et ils avaient la conviction qu’outre-Rhin, les syndicats allemands ne tenteraient nullement de lancer une grève générale dont ils n’avaient jamais voulu discuter.
Simultanément, le gouvernement proférait des menaces de mort explicites : application du Carnet B (cette liste noire des militants à arrêter en cas de guerre), guillotine pour les plus dangereux, camp de concentration ou envoi en première ligne pour les autres…
Tout cela pesa sur les épaules des responsables de la CGT pendant la très brève semaine de crise européenne qui précéda la guerre — un laps de temps trop court pour leur laisser le temps de faire grand-chose. Pas étonnant, dans ces circonstances, qu’ils se soient retranchés derrière une interprétation stricte de la motion du congrès de Marseille (1908) : la grève générale contre la guerre devait partir de la base, la responsabilité ne leur en incombait pas.
Après-guerre, notamment au congrès confédéral de 1919, la question de l’attitude de la CGT en 1914 sera longuement débattue. La minorité révolutionnaire, par la voix de Pierre Monatte et de Jules Lepetit, reconnaîtra elle-même qu’appeler à la grève générale en juillet 1914 n’aurait pas eu de sens. Que l’échec aurait été sanglant. Ce qu’ils reprocheront, en revanche, à Léon Jouhaux et à la majorité de la CGT, c’est d’avoir par la suite versé dans l’union sacrée, la collaboration de classe, et le patriotisme. Ils auraient pu, au pire, s’abstenir de parler, se contenter de faire profil bas en attendant des jours meilleurs. Mais non, au lieu de cela, ils avaient placé la CGT sous la tutelle du gouvernement, participé à l’effort de guerre et au bourrage de crâne, et même refusé d’approuver les timides initiatives pacifistes menées dans les pays neutres. Là était leur vraie faillite, leur véritable trahison, et c’est ce sur quoi la minorité révolutionnaire de la CGT devait refuser de passer l’éponge, après guerre.
/////////////////
Notes :
Gil Devillard : « Chez Renault, militer dans le groupe Makhno, ce n’était pas de tout repos ! », Gavroche, octobre-décembre 2006. Disponible en ligne sur Alternativelibertaire.org.
Rolf Dupuy et Guy Malouvier : « Chacun de ces mots comptait : organisation ; révolutionnaire ; anarchiste », Alternative libertaire, mai 2008. Disponible en ligne ici.
Patrice Spadoni et Thierry Renard : « Il y avait toute une mythologie qui entourait l’ORA », entretien de 2005, paru dans Théo Rival, Syndicalistes et libertaires. Une histoire de l’Union des travailleurs communistes libertaires (1974-1991), Alternative libertaire, 2013.
Entretien de 2006, qui nourrit la notice biographique parue dans le Maitron des anarchistes, en 2014.
Entretien de 2014, qui a nourri une notice à paraître dans le Maitron-en-ligne.
Au sujet de l’affaire Liabeuf, lire Trop jeunes pour mourir, page 91.
Elles ont depuis été déplacées au 25, rue Baudin, au Pré-Saint-Gervais.
Témoignage anonyme d’« officiers républicains et socialistes » paru dans L’Humanité du 8 juin 1912.
Charles Maurras, « L’armée sans l’État », L’Action française du 11 mars 1912.
La Seine était le département qui, avant 1966, regroupait Paris, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis.
Jacques Julliard, Autonomie ouvrière. Études sur le syndicalisme d’action directe, Gallimard-Le Seuil, 1988.
Parler d’anarcho-syndicalisme avant 1922 est un anachronisme.
Zeev Sternhell, La Droite révolutionnaire, 1885-1914. Les origines françaises du fascisme, Le Seuil, 1978.
Sternhell a décelé, dans l’antiparlementarisme du syndicalisme révolutionnaire, un germe de fascisme (!). Or, celui-ci opposait au parlementarisme la démocratie ouvrière directe, nullement un État dictatorial et militarisé… Sternhell ne l’a pas compris, ou a fait semblant de ne pas le comprendre.
Alfred Rosmer, Le Mouvement ouvrier pendant la guerre, tome I, Librairie du travail, 1936 ; tome II, Mouton & Co, 1959.
0 notes
Quote
There is an idea which says that the spontaneous initiative of the masses is enough for every revolutionary possibility. It’s true that history shows us some events that we can regard as spontaneous mass advances, and these events are precious because they show the abilities and resources of the masses. But that doesn’t lead at all to a general concept of spontaneity — this would be fatalistic. Such a myth leads to populist demagogy and justification of unprincipled rebellism; it can be reactionary and end in a wait-and-see policy and compromise. Opposed to this we find a purely voluntarist idea which gives the revolutionary initiative only to the vanguard Organisation. Such an idea leads to a pessimistic evaluation of the role of the masses, to an aristocratic contempt for their political ability to concealed direction of revolutionary activity and so to defeat. This idea in fact contains the germ of bureaucratic and Statist counter-revolution. Close to the spontaneist idea we can see a theory according to which mass organisations, unions for example, are not only sufficient for themselves but suffice for everything. This idea, which calls itself totally antipolitical, is in fact an economistic concept which is often expressed as ‘pure syndicalism’. But we would point out that if the theory wants to hold good then its supporters must refrain from formulating any programme, any final statement. Otherwise they will be constituting an ideological Organisation, in however small a way, or forming a leadership sanctioning a given orientation. So this theory is only coherent if it limits itself to a socially neutral understanding of social problems, to empiricism. Equally removed from spontaneism, empiricism and voluntarism we stress the need for a specific revolutionary anarchist Organisation, understood as the conscious and active vanguard of the people.
Manifesto of Libertarian Communism - Georges Fontenis
Even though I like pretty much all of what this says, that end part of the last paragraph really nags me. The anarchist organisation won’t be The Vanguard of the People, it won’t be some staunch defender of the proletariat. I’m not opposed to using a concept of vanguardism, meaning the people first into the fray of struggles, the pioneers of new forms of working class organisation etc but there’s no way one organisation will be The Vanguard, unless a different definition is being used which renders it redundant. Like in the sense of trying to defend workers gains, the process of communisation, deepening the social revolutionary aspect from reaction but that’s something else because the AO/other revoluionary groups are autonomous organisations that don’t/shouldn’t control the popular organs of power that arise in a revolutionary situation.
#anarchism#communism#socialism#manifesto of libertarian communism#georges fontenis#reading through this rn
3 notes
·
View notes