#philosophie spirituelle
Explore tagged Tumblr posts
Text
Buch-Vorstellung:
"Die Suche - Mein Weg zum Glück"
Sie beginnt an einem ziemlich düsteren Ort, wird aber zunehmend heller. ^^
Auf Amazon erhältlich unter:
für 7,50 Euro als Taschenbuch
Oder für
1,52 Euro als eBook.
Liebe an euch alle! 💜
instagram
#nilsnoeske#buch#autor#spirituell#geschichten#texte#leben#glück#glücklichsein#liebe#kraft#philosophie#psychologie#licht#lehren#lektionen#buchvorstellung#liebeaneuchalle#Instagram
0 notes
Text
youtube
0 notes
Text
Que recherchons-nous à travers nos relations, rencontres et échanges ?
Quel est le sentiment que nous désirons ardemment éprouver, tout au long de notre vie ?
L’amour est évidemment la réponse à toutes ces questions.
L’amour est ainsi le principe et la source de toute vie, sans quoi rien ne pourrait exister ni subsister.
L’amour est la force qui fait tourner les mondes, l’énergie qui maintient la cohésion des atomes comme des planètes.
L’amour est au cœur des mystères que nous sommes venus appréhender et expérimenter sur cette Terre.
Chacun ressent et pressent, même confusément, que l’amour vrai est la clé et la solution de tous nos maux, individuels et surtout collectifs, économiques, politiques et sociaux.
Mais l’amour véritable n’est pas acquis d’emblée : il est à rechercher, ressentir, découvrir.
Il n’est ni instinct de possession, ni dépendance fusionnelle, ni suivisme grégaire, car il émane de soi.
Il est le résultat de l’alchimie intérieure, le fruit de la reconnexion à l’être essentiel et à la puissance de vie.
L’amour est la joie d’être, le signe d’une conscience éveillée et lumineuse, un présent accordé, offert et partagé.
L’amour est ce que nous sommes éternellement, en dépit de nos souffrances, illusions et désillusions et parfois grâce à elles ; il est notre état naturel, notre aspiration à une vie riche, fascinante, magique, inattendue, utile et initiatique.
L’amour est partout, omniprésent et protéiforme ; il se pare de toutes les couleurs et de toutes les fréquences, et se manifeste de multiples manières : amour du compagnon ou de la compagne, des amis, des enfants, des animaux, de la nature, de la beauté, des œuvres de l’esprit…
Mais c’est la relation amoureuse qui se révèle son territoire de prédilection, car alors le sentiment se mêle au désir, à la sensualité et à l’attraction des corps, lieu de toutes les convoitises, de tous les délires et de toutes les extases.
Ce que l’on nomme amour est rarement digne de ce nom : l’amour qui blesse et qui déchire, qui conquiert et qui rompt, qui domine et qui soumet, qui idolâtre et qui méprise, n’est qu’une caricature égotique, une maladie infantile du cœur, un balbutiement du sentiment.
L’amour qui prend fin n’a jamais existé ; l’amour qui se meut en haine ou indifférence, n’était qu’illusion, transfert, projection, malentendu.
Les relations évoluent et donnent souvent lieu à séparation, éloignement, divergence. Mais comment peut-on rejeter, nier ou diaboliser l’être que l’on a tenu tendrement dans ses bras, si ce n’est précisément à cause de la douleur créée par son absence ?
L’amour véritable est patient, sincère, honnête et compréhensif ; il se nomme bienveillance, bonté, compassion, douceur, tendresse, sollicitude ou empathie.
De la nature de l’amitié, il dure la vie entière, car il n’est pas fondé sur l’image ou les apparences, mais sur les liens invisibles et mystérieux qui unissent les âmes et les cœurs.
Aussi le chemin de l’amour, que tous nous empruntons à notre manière, est-il un apprentissage, qui mène de l’égoïsme à l’altruisme, de l’aveuglement à la connaissance, de la consommation au partage, de la prédation au don.
L’amour est éternel car il est spirituel ; il est la joie libre du cœur qui s’est ouvert ; il ne sait que grandir, fleurir et embellir.
L’amour est si puissant qu’il se joue des barrières, frontières, critères, normes et interdits.
Car l’amour est libre et il souffle où il veut ; il ne peut être contraint, obligé ou mis en cage ; l’autre ne nous appartient pas et l’emprisonner, ce n’est pas l’aimer.
L’amour ne donne ni droits, ni devoirs ; il est une extraordinaire opportunité de vivre des moments merveilleux et magiques, une chance à ne surtout pas laisser passer.
Et si l’amour était sagesse, philosophie éminemment subtile, art et science oubliés, à retrouver, découvrir, réinventer ?
L’amour est un défi. Saurons-nous y répondre ?
LA SAGESSE AMOUREUSE
Yann Thibaud
Extrait de «L'Alchimie émotionnelle ou la métamorphose du coeur»

53 notes
·
View notes
Text

Le Zen dans l’art chevaleresque du tir à l’arc est un petit livre écrit par Eugen Herrigel (1884 – 1955), professeur de philosophie allemand qui s’intéressait au mysticisme. De 1924 à 1929, il a enseigné la philosophie au Japon, où il a étudié le kyūdō (l’art japonais du tir à l’arc) sous la direction du maître Awa Kenzo, qui l’enseignait d’une façon considérée par certains comme une religion mystique, appelée Daishadokyo. Daishadokyo était une approche du Kyūdō qui insistait sur l’aspect spirituel, ce qui la différenciait de la pratique courante de l’époque. En 1936, Herrigel écrivit un essai de 20 pages sur son expérience, et en 1948 l’étendit sous forme d’un petit livre, traduit en anglais en 1953 et en japonais en 1955. Eugen Herrigel raconte qu’il veut étudier le zen, discipline que l’approche occidentale ne permettait pas de comprendre à ce moment-là. Il trouve alors le kyūdō comme support à cette étude, et de fait, le sujet du livre est le zen à travers le kyūdō, qui est évoqué sans s’étendre sur les détails.
15 notes
·
View notes
Text

«Le Discord estant en l’Homme par la contrariété envers l’Esprit et la Chair» (Marguerite de Navarre)
«Seuls les morts auront vu la fin du combat.» (Platon)
Et si le véritable combat se livrait toujours à l’intérieur de l’ordre symbolique lui-même ?
N’est-ce pas là que se déroulent de toute éternité les luttes entre les représentants d’une humanité toujours déjà effondrée, se trahissant elle-même, et l’homme qui s’efforce de tenir debout, combattant pour conserver sa tenue, se fortifiant dans le combat?
Les combats spirituels de l'humanité européenne peuvent être abordés comme des combats entre des "philosophies", et compte tenu de l'approche psychanalytique de la perversion qui peut être dite comme celle du "déni de la dimension subjective à proprement parler", une véritable lutte à mort de pur prestige oppose:
• aux philosophies "perverses" qui font l'apologie de l'individu compris comme un être naturel, corporel, vivant, allant de soi, incarné dans un monde conçu comme le lieu "naturel" de son inscription, un "monde social" dans lequel il entretiendrait a priori des rapports avec ses semblables…
• la philosophie authentique, celle de l'hystérique, qui fut donc inaugurée par Socrate, et dont la caractéristique principale est de partir d'emblée d'un sujet travaillé intérieurement par son manque-à-être, un sujet divisé par la question de savoir ce qu'il est pour le désir de l'Autre, ce que l'Autre attend de lui, un sujet qui ne peut se concevoir que dans le retrait, une radicale extériorité par rapport à la prétendue "réalité objective" qui apparaît dès lors comme une contradictio in adjecto.
L'écart entre les deux conceptions tient au statut de la "réalité": dans un cas, la réalité est donnée par avance: "il faut faire avec", alors que pour la philosophie authentique, celle qui prend son essor avec Socrate, la réalité est constituée par la manière dont le sujet se trouvant toujours déjà lui-même pris dans un certain rapport à ladite "réalité", il en questionne les coordonnées…
Le moment inaugural de sa liberté consistant en un refus radical de se trouver lui-même intégré dans la chaîne des causes et des effets.
La structure élémentaire de la subjectivité repose en effet sur un "pas tout" de la causalité.
Pour le psychanalyste, l'acte véritable, le seul acte digne de ce nom, est celui d'une suspension de la réalité constituée, donnée par avance. La théorie analytique rejoint ici l’acmé de la pensée de Hegel pour qui la réalité apparaît comme posée, constituée par le sujet, et non pas simplement quelque chose qui s'impose à lui de l'extérieur…
Ce que la pseudo-psychanalyse, la psychanalyse d’institutions, la psychanalyse "molle" qui ressortit du Discours Universitaire (psychologie) a perdu, c'est cette dimension cruciale d'une réalité posée par le sujet, la conduisant à différer du sens commun (comme du "discours scientifique"…) qui accepte la "réalité externe" comme un postulat donné par avance, une "objectivité", une "normalité" à quoi l'appareil psychique devrait se raccorder, se connecter, "s'adapter"...
Pour le psychanalyste authentique, il ne s'agit pas de "faire changer la réalité", mais de rectifier les rapports du sujet au réel, de telle sorte que le sujet puisse changer les coordonnées à partir desquelles se constitue, pour lui, ce qu'il appelle "réalité" qu’il distinguera du réel qui n’en est que la grimace.
En témoigne le cas de cet analysant inconsolable à qui fut posée la question: "si vous pouviez recréer exactement la même femme, votre femme qui est morte, seriez-vous capable aujourd'hui de l'aimer en lieu et place de votre femme?", la réponse fut décisive: "non, elle ne pourrait pas être la même!"
En énonçant ces mots, l'analysant mît un terme à son "état dépressif". Il avait réalisé que la place vide ne pouvait être remplie par aucun désir.
Il s'était tenu au bord de l'impossible, l'impossible de remonter le temps, l'impossible de retrouver le passé, l'impossible qui structure et conditionne l'ordre des possibles…
Réel est l’un des noms de cet impossible.
Entre nous et le Réel, il y a la vérité…
Pour Freud, la vérité de la souffrance est d’avoir la vérité comme cause.
7 notes
·
View notes
Text

Que toute la civilisation moderne ait un caractère essentiellement anti-aristocratique sur le plan politique et social est évident. Mais on peut en dire autant pour d'autres domaines : le domaine spirituel, la culture et la vision de la vie, bien que l'orientation anti-aristocratique soit ici plus difficile à saisir, les points de référence indispensables ayant été presque totalement oubliés.
Nous voudrions maintenant mettre en relief un aspect particulier de la situation, en rapport avec l'avènement de l'« humanisme ». Nous employons ce terme au sens large, non au sens de l'humanisme historique apparu pendant la Renaissance, bien que cet humanisme ait représenté un tournant fondamental sur le plan dont nous parlons. Par « humanisme », nous entendons par conséquent une vision globale tout entière centrée sur l'homme, sur la condition humaine, ce qui est humain devenant alors l'objet d'un culte, pour ne pas dire d'un véritable fétichisme. Mais nous n'envisagerons pas les formes les plus basses de ce culte, comme par exemple l'« humanisme marxiste » et l'« humanisme du travail » ; nous tournerons au contraire notre attention vers les formes qui se rattachent à la « vision tragique de la vie » et sur leur propension à reconnaître une grande valeur humaine à des personnages révoltés et subversifs de l'histoire et du mythe, et à se ranger aussi à leurs côtés. C'est là, en effet, le versant idéal et romantique des idéologies révolutionnaires, plébéiennes et subversives de notre époque.
Selon une certaine mentalité, être homme, et seulement homme, serait une gloire. Tout ce que la condition humaine contient de misérable, de sombre, de douloureux, de déchirant est appelé « tragique » et, en tant que tel et conformément aux prémisses, se trouve donc exalté. Le prototype de l'esprit humain avec toute sa « noblesse », on le découvre chez le rebelle qui s'est révolté contre les forces supérieures, chez le titan : Prométhée.
On parle aussi d'« œuvres profondément humaines », de « conscience humaine », de « sentiment humain vrai et profond ». On admire la « grandeur tragique » d'une existence, ou le visage illuminé par une « tragédie intérieure » ; on célèbre enfin l'« esprit prométhéen », le « noble esprit de révolte », le « titanisme de la volonté », et ainsi de suite. Cela peut même aller jusqu'à l'hymne à Satan de Carducci et à certaines variantes du culte de Faust. C'est là un jargon courant chez les intellectuels et les lettrés partisans d'une philosophie historiciste et progressiste plus ou moins héritière des Lumières. De ce jargon, il semble que personne n'ait perçu le ridicule ni la rhétorique, et l'on est même tombé encore un peu plus bas avec l'« humanisme intégral », collectiviste, matérialiste et marxiste, lequel s'empressa de liquider ces superstructures pour pr��ner une mystique de la bête de somme et de production. On est ici en présence d'indices précis sur le caractère spirituellement anti-aristocratique d'une vision typiquement moderne de la vie.
Pour prendre vraiment conscience de cette chute de niveau, on peut se référer à l'Antiquité, à des aspects, des mythes et des symboles spécifiques de ce monde, pourvu qu'on sache les interpréter justement, et non sous la forme faussée ou insignifiante qui nous en est donnée par les recherches les plus courantes. Dans cette optique, il ne sera pas inutile de commenter ce que K. Kerényi a écrit dans son ouvrage Les orientations fondamentales de la religion antique, sur la signification de Prométhée et sur l'esprit des Titans.
À titre préliminaire, deux choses sont bien mises en relief. La première, c'est que l'ancien monde classique ignora, sous ses formes les plus élevées et originelles, la « foi » au sens courant du terme, sa religiosité reposant essentiellement sur la certitude de la réalité et de la présence effective des forces divines. « La foi présuppose le doute et l'ignorance, que l'on surmonte précisément par la croyance ». La « foi » ne joua pas un rôle important dans la vision de la vie de l'homme antique parce que la certitude de l'existence des forces divines faisait partie de son expérience et de sa vie aussi naturellement et directement que, sur leur plan, les données du monde sensible. C'est pour cette raison — remarquons-le au passage — qu'on encourage des confusions très regrettables lorsque le terme « religion », pris dans son sens devenu courant surtout dans la sphère chrétienne, dont le centre est la foi, est appliqué aveuglément à la spiritualité antique et, d'une manière plus générale, à la spiritualité des origines. On peut à ce sujet se référer à ce que nous avons déjà dit sur le « mythe » traditionnel et à ce que nous dirons plus loin sur la définition de l'initiation.
La seconde chose concerne l'idée d'une unité originelle des dieux et des hommes. « Les dieux et les hommes ont la même origine », enseigne Hésiode, et Pindare le répète. Deux races, mais un même « sang ». En présence des forces divines, l'initié orphique dit : « Céleste est ma race, et vous aussi le savez ». On pourrait énumérer de nombreux témoignages analogues. Même dans les Évangiles, qui baignent pourtant dans une atmosphère radicalement différente de celle de la Grèce, on trouve la parole « Vous êtes des dieux ».
Les dieux regardent les hommes, sont présents dans leurs fêtes et leurs banquets rituels — Rome connut la cérémonie caractéristique du lectisterne —, les dieux apparaissent, siègent auprès des hommes, et ainsi de suite : mais dans le monde antique, ces images ne furent pas de simples fantaisies. Elles attestent à leur façon, de manière figurative, la certitude que les hommes vivent avec les dieux. Elles sont les traces d'une condition existentielle bien précise.
Il ne s'agit donc pas ici de « mysticisme ». Kerényi écrit : « À partir d'Homère et d'Hésiode, cette forme absolue d'un "vivre avec les dieux" non mystique peut être définie ainsi : être assis ensemble, se sentir et savoir qu'on se regarde dans l'état originel de l'existence ». Kerényi parle d'un état originel de l'existence en raison de l'antiquité très reculée des témoignages à travers lesquels s'exprima ce sentiment vécu.
Au cours des temps, ce sentiment s'affaiblit, il dut être réactivé par des actes cultuels particuliers, pour ne plus subsister que de façon sporadique à la fin. Homère dit déjà que la vivante présence des dieux, comme dans l'état originel, n'est expérimentée que par certains peuples, « dont l'existence oscille entre la divinité et l'humanité, et qui sont même plus proches des dieux que des hommes ».
On ne doit pas songer obligatoirement à des races d'une antiquité mystique. Nous trouvons encore dans la Rome antique des témoignages précis et significatifs. On peut rappeler la figure du flamine de Jupiter (flamen dialis), qui fut considéré comme une « statue vivante » de la divinité olympienne, et la description, par Livius, de certains personnages de l'époque de l'invasion des Gaules, « plus semblables à des dieux qu'à des hommes » : praeter ornatium habitumque humanum augustiorem, maiestate etiam… simillimos diis. César lui-même, qui se présente aux yeux de la plupart des gens sous les traits profanes du « dictateur » et du conquérant quasiment napoléonien, est aussi celui que décrit Suétone : celui qui, dans sa jeunesse, affirma que sa lignée possédait « la majesté des rois et le sacré des dieux, dans la puissance desquels se tiennent aussi ceux qui sont des dominateurs d'hommes ». Jusque dans le chaos du Bas-Empire subsistèrent des idées et des coutumes qui, tels des éclairs troubles, renvoient à ce sentiment naturel de la présence des dieux.
« Des peuples, dont l'existence oscille entre la divinité et l'humanité » — là est l'important. Après ce stade, les vocations devaient se séparer. Et ce qui devait arriver arriva : celui qui oscillait entre la divinité et l'humanité finit par se décider pour la seconde et par s'en vanter. L'homme ne s'aperçut pas de cette chute implicite, ni du rire des dieux. C'est de cela que parle Kerényi dans ses considérations sur la façon dont l'Antiquité, originellement, comprit l'esprit des Titans.
Hésiode définit très clairement cet esprit à travers les épithètes qu'il attribue à Prométhée : toutes sont des désignations de l'esprit actif, inventif, astucieux, qui veut tromper le noûs de Zeus, c'est-à-dire l'esprit olympien. Mais celui-ci ne peut être trompé ni ébranlé.
Il est ferme et tranquille comme un miroir, il dévoile tout sans chercher, c'est au contraire le Tout qui se dévoile en lui. L'esprit titanique, en revanche, est inquiet, inventif, toujours en quête de quelque chose, avec son astuce et son flair. L'objet de l'esprit olympien, c'est le réel, ce qui est tel qu'il ne peut pas être autrement, l'être. L'objet de l'esprit titanique, par contre, c'est l'invention, même s'il s'agit uniquement d'un mensonge bien construit.
Les expressions employées par Kerényi méritent d'être rapportées ici. À l'esprit olympien correspond l'alêtheia, c'est-à-dire le non-être-caché (terme qui, en grec, désigne la vérité), alors que l'esprit titanique aime ce qui est « tordu », car « tordu » (skoliós) est, de par sa nature, le mensonge, de même qu'est « tordue » aussi une invention intelligente, comme par exemple le lasso, le nœud coulant (brochós). La contrepartie naturelle de l'esprit olympien, du noûs, c'est la transparence de l'être ; quand le noûs disparaît, l'être demeure, mais dans sa réalité aveuglante. La contrepartie naturelle de l'esprit titanique, c'est en revanche la misère spirituelle : stupidité, imprudence, maladresse. Chaque invention de Prométhée n'apporte au monde qu'une misère de plus infligée à l'humanité ; après le sacrifice réussi (sacrifice par lequel Prométhée a cherché à tromper l'esprit olympien), Zeus reprend aux mortels le feu. Et quand après le vol du feu, Prométhée est enlevé à l'humanité pour endurer sa peine, il ne reste qu'Épiméthée pour représenter la race des hommes : à la place de l'astucieux ne reste donc — comme son ombre — que le stupide.
L'affinité qui unit en profondeur ces deux personnages du mythe grec s'exprime par le fait qu'ils sont frères. On pourrait presque dire qu'« un être unique et originel, astucieux et stupide à la fois, semble ici dédoublé sous la forme de deux frères inégaux ». Prométhée est l'astucieux, le prévoyant, Épiméthée celui qui réfléchit trop tard. Imprudent, celui-ci acceptera le don des dieux, la femme, dernière et inépuisable source de misère pour l'humanité. Et Zeus — si l'on en croit Hésiode qui raconte le dernier et décisif épisode de la lutte entre les deux esprits — Zeus, sachant que les hommes se réjouiront de ce don et aimeront leur propre malheur, Zeus rit.
Voilà ce que rapporte Kerényi. Ce rire est la vraie défaite du titan et du prévaricateur. Kerényi fait bien ressortir cette idée fondamentale du monde antique : le rire des Olympiens est meurtrier. Mais personne à proprement parler ne meurt, rien n'est changé dans l'être humain plein de contradictions, et dont les représentants sont, à un même titre, Prométhée et Épiméthée. Qu'est-ce qui est donc détruit par ce rire ? C'est l'importance même de la misère des Titans, leur soi-disant tragédie. Devant Zeus, le spectateur qui rit, l'éternelle race des hommes joue son éternelle comédie humaine.
Même quand un élément héroïque intervient, rien ne change dans cette situation, dans ce rapport de valeurs. Kerényi le montre très bien. Dans l'antique conception du monde, le fond originel et titanique de l'homme, d'une part, le rire des dieux, de l'autre, sont intimement liés. L'existence humaine, en tant qu'elle reste totalement prisonnière de ce fond originel, est misère et, du point de vue olympien, ridicule, sans importance. Lorsque les actions humaines se hissent au niveau de l'épopée, cette signification n'en est que confirmée. Selon la vision antique, la gravité des discordes et des tensions, des luttes et des massacres de la malheureuse race des hommes autrefois frères des dieux, peut même avoir des résonances cosmiques. Précisément pour mettre en relief la grandeur de cette tragédie, Homère admet que la nature, par des prodiges, brise ses propres lois et y participe. Tout semble concourir à accroître la tragique importance du héros.
Et pourtant, selon le point de vue de la spiritualité antique auquel nous nous référons, selon ce qu'on pourrait appeler le point de vue de « l'état originel de l'existence », vécu avant la consolidation du mirage humain et prométhéen — pourtant, tout cela fait mouvoir et trompe aussi peu le noûs, l'esprit olympien, que ne l'avait fait l'astuce des Titans. Kerényi dit que la seule illusion admissible par la conception antique dans les rapports entre l'homme et le divin était la tragique importance de l'existence héroïque comme spectacle de choix pour les dieux (ce que Sénèque affirmera aussi plus d'une fois). Mais le côté le plus tragique de cette importance même, c'est que, tant que l'œil spirituel du héros tragique ne s'est pas complètement ouvert, tout doit s'annuler, s'anéantir devant un rire divin. Car ce rire n'est pas, comme on pourrait le penser selon une perspective humaine, le rire d'une « béatitude absolue » et creuse, mais la marque d'une plénitude existentielle ; c'est le rire de formes éternelles.
Telle fut, aurait dit Nietzsche, qui était pourtant lui-même, à plus d'un titre, une victime du mirage titanique, telle fut la profondeur de l'âme antique et classique.
Tout cela dans le domaine mythologique. Mais la mythologie n'est pas imagination délirante. Dans ce contexte, et si l'on met à part ce que nous avons dit dans un précédent chapitre sur ses autres dimensions possibles, métaphysiques, intemporelles, le mythe est « le miroir des expériences d'une race à la lumière de sa religiosité » (Bachofen). Il nous fait connaître les forces profondes qui agirent sur la formation des civilisations. Les idées évoquées ici suggèrent deux directions, et donc une autre possibilité que celle dont le mythe de Prométhée et des Titans, tel qu'il a été repris par l'humanisme, est l'expression.
Le cadre mythologique — Zeus, les dieux, les parentés divines, etc. — ne doit pas voiler l'essentiel en donnant éventuellement une impression d'étrangeté fantastique et d'anachronisme. En principe, l'esprit a toujours la possibilité de s'orienter selon l'une ou l'autre des deux conceptions opposées et d'en tirer une mesure et même un « fond musical » pour toute l'existence. L'orientation « olympienne » est possible, tout autant que l'orientation prométhéenne, et peut se traduire, abstraction faite des symboles et des mythèmes antiques, dans une manière d'être, dans une attitude précise devant les vicissitudes intérieures et extérieures, devant l'univers des hommes et le monde spirituel, devant l'histoire et la pensée.
Cette orientation joue un rôle essentiel dans tout ce qui est vraiment aristocratique, tandis que l'orientation prométhéenne possède un caractère fondamentalement plébéien et ne peut connaître, au mieux, que le plaisir de l'usurpation. Dans le monde antique, non seulement gréco-romain, mais plus généralement indo-européen, toutes les divinités principales de la souveraineté, de l'imperium, de l'ordre, de la loi et du droit, présentent des traits foncièrement olympiens. En revanche, l'affirmation historique de l'orientation prométhéenne a entretenu des rapports étroits avec tout ce qui a agi dans le sens d'une attaque contre toute forme d'autorité légitime, avec la tendance à y substituer abusivement des principes et des valeurs liés aux couches les plus basses de l'organisme social, dont la correspondance chez l'individu — nous l'avons déjà mis en évidence à plusieurs reprises dans les chapitres précédents — est précisément sa partie « physique », purement humaine.
D'une manière générale, avec l'avènement de l'humanisme et du prométhéisme, il a fallu choisir entre la liberté du souverain et celle du rebelle, et l'on a choisi la seconde. Telle est la vérité, même quand on a le culot de célébrer l'affirmation de la personnalité humaine et sa « dignité », la liberté de pensée, l'« infinité » de l'esprit.
Du reste, ce choix électif et révélateur est bien visible même sous les formes les plus triviales de l'idéologie révolutionnaire. Admettons un instant que les hiérarchies traditionnelles aient vraiment eu le caractère supposé par cette idéologie ; admettons qu'elles n'aient pas reposé sur une autorité naturelle ni sur la libre reconnaissance de celle-ci mais exclusivement sur la force ; admettons enfin que, dans le « sombre Moyen Âge » par exemple, l'homme et la pensée humaine aient souffert dans les chaînes de l'oppression politique et spirituelle. Mais dans la personne de
qui souffrirent-ils ? Certainement pas dans la peau des despotes présumés, de ceux qui administraient le dogme et, en général, de ceux qui, selon la parole d'Aristote, dictaient la loi mais n'étaient pas eux-mêmes soumis à la loi. Ceux-là étaient des êtres libres. Ainsi, même sur ce plan, on voit quel est le sens caché des « nobles idéaux » libertaires et des affinités électives qui s'y rapportent : c'est l'identification instinctive non avec ce qui est en haut mais avec ce qui est en bas, c'est l'aspiration non à la liberté du Maître mais à celle de l'esclave affranchi (en admettant qu'on puisse parler d'« esclaves » au sens péjoratif et faussé d'aujourd'hui pour l'époque en question). Quand bien même il faudrait accepter une telle image matérialiste, unilatérale et pour une large part imaginaire des sociétés hiérarchiques, le fond plébéien du prométhéisme social, la « qualité » de ses affinités électives, la « race de l'esprit » qui s'y trahit, sont immédiatement reconnaissables.
En dernière analyse, les choses ne changent guère, si l'on passe au domaine culturel, où l'humanisme et le prométhéisme ont célébré l'émancipation de la pensée, glorifié l'esprit qui « a brisé toute chaîne pour devenir conscient de son incoercible liberté » à travers le rationalisme, l'humanisme et le progressisme, avec éventuellement à l'horizon la « vision tragique de la vie » et le mythe du Prométhée artisan, avec le mirage des « conquêtes de la pensée », notamment de la pensée qui invente, construit, découvre, de la pensée appliquée propre à l'antique Titan, ingénieux et inquiet.
C'est là tout un mouvement qui, partant du bas, a mené au déclin ou à la destruction de ce qui en Occident, dans son histoire et sa civilisation, pouvait encore appartenir au pôle opposé, apollinien et aristocratique, de l'esprit, c'est-à-dire à la souveraineté des hommes qui regardent ce qui est humain avec distance, des hommes qui ont pour idéal la « civilisation de l'être » (cf. chapitre I), des hommes qui, dans leur vie et leur action, témoignent du supra-monde et de sa calme puissance qui ignore le tragique.
L'involution s'accélérant, l'« humanisme » devait parcourir la voie qui conduit, pour reprendre les symboles rappelés plus haut, de Prométhée à Épiméthée. Le monde moderne d'aujourd'hui ne connaît pas le Prométhée délivré au sens positif, le Prométhée libéré grâce à Héraklès (celui-ci, pour les Anciens, désigna l'homme véritable, le héros qui a fait l'autre choix, qui a décidé d'être un allié des forces olympiennes). Il ne connaît que le Prométhée auquel on a enlevé ses chaînes et qui a été laissé libre de suivre sa voie pour se glorifier de sa misère et de la tragédie d'une existence purement humaine — ou, mieux, de l'existence considérée d'un regard purement humain —, pour en arriver enfin au point où, dégoûté de cette sorte d'auto-sadisme qu'est sa « grandeur tragique », il se précipite dans l'existence stupide de l'humanité « épiméthéenne ». Une existence qui se déroule au milieu du splendide et titanesque spectacle de toutes les conquêtes humaines de ces derniers temps, mais qui ne se consacre plus qu'au travail des bêtes de somme et à l'économie devenue obsessionnelle. La formule employée par une idéologie bien connue, c'est précisément l'« humanisme intégral » compris comme « humanisme du travail » et « sens de l'histoire ». Aucun doute n'est possible : le cycle se ferme.
Julius Evola, L'Arc et la Massue, Chapitre 10
3 notes
·
View notes
Photo


(via 1816 : L’Année sans été – Cataclysme climatique, réveil de l’occulte et sources d’inspiration pour les créateurs)
L'Année sans été offre un cadre unique pour aborder des récits où les personnages marginalisés – qu’ils soient femmes, personnes LGBTQIA+, ou figures spirituelles – jouent un rôle central, souvent en défiant les attentes de leur société ou en trouvant leur force dans la solidarité.
Voici quelques amorces de scénarios qui pourraient enrichir vos parties :
Le Cercle de la Lumière Cachée
Une petite communauté de femmes guérisseuses et de figures marginalisées se forme discrètement pour survivre à l’hiver qui ne finit pas. Ce cercle cache bien des secrets, car il s’agit d’un groupe où des femmes qui aiment d'autres femmes et des personnes trans cherchent refuge. Ensemble, elles doivent utiliser leurs talents – qu’il s’agisse d’herboristerie, de magie ancienne, ou de rituels de protection – pour préserver leur village des forces obscures. Mais un prêtre itinérant commence à les suspecter de sorcellerie, et les joueurs devront décider jusqu’où ils sont prêts à aller pour protéger leur secret et leur communauté.
L’Auberge de l’Espoir Caché
Une auberge isolée, perdue dans les montagnes suisses, devient un point de rencontre pour les voyageurs pris au piège par le froid. Parmi eux, un jeune poète androgyne en fuite, accusé à tort de blasphème, et une aventurière au passé mystérieux qui prétend être un homme pour parcourir le monde en toute sécurité. Alors que d’étranges événements se produisent autour de l’auberge, les joueurs devront découvrir comment ces âmes perdues peuvent s’unir pour repousser des créatures qui semblent se nourrir de la peur et des préjugés.
Les Érudites de l’Ombre
À Genève, un cercle d’intellectuelles – composé de femmes qui ne peuvent publier leurs travaux sous leur propre nom et de jeunes hommes désireux d’explorer leur identité de genre dans une société étouffante – se réunit en secret pour discuter de philosophie et d’alchimie. Mais lorsque l’une des membres commence à avoir des visions prophétiques, qui semblent liées aux ténèbres qui enveloppent le monde, les joueurs sont entraînés dans une enquête qui les mène jusqu’aux bibliothèques interdites et aux rituels oubliés. Un équilibre doit être trouvé entre la quête de savoir et la préservation des identités de chacun.
L’Amour Maudit d’un Été Perdu
Une romance naissante entre deux personnages féminins (ou entre deux personnages de même genre) se développe en pleine Année sans été. Mais cette histoire d’amour est hantée par des ombres, littéralement : des entités qui semblent se nourrir de la culpabilité et des peurs qu’impose la société patriarcale. Les joueurs doivent aider les amoureuses à braver les préjugés de l’époque, tout en cherchant un moyen de bannir les spectres qui les poursuivent et qui symbolisent les jugements de leur entourage.
Le Gardien du Jardin des Cendres
Dans une campagne reculée, un domaine autrefois prospère est maintenant couvert de cendres et de plantes mortes. Le gardien du domaine, un ancien soldat trans qui a trouvé dans cet endroit un refuge loin des attentes de la société, fait appel aux joueurs pour comprendre pourquoi les terres dépérissent de manière si étrange. Le mystère s’épaissit quand il s’avère que le sol cache des reliques d’un ancien culte dédié à une divinité oubliée, et que les personnages doivent choisir entre réveiller les forces qui y sommeillent ou laisser le domaine mourir à jamais.
3 notes
·
View notes
Text
Un de mes plus grands regrets : avoir cru que l’intellectualisation pouvait mener au bonheur, alors qu’elle n’était qu’une chimère de plus qui n’a fait que souiller tout ce que j’avais de plus spontané en moi. J’ai commencé à penser et à m’intéresser à la philosophie car je n’arrivais pas à jouir dans le monde. Ça a été le monde de la pensée comme ça aurait pu être celui de la drogue, ou tout autre chose. Mais l’effet qu’a eu cette quête spirituelle a été dévastateur sur de nombreux plans. J’ai perdu ma spontanéité, une certaine naïveté émotive, c’est-à-dire une certaine capacité à ressentir les émotions de façon totale, j’ai perdu la foi en l’avenir, mes rêves, mes illusions j’entends (et mon dieu il en faut pour supporter cette vie !) ; je suis devenu multiple car incertain, j’ai perdu une certaine unité de ma personnalité, une certaine simplicité. J’ai tout de même bien conscience que tous les mauvaises conséquences que l’intellectualisation a eu sur moi-même n’ont fait que révéler des prédispositions de mon caractère. Je repense à mon père et compare ma vie à la sienne. Il n’a jamais connu l’intellectualisation comme je l’ai connu, et il a gardé jusqu’à la fin de sa vie cette sorte de naïveté qui fait tout le charme d’une personne, dans le sens où il croyait véritablement à ce qu’il était. J’imagine qu’il y a sûrement des intellectuels qui ont gardé toute leur superbe, sûrement il doit y en avoir. Mais je juge néfaste la mise à distance des choses avec soi. Mon père me semblait véritablement connecté avec ce qu’il faisait. Il y croyait, il y projetait une valeur, une importance. J’ai complètement perdu cela ou presque. Et pourtant, je pense garder une certaine beauté, car la noblesse du cœur est une forteresse que la raison n’atteint pas, bien heureusement. Et cela fait mon charme, je le crois. Mais, je veux dire, que tout ce qu’il y a de beau en moi vient précisément de ce que j’étais naturellement avant toute intellectualisation. L’intellectualisation ne m’a absolument rien apporté, tout au plus une sagesse que j’aurais de toute façon probablement acquise par l’expérience de la vie. Non, vraiment, la philosophie ne m’a rien apporté. L’expérience de la vie, oui. Tout ce qu’il faut avoir, c’est l’intelligence, le bon sens, la sagesse ne doit se borner qu’à cela. Qu’aille au diable tout le reste.
20 notes
·
View notes
Text
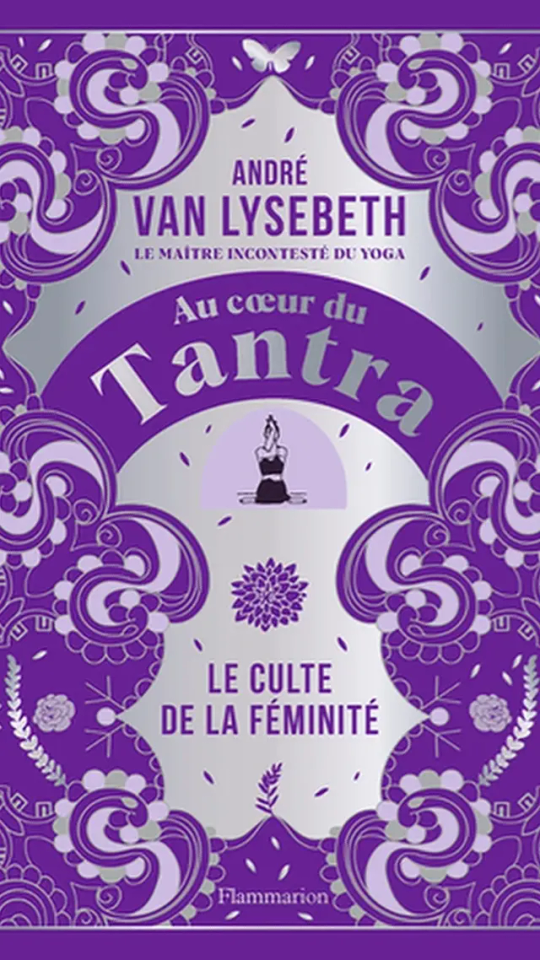
Au cœur du Tantra : Le culte de la féminité d'André Van Lysebeth est une œuvre qui explore les profondeurs du tantrisme, une philosophie ancienne qui vise à éveiller et à déployer les énergies cachées dans le corps humain. Van Lysebeth, reconnu comme un maître du yoga, présente le corps non seulement comme une machine biologique mais comme un instrument divin de manifestation.
Le livre aborde la sexualité sous un angle sacré, la décrivant comme une méditation à deux qui permet d'atteindre une union cosmique. Cette union transcende les individualités pour fusionner les énergies masculines et féminines sans domination d'un sexe sur l'autre. Le tantra est ainsi présenté comme une voie vers une élévation spirituelle et une communion profonde entre les partenaires
Une facette importante du tantra, que Van Lysebeth développe, est l'idée que l'univers est conscient. Selon cette perspective, chaque acte sexuel est vu comme une reproduction de l'union des principes cosmiques Shakti et Shiva, les énergies féminines et masculines fondamentales de l'univers. Ce culte de la féminité et de la sexualité sacrée vise à spiritualiser le sexe et à diviniser les partenaires, permettant ainsi une connexion profonde avec le cosmos.
Les critiques louent la capacité de Van Lysebeth à démystifier le tantra et à démontrer l'importance des valeurs féminines telles que l'amour et l'émotion contrôlée. Le livre encourage chacun à embrasser sa part de féminité, restructurant ainsi sa vie autour de ces valeurs spirituelles
En somme, "Au cœur du Tantra" est une exploration enrichissante et spirituelle de la sexualité et des énergies humaines. Il offre une perspective profonde sur le développement personnel, la reconnexion avec l'univers conscient, et la communion entre partenaires pour atteindre une union cosmique.
Belle découverte à tous 🙏
3 notes
·
View notes
Text
Baudelaire : « L’homme civilisé invente la philosophie du progrès pour se consoler de son abdication et de sa déchéance… nous périrons par où nous avons cru vivre. La mécanique nous aura tellement américanisés, le progrès aura si bien atrophié en nous toute la partie spirituelle, que rien parmi les rêveries sanguinaires, sacrilèges, ou antinaturelles des utopistes ne pourra être comparé à ses résultats positifs. »
2 notes
·
View notes
Text
“VEUILLE QUE LES CHOSES ARRIVENT COMME ELLES ARRIVENT ET TU SERAS HEUREUX” (EPICTÈTE)
La citation d’Epictète, “Ne demande pas que ce qui arrive arrive comme tu veux. Veuille que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux”, se trouve au paragraphe VIII du Manuel et exprime un principe clé de la philosophie stoïcienne qui porte sur le bonheur et la tranquillité de l’âme obtenue grâce à l’ascèse.
ASCÈSE:
Effort visant à la perfection spirituelle par une discipline constante de vie. Manière de vivre de quelqu'un qui s'impose certaines privations.
Pour Epictète, le bonheur réside dans notre capacité à accepter les choses telles qu’elles se présentent, sans résistance ni attachement excessif à nos désirs ou attentes. Il suggère que la source de notre malheur réside souvent dans notre lutte contre les réalités inévitables de la vie et dans notre insatisfaction face à ce qui se produit alors même que le destin est tout à fait hors de nos prises et qu’il ne dépend pas de nous.
Ce qui dépend de nous, c’est à dire de notre faculté raisonnable libre (la prohairesis), c’est de cultiver une attitude de détachement par rapport aux circonstances extérieures. Plutôt que de s’accrocher à des attentes rigides ou de résister aux événements qui échappent à notre contrôle, Epictète invite à adopter une disposition mentale qui favorise l’acceptation et l’adaptation.
Cela ne signifie pas que nous devrions être passifs ou indifférents face aux événements, mais plutôt que nous devrions être capables d’accepter avec sérénité les situations que nous ne pouvons pas changer. Epictète soutient que notre bonheur dépend en grande partie de notre capacité à maîtriser nos pensées, nos jugements et nos émotions, plutôt que d’être déterminé par des circonstances extérieures sur lesquelles nous n’avons aucun contrôle. Bien souvent, ce ne sont pas les choses qui arrivent qui troublent la tranquillité de notre âme mais seulement les jugements que l’on porte sur ces choses.

2 notes
·
View notes
Text

« Quiconque aura assez longtemps observé la nature humaine pourra dégager trois principaux types d'êtres, auxquels correspondent trois attitudes face à ce qui élève, et que par une heureuse image oxymoronique, nous appelons profondeur.
L'homme médiocre, essentiellement préoccupés par la satisfaction de ses besoins et l'épanchement de ses bas instincts, est totalement étranger à cette profondeur. Sa vie passera comme un éclair sans même qu'il en ait pressenti l'existence, ce qui fait de lui, peut-être pas le fossoyeur de la civilisation, mais un obstacle certain à l'évolution spirituelle de l'espèce. Comptons sur lui pour répandre ses lignées innombrables sur la planète; il est le nombre, et fait le nombre. Croître dans la matière et ignorer l'esprit, c'est là sa gloire et notre punition, sa vanité et notre malédiction.
L'homme moyen, lui, bien qu'il ait conscience de la possibilité d’une vie plus riche, fuit la profondeur les rares fois où il la sent poindre en lui; les abysses l'effraient car elles lui imposent un silence que sa vulgarité confond avec la mort. Sa vulgarité, c'est sa mauvaise vue, d'esprit j'entends, son incapacité à voir quelles fleurs sublimes peuvent éclore sur le sol pur d'une âme abreuvée de discipline. Sub umbra floreo, formule sacrée du dernier type de notre hiérarchie, est précisément tout ce qu'il échoue à répéter dans le réel.
Car pour l'homme supérieur, fleurir à l'ombre n'est pas une nébuleuse expression poétique, vaguement mystique, mais bien une expérience de chaque jour, sans cesse renouvelée afin que s'accomplissent en lui les promesses de son âme. Il vivra à la marge, zone franche qui, à l’ère des masses, semble être le seul terrain stable où l’on puisse bâtir sa tour d’ivoire.
Ainsi arrive toujours une période de sa vie, plus ou moins précocement, où il ne peut faire autrement que vivre dans cette profondeur; c'est là le milieu naturel de son âme, nécessaire, indispensable, paradisiaque même, quand il réussit à tirer de cette profondeur une philosophie où la vie, bien que toujours problématique, est pleinement acceptée, pardonnée de son absurdité par la beauté de son mystère. »
Ariya S.
13 notes
·
View notes
Text
Qu’est-ce que la spiritualité ? Que signifie être une personne spirituelle ? Qu'est-ce que la spiritualité dans la consommation ?
What’s spirituality, what does it means to be a spiritual person? What is spirituality in consumption, its meanings, its manifestations and what are the consumer expectations?
« Connais-toi toi-même et tu connaîtras l’univers et les Dieux »
L’intérêt pour la spiritualité semble trouver ses fondations dans une recherche de sens, cette recherche de sens est amplifiée par les nombreuses préoccupations environnementales qui pèsent sur nos sociétés à moyen et long terme.
La spiritualité semble trouver ses bases dans le religieux, donc dans la croyance. En philosophie, le mot "spiritualité" désigne la qualité de ce qui est esprit, de ce qui est dégagé de toute matérialité. La spiritualité est aussi la qualité de ce qui est spirituel, immatériel.
The interest in spirituality seems to find its foundations in a search for meaning, this search for meaning is amplified by the many environmental concerns that weigh on our societies in the medium and long term. Spirituality seems to naturally find its bases in the religious, therefore in the belief. In philosophy, the word "spirituality" refers to the quality of what is spirit, of what is free from all materiality. Spirituality is also the quality of what is spiritual, immaterial. The spiritual experience consists in a conversion, a reversal towards a reflexive interiority.
The spiritual reality of the human being asserts itself at various levels: metaphysical, aesthetic, and ethical. Spiritual experience is not merely affective, it is both lived and reflected. It is always related to questions of Fundamental wisdom. Everything is interconnected and connected. Religion is a collective organization, the sacred is a state outside oneself.
Spirituality is an individual process based on experience. Spirituality enables and transcends connections between people. It thus brings inner peace and well-being producing a positive impact on health.
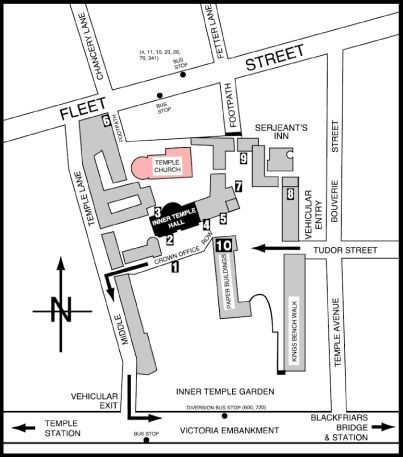
L’expérience spirituelle consiste en une conversion, c'est-à-dire un retournement vers une intériorité réflexive. La réalité spirituelle de l’être humain s’affirme à divers niveaux : métaphysique, esthétique et éthique.
L'expérience spirituelle n'est pas simplement affective, elle est à la fois vécue et réfléchie. Elle est toujours en rapport avec les questions de sagesse fondamentale. Les modalités de l'expérience spirituelle sont diverses, et multiples sont les voies qui y conduisent.
L'expérience spirituelle est aussi un besoin de compréhension et d'ouverture, la recherche d'un sens à donner à chaque existence personnelle pour dépasser les limites d'une vie précaire et superficielle afin de connaître un bonheur, une illumination intérieure, un salut.

La religion est une organisation collective. Le sacré est un état hors de soi. La spiritualité est un processus individuel fondé sur l’expérience.
La spiritualité permet et transcende les connexions entre les personnes. Elle apporte ainsi paix et bien-être intérieurs produisant un impact positif sur la santé.
"Personne n’est une île mais nous sommes tous une partie d’un continent de l’humanité."
La personne spirituelle est confiante dans le fait que la vie est remplie de sens et de sacré et que chacun d’entre nous a ce sens dans son existence. La personne spirituelle est capable de tout sacraliser dans la vie, toujours dans une perspective holiste.
"Modern man composes his own menu: a touch of Buddhism, a hint of esotericism and a reference to Jesus to bind the sauce".
The spiritual person is confident that life is filled with meaning and that each of us has that meaning in our existence. The spiritual person is convinced that his life has meaning.
The spiritual person thinks that life is filled with sacredness. The spiritual person is capable of sanctifying everything in life, always from a holistic perspective.
According to Aurobindo "The destiny of our planet rests neither on the denial of the spirit nor on the denial of materialism, but on a synthesis of spirit and matter that must lead us to a spiritualization of the material life of man. On a planetary level, nations, groups and institutions that represent, or manifest great spiritual power must work with their counterparts who represent great material power."
La spiritualité est une quête intérieure universelle en lien avec le besoin de transcendance des individus . La spiritualité dans un cadre professionnel se manifeste par l’investissement dans le travail d’équipe, la contribution envers tous et le sentiment d’appartenance à un tout.
Enseigner la spiritualité signifie aider les étudiants à opérer un travail d’auto-éclaircissement concernant leurs valeurs personnelles les plus profondes, réfléchir à la notion de transcendance et trouver les chemins qu’ils pourraient prendre pour gagner plus en sens. La spiritualité est un processus individuel qui vise à une recherche de transformation de soi dans une perspective immanente ou transcendante et dont le mode opératoire est fondé sur l’expérience.
Selon Aurobindo « la destinée de notre planète ne repose ni sur le déni de l’esprit, ni sur le déni du matérialisme mais sur une synthèse de l’esprit et de la matière qui doit nous conduire à une spiritualisation de la vie matérielle de l’homme Sur un plan planétaire Les nations, les groupes et les institutions qui représentent ou manifestent un grand pouvoir spirituel, doivent travailler avec leurs homologues qui représentent un grand pouvoir matériel ».
Le domaine motivationnel « spiritualité » est alimenté par sept valeurs : harmonie personnelle, vie spirituelle, un sens à la vie, détachement, harmonie avec la nature, accepter son sort dans la vie, être pieux.
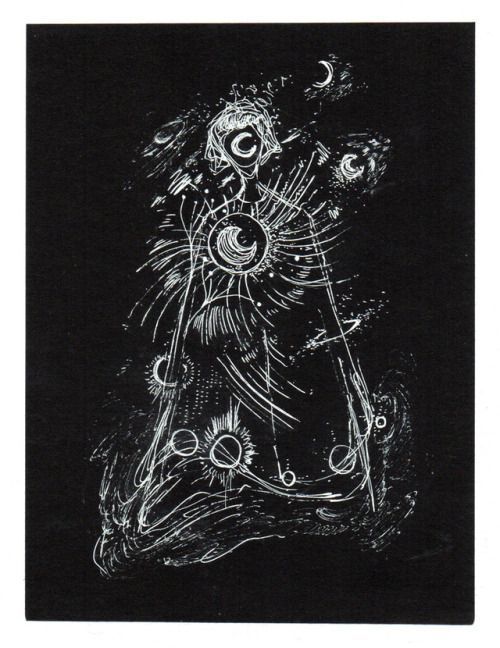
"No one is an island, but we are all part of a continent of humanity."
Teaching spirituality means helping students to self-enlighten their deepest personal values, reflecting on the notion of transcendence, and finding ways they could confidently take to gain more "meaning." Spirituality is an individual process that aims at a search for self-transformation in an immanent or transcendent perspective and whose modus operandi is based on experience.
The motivational domain "spirituality" is nourished by seven values: personal harmony, spiritual life, a meaning to life, detachment, harmony with nature, accepting one's fate in life, being pious. Spirituality is what makes it possible to commune with the other, the other being taken in the broad sense of humanity.
Shamanism is a spirituality centered on the mediation between human beings and the spirits of the supernature. Neo shamanism corresponds to a movement of rediscovery of ancestral shamanic traditions and also proposes to develop communication with spirits and healing therapies.

La spiritualité est ce qui permet de communier avec l’autre, l’autre étant pris au sens large de l’humanité.
Le chamanisme ou shamanisme par exemple est une spiritualité centrée sur la médiation entre les êtres humains et les esprits de la surnature. Le néochamanisme quant à lui correspond à un mouvement de redécouverte des traditions chamaniques ancestrales et propose aussi de développer une communication avec les esprits et des thérapies de guérison.
La spiritualité est à la fois caractérisée par la foi, l’extase, le sacré et la magie et aussi comme une expérience par laquelle l’individu se transforme lui-même. La spiritualité est ce qui nous permet de communier avec l’autre, l’autre étant pris dans son acceptation universelle.
La spiritualité est un processus individuel qui vise à une recherche de transformation de soi et dont le mode opératoire est fondé sur l’expérience. La spiritualité d’une expérience de consommation est une action de transformation de soi, dans un cadre marchand, motivée par une recherche de sens et de sagesse dans une perspective immanente ou transcendante. La spiritualité d’une expérience de consommation a une influence sur le développement personnel.
L’expérience spirituelle est recherchée pour deux finalités fondamentales : accéder à un état de bien-être et retrouver son soi intérieur. Elle se manifeste aussi par une recherche de bien-être et d’apaisement vis-à-vis de soi. Le bien-être est la première étape du développement personnel.
Vivre une expérience spirituelle peut être déclenché par des objets, lieux et individus spécifiques. Toutes les situations qui favorisent le repli et l’introspection ou au contraire la communion avec l’autre sont porteuses de spiritualité.
L’expérience spirituelle c’est ressentir un lien avec ce qui nous entoure avec un sentiment de connexion quasi physique, sentiment d’un lâcher prise global intérieur, et une sensation de former un tout avec l’environnement. La spiritualité passe aussi par la relation sincère avec les autres, la communication, par la connaissance et le savoir.
Ainsi la spiritualité peut être associée à des notions aussi diverses que : l’harmonie, la conscience de l’existence de l’âme ou de l’esprit, la connexion avec une altérité, l’introspection, le détachement, la recherche de sens, la recherche de transcendance
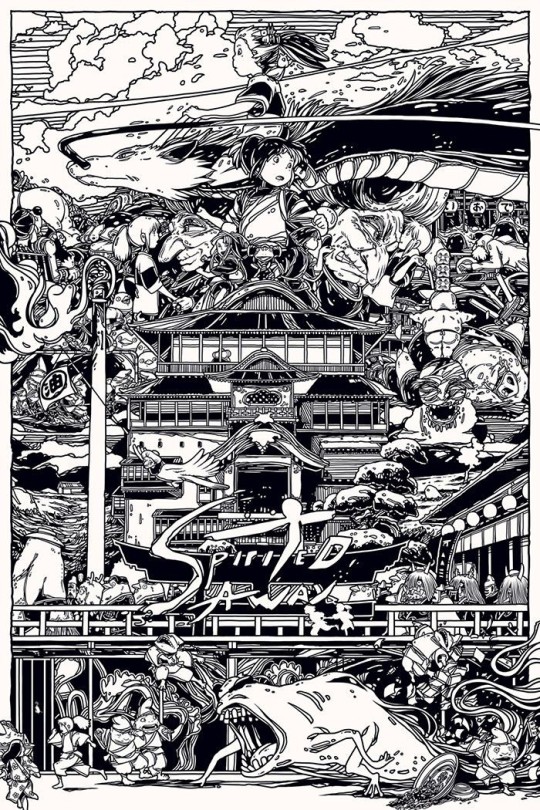
Having a spiritual experience can be triggered by specific objects, places, and individuals. All situations that promote withdrawal and introspection or, on the contrary, communion with the other are carriers of spirituality.
The spiritual experience is to feel a connection with what surrounds us with a feeling of almost physical connection, feeling of a global inner letting go, and a feeling of forming a whole with the environment.
Spirituality also involves sincere relationships with others, communication, and knowledge. Spirituality can be associated with notions as diverse as: harmony, awareness of the existence of the soul or spirit, connection with otherness, introspection, detachment, search for meaning, search for transcendence.
Spirituality is quietness, self-respect and a look that we have on ourselves by seeking to refocus. Spirituality is a return on oneself, it is trying to better understand one's behavior and reactions to external events. Spirituality is having a reading or appropriation of what is deep in life. Spirituality corresponds to a return on oneself but also to a search for elevation of the spirit and soul.
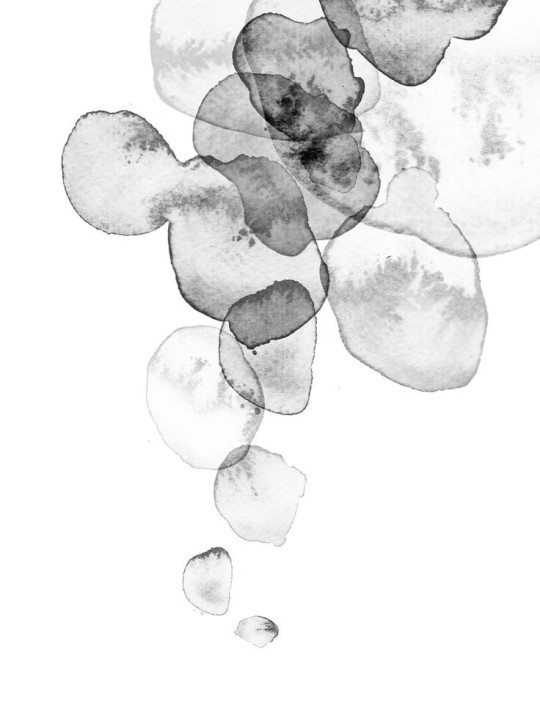
La spiritualité c’est du calme, du respect de soi et un regard que l’on porte sur soi en cherchant à se recentrer. C’est un retour sur soi, c’est essayer de mieux comprendre son comportement et ses réactions face aux événements extérieurs. La spiritualité c’est avoir une lecture ou une appropriation de ce qui est profond dans la vie.
La spiritualité correspond aussi à une recherche d’élévation de l’esprit et de l’âme. Une expérience spirituelle c’est le sentiment d’aller au-delà de sa simple condition d’humain, au-delà de son enveloppe charnelle, c’est aussi rechercher quelque chose qui nous élève au-dessus de notre condition d’humain, c’est arriver à être émerveillé d’être en vie et c’est ressentir des choses qui nous transcendent sans pour autant tout comprendre. L’expérience spirituelle ce sont aussi des moments de communion avec la nature.

A spiritual experience is the feeling of going beyond one's simple human condition, beyond one's carnal envelope, it is also looking for something that elevates us above our human condition, it is to be amazed to be alive and it is to feel things that transcend us without understanding everything.
Spiritual experience is also a moment of communion with nature. Spirituality is also expressed through the search for books that provoke reflection, books that will allow personal development but also through the purchase of products.
The fact that a spiritual experience leads to a desire to return to essential principles has a positive influence on the intention to relive the experience. The goal is to achieve a deep knowledge of oneself, beyond the psychological, beyond a simple awareness of the emotional states of the subject (...) hence the need to discover something or someone that allows the subject to go beyond his self; the desire for an encounter with the absolute that goes beyond subjective limits.
Thus, the well-conducted search for interiority leads to the awareness of what is other and which becomes the privileged framework of an inner openness. The well-conducted search for interiority leads to the awareness of what is other and which becomes the privileged framework of an inner openness.
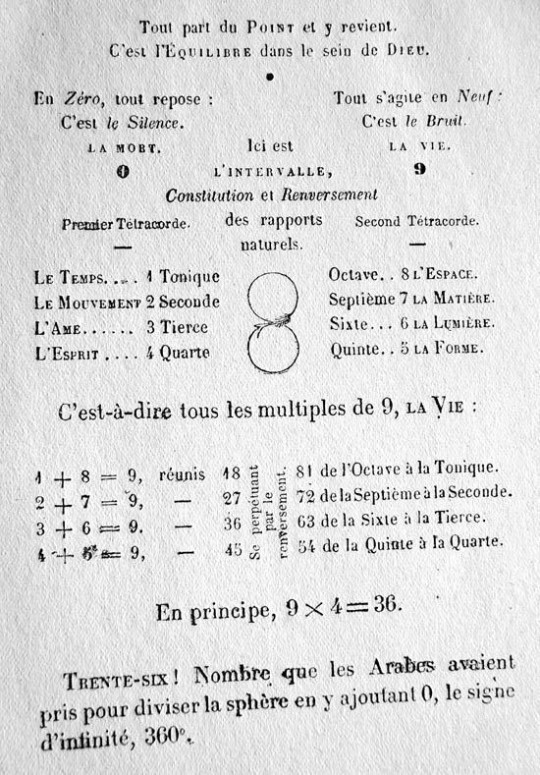
La spiritualité s’exprime aussi au travers de la recherche de livres qui suscitent de la réflexion, des livres qui vont permettre du développement personnel mais aussi au travers de l’achat de produits.
Le fait qu’une expérience spirituelle conduise à avoir envie de revenir à des principes essentiels a une influence positive sur l’intention de revivre l’expérience. Le but poursuivi est de parvenir à une connaissance de soi en profondeur, au-delà du psychologique, au-delà d'une simple conscience des états affectifs du sujet (...) d’où le besoin éprouvé de découvrir quelque chose ou quelqu'un qui permette au sujet de dépasser son soi ; le désir d'une rencontre avec l'absolu qui dépasse les limites subjectives.
Ainsi la recherche bien conduite de l'intériorité mène à la prise de conscience de ce qui est autre et qui devient le cadre privilégié d'une ouverture intérieure.
L'expérience spirituelle est aussi un besoin de compréhension et d'ouverture pour dépasser les limites d'une vie banale et superficielle afin de connaître un bonheur, une illumination intérieure, un salut tant sur le plan individuel que collectif, que la pression environnementale accélère fortement.
Fait par @themonsterp aka ©POM to cite et inspiré par la version de Max Poulain — Spiritualité dans la consommation. Gestion et management. Université de Caen, 2009.
#experience#spirituality#spiritualité#article#synthese#perso#harmony#esoterism#buddhism#jesus#sesnse#detachment#nature#alternative#esprit#instropection#reflection#knowledge#savoir#consomation#ancestral#planetary#humanity#metaphysical#aesthetic#ethical.#interconnected#connected#spiritual#decroissant
9 notes
·
View notes
Text
Que recherchons-nous à travers nos relations, rencontres et échanges ?
Quel est le sentiment que nous désirons ardemment éprouver, tout au long de notre vie ?
L’amour est évidemment la réponse à toutes ces questions.
L’amour est ainsi le principe et la source de toute vie, sans quoi rien ne pourrait exister ni subsister.
L’amour est la force qui fait tourner les mondes, l’énergie qui maintient la cohésion des atomes comme des planètes.
L’amour est au cœur des mystères que nous sommes venus appréhender et expérimenter sur cette Terre.
Chacun ressent et pressent, même confusément, que l’amour vrai est la clé et la solution de tous nos maux, individuels et surtout collectifs, économiques, politiques et sociaux.
Mais l’amour véritable n’est pas acquis d’emblée : il est à rechercher, ressentir, découvrir.
Il n’est ni instinct de possession, ni dépendance fusionnelle, ni suivisme grégaire, car il émane de soi.
Il est le résultat de l’alchimie intérieure, le fruit de la reconnexion à l’être essentiel et à la puissance de vie.
L’amour est la joie d’être, le signe d’une conscience éveillée et lumineuse, un présent accordé, offert et partagé.
L’amour est ce que nous sommes éternellement, en dépit de nos souffrances, illusions et désillusions et parfois grâce à elles ; il est notre état naturel, notre aspiration à une vie riche, fascinante, magique, inattendue, utile et initiatique.
L’amour est partout, omniprésent et protéiforme ; il se pare de toutes les couleurs et de toutes les fréquences, et se manifeste de multiples manières : amour du compagnon ou de la compagne, des amis, des enfants, des animaux, de la nature, de la beauté, des œuvres de l’esprit…
Mais c’est la relation amoureuse qui se révèle son territoire de prédilection, car alors le sentiment se mêle au désir, à la sensualité et à l’attraction des corps, lieu de toutes les convoitises, de tous les délires et de toutes les extases.
Ce que l’on nomme amour est rarement digne de ce nom : l’amour qui blesse et qui déchire, qui conquiert et qui rompt, qui domine et qui soumet, qui idolâtre et qui méprise, n’est qu’une caricature égotique, une maladie infantile du cœur, un balbutiement du sentiment.
L’amour qui prend fin n’a jamais existé ; l’amour qui se meut en haine ou indifférence, n’était qu’illusion, transfert, projection, malentendu.
Les relations évoluent et donnent souvent lieu à séparation, éloignement, divergence. Mais comment peut-on rejeter, nier ou diaboliser l’être que l’on a tenu tendrement dans ses bras, si ce n’est précisément à cause de la douleur créée par son absence ?
L’amour véritable est patient, sincère, honnête et compréhensif ; il se nomme bienveillance, bonté, compassion, douceur, tendresse, sollicitude ou empathie.
De la nature de l’amitié, il dure la vie entière, car il n’est pas fondé sur l’image ou les apparences, mais sur les liens invisibles et mystérieux qui unissent les âmes et les cœurs.
Aussi le chemin de l’amour, que tous nous empruntons à notre manière, est-il un apprentissage, qui mène de l’égoïsme à l’altruisme, de l’aveuglement à la connaissance, de la consommation au partage, de la prédation au don.
L’amour est éternel car il est spirituel ; il est la joie libre du cœur qui s’est ouvert ; il ne sait que grandir, fleurir et embellir.
L’amour est si puissant qu’il se joue des barrières, frontières, critères, normes et interdits.
Car l’amour est libre et il souffle où il veut ; il ne peut être contraint, obligé ou mis en cage ; l’autre ne nous appartient pas et l’emprisonner, ce n’est pas l’aimer.
L’amour ne donne ni droits, ni devoirs ; il est une extraordinaire opportunité de vivre des moments merveilleux et magiques, une chance à ne surtout pas laisser passer.
Et si l’amour était sagesse, philosophie éminemment subtile, art et science oubliés, à retrouver, découvrir, réinventer ?
L’amour est un défi. Saurons-nous y répondre ?
LA SAGESSE AMOUREUSE
Yann Thibaud
Extrait de «L'Alchimie émotionnelle ou la métamorphose du coeur»

18 notes
·
View notes
Text
L’atheisme qu’est ce que c’est?
L’atheisme n’est pas le fait de croire que Dieu ou les dieu n’existe pas ou renier son idée...l’atheisme est un systeme spirituel qui se nourrit d’autre conceptes, ceux-ci ne sont pas ceux vehiculé par les société ecclesiastique voila tout...il va surtout creer des batterie de test pour voire si la pensee de son interlocuteur est coherente avec ce qui lui semble essentiel...cad la realite...en verite pour un athee la realite est la divinite eg la connexion universel de tout lui semble etre l’harmonie il est donc univesialiste...
« La nature n’a fait ni esclave no maitre, je ne donne et ne reçois de loi de personne »
-DIDEROT-
L’atheisme pour exister tire ses valeurs de plusierurs systemes philosphique qui fonctionnent ensemble et qui sont indispensable
1-l’ATHEISME est NATURALISTE
L’homme ne nait pas homme il le devient, cad que l’homme soumis a ses emotion est livré a ses dernieres, l’exercice de la raison le libere en le rendant maitre de lui meme, cette exercice passe par des pratique intellectuels sportives et philosophique varie eg qui fonctinnent ensemble. (Pour exempe la META-BIBLE de diderot est l’encyclopedie donc une BIBLe des technique humaine et artisanales. De plus aucun sysysteme n’est plus coherent que la nature pour
creer des valeurs morale, en effet la nature est e systeme qui existe depuis le plus longhtemps et son but esg de se maintenir lui meme par une organisation coherente de ses differents ecosystemes.
Diderot d’ira que l’art nest pas la recherche du vraie mais du vraisemblant, une copie metonimique ou parabolique de la nature dans son organisation.
2-l’ATHEISME Est TRANSTHEISTe
L’idee de dieu existe...seulement dieu est partit intégrante de la realite et de la nature il ne peut pas etre un sujet mais il est vecu par l’experience DIEU est LE REEl...la theologie e est donc initile pour cee des valeurs fiable...seul observer la nature et dialoguer le permet. De plus l’idee de Die est depassable par l’homme.
L’homme peut dépasser sa nature premiere animal pour devenir un animal coherent a son environnement et afin d’eviter toute derive son evolution psychologique se fait par l’eturr de son environement...l’homme devient donc un Dieu de respect de son environnement...mais il n’est le Dieu que de son contexte par exemple des peuple habitant dans les montagnes n’ont pas la meme psychologie que ceux habitant pret de la met car leur en ironnement est different...de plus l’homme n’est le dieu que pour son temps...
3-L’ATHEISME est PANTHEISTE
Le pantheisme reprend l’idee du culte des ancetre..notre destin est dans notre biologie esg la volonte de nos ancetre resonne dans nore adn...nous cherchons a prolonger nos ancetre dans nos relations et le corp est le super d’ecroture de ce destin. (Panthon demeure des Dieux) a paris rousseau diderot montesquieu voltaire victor hugo est... sont au pantheon...ceux sont les vraie Dieux de la notre pays la france...
4-l’ATHEISMe est MATERIALISTe
Aucune distinction entre le corp l’ame est lesprit la matiere est spirituel tout est un et ce un est multiple...ce que je ressent est connecte a l’univers lui meme connese a tout et ce sue je reseent est coherent ma nature biologique me parle et elle connais mon avenir e bien etre moral et physiologique et psychologique est la maniere de rechercher le bonheur du monde et le notre aussi...
5-en somme l’ATHEISME se rapproche beaucoup du bouddhisme et cela ne m’aurais pas ettoné que les philosophe des lumiere auraient tout simplement calqué leur systeme de pensée surcelui fe confucius et bouddha si ils avait put voyager dans les pays asiatique inspiré par cette #PHILOSOPHIE AUGMENTE ou BIOPSYCHOLOGIE (philosophie spirituel dont les concepte ont un impacte spiriuel sur la societé et son organisation) les philosophes des lumiere sont a l’origine du sysyteme social français pas exemple...aussi de la revolutilon...
Pour en savoir plus regarer les musique et les clip...
Info:
DIEU: antité uniquement bonne dans les monotheisme...
DEMONS: antite uniquement mauvais dans le monotheisme
DEMIURGE/DIVINITE: antite bonne est maivaise (personnalité) ayant ses propre interet a aider les hommes ou non...souvent teritorialisé et n’exerçant un pojvoir que dans un environnemt naturel psychologique ou climatique...(n’existe que dans le polytheimse)
BOUDDHA est vide...il ne possede aucune supstance KARMITE (karma) il fait des actes totalement desinterrese ni bon ni mauvais...
Le monde naturel est le SAMSARA et le monde spirituel (sans matiere) est le NIRVANA
Le Bouddhisme et le jainisme sont basé sur l’etude des autre religions...comme l’atheisme...
#pantheisme
#spinoza
#diderot
#rousseau
#montesquieu
#voltaire
#philosophie
#philosophe
#pantheon
#olympe #poseidon
#transtheisme
#atheisme
#spiritualité
#philosophieaugmenté
#biopsychologie
#psychologie
#psychobiologie
#musique
#bouddha
#bouddhisme
#ado
#madara
#ganonjo
#france #paris
#lyon
#bordeaux
#Dieu
V.A.D.O
L’atheisme qu’est ce que c’est?
« La nature n’a fait ni esclave no maitre, je ne donne et ne reçois de loi de personne »
-DIDEROT-
L’atheisme pour exister tire ses valeurs de plusierurs systemes philosphique qui fonctionnent ensemble et qui sont indispensable
1-l’ATHEISME est NATURALISTE
L’homme ne nait pas homme il le devient.
2-l’ATHEISME Est TRANSTHEISTe
L’idee de dieu existe...seulement dieu est partit intégrante de la realite et de la nature il ne peut pas etre un sujet.
3-L’ATHEISME est PANTHEISTE
Le pantheisme reprend l’idee du culte des ancetre..notre destin est dans notre biologie esg la volonte de nos ancetre resonne dans nore adn...
4-l’ATHEISMe est MATERIALISTey
Aucune distinction entre le corp l’ame est lesprit la matiere est spirituel tout est un et ce un est multiple...
5-en somme l’ATHEISME se rapproche beaucoup du bouddhisme.
Il ne faut surtout pas confondre (comme cela a toujours etait fait) l’atheisme et la technocratie voir religion trechnocrate...en effet l’e ercice de la raison ne conduit pas a la technique elle conduit a l’etude cad tout les corps de metier qui finissent en logue (sociologue psychologue etc...). Et visent justement a pacifier l’esprit et trouver un equilibre de vie sur la terre.., la tech’ocratie c’esg l’apogee du GUN qui est l’outil de la toute puissance technocrate aujourdhui le GUN est devenue l’algorythme. Et la guerre de la data science.
Un athee peu aller dans une mosque le vendredi une eglise le dimanche pu autre simplement pour comprendre sans se sentir redevable de quoi que ce soit...
2 notes
·
View notes
Text

(Il y a deux ans jour pour jour)
Combats philosophiques, philosophie du combat
Et si le véritable lieu du combat etait l’ordre symbolique? N’est-ce pas là que se déroulent de toute éternité les luttes entre une humanité toujours déjà effondrée et une humanité qui se tient encore debout, et qui combat pour conserver cette tenue, et la fortifier dans le combat?
Les combats spirituels de l'humanité européenne peuvent être abordés comme des combats entre "philosophies", et compte tenu de la définition psychanalytique de la perversion qui est celle du "déni de la dimension subjective à proprement parler", le véritable combat oppose:
• aux philosophies "perverses" qui font l'apologie de l'individu compris comme un être naturel, corporel, vivant, allant de soi, incarné dans un monde conçu comme le lieu "naturel" de son inscription, un "monde social" dans lequel il entretiendrait a priori des rapports avec d’autres…
• la philosophie authentique, celle de l'hystérique, qui fut inaugurée par Socrate, dont la caractéristique principale est de partir d'emblée d'un sujet travaillé intérieurement par son manque-à-être, un sujet divisé par la question de savoir ce qu'il est pour le désir de l'Autre, ce que l'Autre attend de lui, un sujet qui ne peut se concevoir que dans le retrait, une radicale extériorité par rapport à la prétendue "réalité objective" qui apparaît dès lors comme une contradictio in adjecto.
L'écart entre les deux conceptions "philosophiques" tient au statut de la "réalité": dans un cas, la réalité est donnée par avance: "il faut faire avec", alors que pour la philosophie authentique, qui prend son essor avec Socrate, la réalité est constituée par la manière dont le sujet se trouve toujours déjà lui-même pris dans un certain rapport à ladite "réalité", il en questionne donc les coordonnées…
Pour le psychanalyste, l'acte véritable, le seul acte digne de ce nom, est celui d'une suspension de la réalité constituée, donnée par avance. La théorie analytique rejoint ici l’acmé de la pensée de Hegel pour qui la réalité apparaît comme posée, constituée par le sujet, et non pas simplement quelque chose qui s'impose à lui de l'extérieur…
Ce que la pseudo-psychanalyse, la psychanalyse d’institutions, la psychanalyse "molle" qui ressortit du Discours Universitaire (psychologie) a perdu, c'est cette dimension cruciale d'une réalité posée par le sujet, la conduisant à différer du sens commun (du "discours scientifique"…) qui accepte la "réalité externe" comme un postulat donné par avance, une "objectivité", une "normalité" à quoi l'appareil psychique devrait se raccorder, se connecter, "s'adapter"...
Pour le psychanalyste authentique, il ne s'agit pas bien entendu de "faire changer la réalité", mais que le sujet puisse changer les coordonnées à partir desquelles se constitue, pour lui, ce qu'il appelle une "réalité".
En témoigne le cas de cet analysant inconsolable à qui fut posée la question: "si vous pouviez recréer exactement la même femme, votre femme qui est morte, seriez-vous capable aujourd'hui de l'aimer en lieu et place de votre femme?", la réponse fut décisive: "non, elle ne pourrait pas être la même!"
En énonçant ces mots, l'analysant mît un terme à son "état dépressif". Il avait réalisé que la place vide ne pouvait être remplie par aucun désir.
Il s'était tenu au bord de l'impossible, l'impossible de remonter le temps, l'impossible de retrouver le passé, l'impossible qui structure et conditionne l'ordre des possibles…
Réel est l’un des noms de cet impossible.
Entre nous et le Réel, il y a la vérité.
8 notes
·
View notes