Text
CHAINSAW-MAUDE-ÉLOÏSE BRAULT

tu règnes sur tout ce que tu as su prendre
ton trône est à quatre pattes sous ton corps diadème il éclaire tes jambes
jamais croisées
tes saisons incendient les âges que tu portes en augures
ton dos grand accueille les yeux
ils s’y perdent
tes mains font des avenirs conditionnels
les envies du dimanche y sont toujours haletantes
tu couves des tapage
tu en fais peau neuve
elle adhère pneus à clous sur la glace
tu es une envolée de cormorans qui résonne en chainsaw un feu de joie allumé au gaz un shot gun en canette
tu es une révolte née un soir de semaine
quand tu jouis tu accouches de ce que tu veux
0 notes
Text
FUCK ME, I’M NOBODY - LISE HAY

Quand ça va pas, j’ai envie d’une omelette aux cornichons. Maman nous en faisait souvent les dimanches. Une omelette aux cornichons et aux pleurs, servie après le bain.
Ces derniers temps j’ai envie d’une omelette chaque nuit.
Je ferais quoi moi, s’il avait tué ma mère devant moi ? Il a crevé sa mère, et ma pote E. ne peut plus rien faire à part servir des verres et des assiettes, débarrasser pour 6 € de l’heure, et quelques pourboires. Sauf qu’elle devait être styliste, normalement ça aurait dû se passer comme ça.
Y’a eu un couteau dans la chair. Il a monté les escaliers, il montait les marches une à une, fort, puissant. Et sa mère dans la cuisine, frêle, chez elle. Il est arrivé avec le sang à la bouche, la violence dans ses tempes. Il a d’abord tué la mère de E. Puis il a tenté de tuer E. Et il a tué la sœur de E. aussi, des mois après, quand elle s’est suicidée.
Je suis arrivée quelques jours après le meurtre. Le temps de pleurer, de prendre un train, tout ça... Je suis arrivée, y’avait plus de sang mais des journalistes dans le jardin. Et les bleus de ma pote E. sous son pull, sous son jean, je les ai vus quand on était en pyjama le soir.
dans ma tête il y a des hommes
Je vis comme s’il était normal qu’on m’appelle un jour de beau temps, qu’on me dise « Lise c’est grave, la mère de E. est morte, il l’a tuée, E. a tout vu» et que je ne sache plus comment on fait pour raccrocher. Je suis rentrée comme si j’avais passé un séjour de deux semaines avec mes amies, à rire, boire et danser. Boire, danser, fumer, on l’a beaucoup fait pendant deux semaines. Boire. Je nous revois complètement saoules, culottes et jambes en l’air, sous l’épaisse chaleur du goudron nantais. Je me revois ingurgitant, mais pas ivre. À veiller. Toujours veiller sur mes copines, ne sachant plus laquelle protéger, surveiller, retenant les prochaines gorgées, et puis les guidant dans les rues éclairées par le lever du jour.
dans ma tête il y a des hommes qui tuent
dans ma tête il y a des hommes qui créent des bleus
dans ma tête il y a des hommes qui
Elle avait des bleus partout parce que l’autre a voulu la tuer elle aussi et elle n’arrivait plus à marcher parce que sa mère était morte devant ses yeux. Elle s’est laissée tomber dans les escaliers à chaque étage pour survivre et après des mecs dans la rue l’ont sauvée. J’ai vu les bleus donc c’est vrai. Cette histoire est vraie. Depuis, je me demande comment on fait pour vivre dans ce monde de fous où les hommes tuent les femmes. Comment on fait pour vivre avec des bleus invisibles. Je crois que E. ne sait plus comment revenir à la vie, elle continue sur la ligne droite d’après l’horreur. Robotique, sans envie. Elle fait des plans : entrer aux Arts Décoratifs de Paris, ou à Duperré, faire un stage à Paris ou à Londres, apprendre l’anglais, continuer à défiler pour des événements (elle est très belle). Elle parle de ses plans mais rien ne se passe.
E. sert et débarrasse des assiettes et des verres pour 6 € net de l’heure, sans compter les pourboires parce que je vous l’ai dit, elle est belle, elle illumine.
dans ma tête les hommes
mon souffle coupé
des hommes
dans ma tête chaque nuit chaque jour j’ai beau avancer
il y a des hommes comme jamais
il ne faudrait croiser
trop d’hommes
apportez-moi des plateaux servis d’omelette
je veux me noyer dans l’omelette
faites que l’acidité des cornichons excuse mes pleurs
je me noie dans l’omelette chaque nuit
je me noie en ce moment chaque jour
chaque nuit
je n’ai plus de plan pour vivre
face à l’horreur
dans ma tête il y a des hommes qui tuent
je suis pétée
je bois plus je fume plus je suis plus saine que jamais
mais me suis jamais sentie aussi crazy qu’en ce moment
je ne peux plus avancer et je me demande si c’est parce que je suis une femme
je me demande à quel point être une femme m’empêche de respirer d’être et de devenir dans cette société
dans ma tête il y a
des hommes qui tuent des femmes
des maris
des hommes désespérés
des hommes à mâchoires silencieuses
sauf après 18h
des hommes qui tremblent tous les matins
jusqu’au premier verre à 10h
des hommes qui veulent tout tacher
tout emporter avec eux
je ne peux plus m’arrêter de trembler tous les jours moi aussi
dans ma tête il y a des hommes libres
et c’est ma plus grande peur
0 notes
Text
TU T’EN CRISSES-TU DES VIEUX EN CHSLD? - Lorena B. Mugica
Collecte d’histoires d’une wannabe préposée aux bénéficiaires (juin - août 2020)

Horaire
07h00 Prendre le rapport, lire son plan de travail et signer le cahier de présence
08h00 Poursuivre les toilettes et les bains
08h10 Distribuer les cabarets dans l’aile C
08h15 Faire manger (249 et aide partielle 2244)
09h30 à 09h45 PAUSE
11h00 Vider les poubelles et les désinfecter avec le virox + remplir les chariots.
12h30 Tournée après le dîner
1 - Amener à la toilette et sieste selon chaque résident :
2241, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252.
2 - Installé pour la sieste : 2261
3 - Lever : 2264
13h45 à 14h PAUSE
14h00 Lever résident de leur sieste et passer la collation.
14h15 Réunion d’équipe avec l’infirmière.
14h45 Inscrire les selles et aviser l’inf. si suppositoire pour le lendemain
14h59 DÉPART
---------------------------------------------------------------------------------
Monsieur B. a un vieux cahier rouge et usé dans lequel il inscrit tous les prénoms des gens qu’il rencontre.
- Boonnn…jouuur…Votre nom… à vouuuus...c’est… quooo…ooiiiii ?
- Lorena.
- Looooo…rrrreee….naaaaaa ! Je…l’ai nooo…té. Queeeel…que part.
Quand je viens porter son dîner, monsieur me dit : « Voootre…nooom à… vouuuus… c’est… quoooiiiii ? »
C’est la première fois que je donne un bain. Il me répète : « Vos…cheee…veux. Ils sont. dooorés. Ils re…flètent… leeee… sooooleil ».
Je lui frotte fort le dos : « Aaaaaah… Ouiii ! ».
Je souris. Je me sens importante, privilégiée d’être là avec lui.
***

Madame S. a 106 ans et une forme physique plus que surprenante. Elle est complètement sourde. On me prévient qu’elle peut avoir un comportement agressif, «surtout au réveil». Autrement dit, quand on suit l’horaire : on la réveille à 7h30 pour l’asseoir pour le déjeuner qu’on sert à 8h. Je comprends qu’elle soit agressive, elle n’entend pas ce qu’on fait ou ce qu’on dit. C’est normal que tout la prenne par surprise si elle n’a pas de contact visuel ! Sans oublier le port du masque qui l’empêche de lire sur nos lèvres. Quand elle ne nous comprend pas, elle soupire d’exaspération et tourne la tête. Elle a encore de très bons yeux, c’est donc par écrit que je communique avec elle quand les gestes sont incompris.
Mon truc pour la lever du lit le matin c’est de lui flatter un peu les cheveux et de lui faire des petits clins d'œil. On se prend à deux, on lève la tête du lit puis, chacune assise à ses côtés, on lui gratte le dos. Elle adore et elle fait toujours des « Aaah ouui! ». Ça me fait vraiment rire. J’adore la réveiller. Un autre jour, je passe devant la chambre de madame S. Comme à l’habitude, je vois une chaîne de grattage de dos entre madame S. et deux collègues préposées.
Étant sourde, quand elle parle, elle parle fort. Dans la salle commune, alors que tout le monde est réuni pour un meeting de 10 minutes, madame S. crie à sa voisine de fauteuil : « T’AS TU VU ÇA, SA JUPE ? C’EST INDÉCENT ! ».

Madame I. passe ses journées les yeux fermés. Elle répond à son nom, mais il faut répéter souvent. Quand on dit son nom, elle entrouvre un peu les yeux à chaque fois.
- Irène ?
- Quoi ?
Silence.
- Irène ?
- Quoi ?
- Est-ce qu’on a fini ?
- …
- Madame ?
- …
- Madame ?
- QUOI ?
Elle a les yeux grands ouverts et me regarde fixement.

Jour 1 en CHSLD
Je me sens à ma place.
Première rencontre d’intervention.
J’ai peigné des cheveux.
***
Au moment de lui servir le dîner, une résidente (née en 1932) me dit d’une voix rauque : « C’est pas drôle vieillir… Ça se peux-tu ».

À la fin de notre première semaine de formation, l’autre préposée et moi allons dire au revoir aux résident-es. Pour madame S., j’écris sur un bout de papier : « À vendredi ».
Elle nous envoie des becs soufflés et nous répète « À vendredi ! ». Madame M., nous dit un timide et rauque « À vendredi… ». Monsieur B. s’exclame « Jeee vouuuus… aiiiiime !!! ».

Il y a trois ailes : le résident-es permanents-es (A), une aile fermée (B) et celle où je suis attitrée (C), les lits psychosociaux. Ce sont des chambres pour des résident-es de passage en attente d’une place en résidence ou en CHSLD. Lorsqu’il y a des nouveaux et des nouvelles, à cause de la covid, iels doivent faire deux semaines d’isolement, c’est-à-dire sans sortir de leur chambre.
Jour 3 en CHSLD
Madame C. fait des allers-retours avec sa marchette, sacoche sur la poignée. Il ne faut JA-MAIS toucher à la sacoche. Madame C. répète : « C’est y’ousse que j’vais ? ».
Dans sa sacoche, des trésors. Ses trésors. Elle garde précieusement les papiers pliés en quatre. Les papiers, ce sont ceux qui sont déposés sur les cabarets qui indiquent le menu et la consistance des repas. Les papiers en question détaillent les repas, mais le plus important : la texture. Beaucoup sont aphasiques. L’aphasie est un problème de langage dont les conséquences sont multiples et qui affecte la faculté de parler et provoque des problèmes de déglutition (pour essayer de comprendre ce que ça fait, mets une guimauve dans ta bouche et essaye de boire de l’eau). Les résident-es aphasiques ont dans leur cabaret des toasts ou du poulet sauce brune en purée.
Quand madame C. s’assoit, elle déplie les papiers délicatement, les ausculte avec beaucoup d’attention à cinq centimètres de son visage en se grattant le menton.
- C’est à quelle heure l’heure du dîner ?
- On a déjà dîné.
- Ah bin ! Vous m’avez oubliée, j’ai pas diné moi. Pouvez-vous me dire à quelle heure on mange ?
- Le souper est vers 4h30-5h.
- Et là, il est quelle heure ?
- 2h.
- Mon dieu que le temps passe pas vite… Pis vous la voyez où l’heure ?
- Sur l’horloge juste ici.
- Ah ! Bin oui ! On oublie hein, c’est tannant. Excusez-moi. J’ai peur de vous déranger.
Une minute plus tard : « Pouvez-vous me dire yé quelle heure ? ».

Deuxième semaine en CHSLD
Première rencontre avec madame G. Elle est très petite, genre 4’7’’.
Ses yeux sont énormes, agrandis par les verres de ses lunettes, les pommettes bien rondes et des cheveux blancs au brushing s’allongeant jusqu’au plafond. Son visage minuscule semble magnifié par un dentier qui la rend étrange et superbe à la fois.
Ce jour-là, au moment de faire sa toilette, elle me dit : « J’ai 95 ans moi et mon doux, je souhaite à personne de se rendre à cet âge-là ! ».
Elle rit.
Je ris avec elle.
***
Le cahier des selles c’est la Bible du CHSLD. À chaque quart de travail, on doit inscrire la consistance du caca des résident-es : petite, moyenne, grosse, dure, liquide, p’tites boules… Après deux jours sans caca, c’est le suppositoire.
C’est toujours à ce moment que madame R. vient nous décrire ses selles et explique de long en large ce qui se passe dans ses intestins : « Ce matin, j’suis allée aux toilettes, pis y’a rien qui’a sorti. Mais bon, après le petit déjeuner, par contre, là, j’en ai fait une petite de même ! J’sais pas ce qui se passe, ça fait une journée que j’ai pas fait de la toilette. La dernière fois par contre, c’était une grosse molle … »
Si on ne l’arrête pas, la description continue. Elle n’est pas la seule, ça parle beaucoup et souvent de caca en CHSLD.

Monsieur E. porte un collier cervical suite à une chute. Je lui fais sa toilette basse (la toilette basse, c’est après un pipi/caca, laver avec une guenille humide et savonneuse puis sécher). Pour essuyer son pénis, je pousse la petite peau vers l’arrière. Avec un pénis mou, c’est pas si facile ! Il me dit en riant : « Arrêtez ça, vous allez le réveiller ! » Monsieur E. a 94 ans.
Comme sujet de conversation, il y a le caca, mais aussi les érections de vieux parce que oui, étant donné leur âge, c’est toujours surprenant !

***
Aux chaises berçantes à l’intersection des couloirs, madame C. :
« Pouvez-vous bin m’dire POURQUOI BIN, on me lève, pour me laisser ICI, dans le COULOIR ?! Pouvez-vous bin m’dire c’que j’fais ici? C’est pas ma maison ici ! C’est quand est-ce que bin don’ j’vais pouvoir sortir ?
C’est par où qu’on sort ? ».
Alors que madame C. continue à être fâchée et ne pas comprendre ce qu’elle fait ici, l’infirmière répond :
- À 10h vous allez pouvoir sortir !
- Bon. Il est quelle heure-là ?
- C’est bientôt l’heure. Regardez l’horloge est juste là !
- Ah bon ok. Et mon mari ?
- Il va venir cet après-midi.
- Bon. Ok. Merci.
Je vais voir l’infirmière et lui demande :
- Il va vraiment venir son mari ?
- Bin non. Il est mort.
Je réalise qu’avec une mémoire d’environ 4 minutes, c’est un mensonge qui ne lui fait pas de mal.
***
Seule avec madame J., normalement souriante dès le réveil, ses petits yeux bleus portent un regard confus et troublé.
- Bonjour madame, je viens faire votre toilette basse.
- Ah oui ? Ah bon, ok. Mais, mais… Est-ce que je peux vous poser une question ?
- Oui ?
- Bin… C’est que… Pouvez-vous me dire ce que je fais ici ? Je ne comprends pas ce que je fais ici… Je comprends que je ne suis pas ici pour travailler… Pouvez-vous m’expliquer ?
J’ai mal dans mon cœur. J’ai une grosse boule parce que je sais ce que je dois lui répondre, parce que j’ai entendu une autre préposée lui dire.
- Je suis désolée de vous le dire, mais vous êtes ici parce que vous êtes atteinte de la maladie d’Alzheimer. Vous êtes ici pour qu’on s’occupe de vous.
- Et ça fait longtemps que je suis ici ?
- Oui, ça fait quelques mois déjà. On prend soin de vous.
Quelques jours plus tôt, c’est elle-même, madame J. qui m’explique qu’elle est atteinte d’Alzheimer : « C’est que des fois j’oublie. ». Elle comprend sa maladie jusqu’au moment où elle oublie qu’elle oublie. Quand ça arrive, elle devient anxieuse, inquiète, confuse et triste : « C’est ça qui est tannant, c’est que j’sais pu… J’sais pu quoi, qui… ». Lorsque je repasse devant sa chambre, elle discute avec une infirmière. Madame J. sort de sa chambre, les yeux gonflés, renifle. Elle s’excuse. Elle m’explique qu’elle est atteinte d’Alzheimer.
- Voulez-vous un câlin ?
- Oui.
On se donne un gros colleux. Elle pleure et moi aussi, j’ai les yeux pleins d’eau. Je lui propose de se mettre belle pour lui remonter le moral. Ensemble, bras dessus, bras dessous, on fait demi-tour vers sa chambre pour se mettre du rouge à lèvre rose.

Quand on arrive pour la lever du lit, un matin, madame M. nous regarde, couchée, la corde de la cloche d’appel autour du cou. Quand je m’en rends compte, elle tourne lentement la tête vers moi et me regarde de ses yeux tristes. Ça me pince en-dedans. Je me dis que ce n’est certainement pas ici qu’elle va (re)trouver le goût à la vie. Posée dans son fauteuil, devant son mur blanc brillant et vide. Plus tard dans la journée, l’infirmière affirme que madame M. semble avoir renoncé à la vie et qu’il faut la surveiller. On change la cloche d’appel par une clochette comme celle au restaurant.

Madame I. fait la sieste l’après-midi avec de la musique classique. Elle tape du pied, les yeux fermés et des fois elle fredonne. Alors que je mets la musique lors de sa sieste d’après-midi, une collègue préposée me dit : « Baisse le volume un peu, j'haïs assez ça la musique classique ! ».
Une autre fois, madame I. est assise dans son fauteuil. Dans sa chambre, il y a beaucoup de photos. C’est l’une des rares chambres décorées qui porte les traces d’un passé vivant et rempli d’amour. Il y a quelques photos d’elle et de son mari. Ils ont l’air follement amoureux, ils s’embrassent. Je lui montre et lui demande :
- Les reconnaissez-vous ?
Elle regarde longuement. Elle ne dit rien, prend la photo dans ses mains et regarde de près. De sa toute petite voix, elle me répond : « Non ».
Et elle ricane. J’ajoute : « Oui sont beaux, hen ? Ils ont l’air amoureux ».
Elle ricane encore, sourit de ses quatre dents et hoche légèrement la tête pour dire oui.
***
Monsieur B., atteint d’Alzheimer, lui qui écrit les prénoms dans son cahier rouge, me dit : « Maaaa… femmmmme. Laaaa maaa…laaaa..diiiie... Ca me faiiit…. de la peiiiii…ine qu’ellllll….e m'aaaa… ouuuuu…bliiiié… quuuue je laaa… retrouuuuveraiiiii… paaaas. ».
À sa dernière journée en résidence, on se dit au revoir : « Ça vaaaa quaaand…. je voooiiis vos yeuuuux. J’aiiiime vos yeuuux, je ne vous ou…blie….rai… jamaiiiiiis! ».

Sortir dehors voir les fleurs avec madame S., la madame sourde. On regarde les fleurs dans les pots de l’entrée bétonnée de l’hôpital. On s’émeut ensemble d’une fleur qui est douce comme le velours.
Semaine 3 en CHSLD
Madame R., qui vient me prendre la main pour marcher un peu, me demande : « Il est où Robert ? » pour la énième fois de la journée.

Dans une chambre, un ballon de fête de 93 ans.
Je pense à voix haute (naïvement) :
- C’était sa fête récemment ?
- Ça ? Oh non ! Ça fait longtemps !

Ma dernière journée en CHSLD
12h44. J’attends l’appel de ma docteure. Le téléphone sonne. Je réponds. Je lui dis que je dois arrêter, que j’ai besoin que quelqu’un me dise d’arrêter parce que je suis épuisée, à bout, faible et que je n’arrive pas à m’arrêter moi-même. Je ne dors plus, je pleure souvent, je bois pour me calmer parce que la vie est too much. Je reçois un diagnostic de trouble anxio-dépressif. La docteure me dit que je suis « en burn out ». Elle me rédige un billet d’arrêt de travail et me prescrit des antidépresseurs. Elle m’explique que mon cerveau est malade et que je dois prendre soin de moi avant de m’occuper des autres.
Je reviens au travail après mon appel. Je tiens à faire de cette dernière journée un beau souvenir. Je décide que je vais mettre du vernis à ongle à ma madame préférée, madame S., la madame sourde de 106 ans. Cette journée-là, elle porte un chandail rouge vif.
Je vais la voir et lui propose avec des gestes de lui mettre du vernis à ongle : « Non, oh non ! Non, non, non… ».
Je reviens avec des vernis. J’ai choisi plusieurs couleurs : bleu, argent et, of course, le rouge. Rouge Noël comme son chandail. J’attends sa réaction. Elle se cache les yeux, tourne la tête. Puis tranquillement, tend le bras et choisit le rouge. Elle me regarde à nouveau, roule les yeux, sourire en coin. Je veux lui faire plaisir, la faire briller, cette femme de 106 ans que je trouve tellement belle. Je veux lui faire sentir qu’elle est spéciale pour moi.
C’est sur mon temps de pause que je lui mets le vernis rouge. Il n’y a presque personne sur l’étage, c’est notre tête à tête. Je lui fais les ongles lentement, elle me regarde les yeux brillants, la bouche entrouverte :
- Oh mon dieu ! Ça fait tellement longtemps ! Avant, j’en portais tout le temps !
Quand j’ai fini, je m’en mets sur le pouce. Pour elle, pour moi, pour me souvenir.
Je suis partie sans dire bye. Le cœur gros, mais sans regarder derrière, avec le sentiment d’avoir pris les meilleures décisions, autant en commençant, qu’en arrêtant.
Aucun regret, ongle rouge à l’appui.


6 notes
·
View notes
Text
COLLECTION DE COIFFES - Fabiola N. Aladin

J’ai enfin pleuré. C’est rien d’exceptionnel, mais je me suis longtemps interdit les larmes parce qu’elles me confrontent au fait que je trouve que ma vie est un peu de la marde. Au jour le jour, je considère ma vie parfaite telle quelle, sans grand effort.
À titre d’exemple, j’habite toute seule dans un appartement que j’adore et que je décore tranquillement, à mon goût ; je fais de la Zumba deux fois par semaine juste parce que je suis amoureuse de mon instructeur, mes finances se stabilisent et mes ami·es sont exceptionnel·les.
Quand j’y réfléchis rationnellement, je me refuse le droit de jouer le saule inconsolable parce que c’est plus sain de garder le cap sur le positif. Après tout, qu’est-ce que j’ai d’autre à faire honnêtement, mis à part me contenter de mon petit bonheur ? Ce déni-là fonctionne habituellement… jusqu’à ce que l’Internet me rappelle qu’autour de ma petite vie agréable, beaucoup de marde n’essaie même plus de se cacher.
Le déclic se fait hier soir : je me couche dans mon lit, je dépose ma machine intelligente à côté de ma nouvelle-lampe-de-chevet-trop-chère-fabriquée-au-Québec et je me sens coupable d’être heureuse. Je pleure. Impossible d’arrêter de pleurer. Les causes de ma culpabilité sont multiples.
Je suis une femme. Je suis grosse. Je suis noire. Je suis une grosse femme noire.
C’est absolument terrorisant quand je m’arrête pour y penser.
Ces caractéristiques-là, qui ne devraient que me décrire constituent en fait trois lourds chapeaux qui me démolissent la colonne vertébrale jour après jour.
La pesanteur de ces coiffes est bien mise de l’avant ces temps-ci et c’est merveilleux, mais je n’ai pas envie d’y participer activement. Pour protéger ma santé mentale et préserver mon envie de vivre, je choisis le déni conscient. Mon cerveau préfère plutôt s’arrêter à la reconnaissance de mes maigres privilèges. Malheureusement, ce déni a son lot de conséquences :
— Mais quelle égoïste ! — Cette femme est une nuisance à toutes les causes ! — Wow. Quelle traîtresse ! — C’est fascinant admettre sa lâcheté aussi facilement !
Tellement agréables, mes petites voix intérieures. C’est con à quel point avoir juste envie de semer le bonheur, c’est aussi assumer d’être perçue négativement par mes semblables.
À toi qui aurais envie de me juger, sache que malgré mon silence sur les réseaux sociaux, ça va me faire plaisir d’être présentée à tes parents pour faire diminuer leur peur des Noir·es.
Malgré l’absence de mon militantisme actif, je continuerai d’être la grosse qui s’active intensément dans son cours de Zumba, pis pas juste pour impressionner l’instructeur, pour faire diminuer les préjugés.
Je serai toujours fière, aussi, de prendre ma place partout où j’irai pour que les jeunes filles comprennent qu’il n’y a aucune limite à ce qu’elles veulent accomplir.
J’ai énormément d’admiration pour les personnes qui choisissent de manifester, d’écrire des articles ou des ouvrages, de participer à des débats publics, de n’utiliser leurs réseaux sociaux qu’exclusivement pour militer. Au fond de moi, je rêve de faire partie de ces combattant·es, mais je dois admettre que je n’ai tout simplement pas cette force, ce courage, ce désir, ce feu qui allume mon coeur. J’essaie encore de me convaincre que ça ne fait pas de moi une horrible personne et je l’avoue, ce n’est pas évident chaque jour.
Pour arrêter de pleurer, je me concentre sur mes privilèges. J’habite à Montréal, la ville où il fait le mieux vivre en Amérique du Nord (j’ai inventé ça).
J’ai pu me rendre à l’université pour exercer une profession que j’adore. Je suis hétérosexuelle, n’ai à vivre avec aucun handicap en plus d’être neurotypique.
Côté privilèges, je suis quand même très gâtée, même si c’est relatif. Mon manque de courage et de force vient aussi du fait que j’ai peu d’espoir que la situation s’améliore globalement. Tout ce que je peux faire, c’est être un agent de changement local. Très, très local.
Merci à celleux qui militent à grande échelle, mais je choisis de passer mon tour. Je vais vivre une vie positive, sans combats explicites, et continuer d’offrir du beau autour de moi. C’est pas mal la seule chose sur laquelle j’ai concrètement encore un tout petit peu de contrôle de toute façon et ça me fait du bien, quand j’arrive à ne pas culpabiliser.
Aux personnes qui préfèrent le rôle de porte-étendard, prenez soin de vous autres, ok ?
Texte de Fabiola N. Aladin paru dans le mag #4 / Illustration de Teenadult
2 notes
·
View notes
Text
SYNCOPE UTÉRINE - EMMANUELLE RIENDEAU

Oh, if they told you they want you
…
Women is losers
…
Men always seem
to end up on top
Janis Joplin / Women is losers
Ils s’en foutent
de cette fin qui ne leur appartiendra jamais
ce sera notre affaire
notre trouble
notre hangover de trois jours
nos appels au CLSC
nos engagements silencés
ils s’en foutent
de nos extensions
de nos parures
de nos envolées
étroites ou larges
pensantes ou sottes
repues ou assoiffées
repentantes ou inexcusables
ils se vident
avant de nous kicker en bas du lit
ils se servent
nous sommes si laides dédaigneuses
si belles prises de force
quelles rétributions
attendent-ils
transactions glauques
refusées
ne nous donnez pas
tout cet amour
nous ne saurions
qu’en faire
poème Emmanuelle Riendeau, extrait du prochain mag à paraître
illustration: Sara Hébert
0 notes
Text
Extrait d’un séjour à Eeyou Istchee - Cybèle B. Pilon

2 notes
·
View notes
Text
PRINTEMPS- ANICK ARSENAULT

21 mars premier jour du printemps
7h15 le matin
je mets mes écouteurs et pèse sur Play
en ouvrant la porte de chez nous
la neige commence à fondre
je marche sur la rue Saint-Jean
en m’attardant devant les vitrines
direction l’hôpital
gagner du temps
avant de m’entasser dans l’ascenseur
où je tombe par hasard sur une chaise roulante
où git le regard fuyant le visage bleuté
une femme de mon quartier
qui ne me reconnaît pas
je monte le son
en me dirigeant vers la chambre indiquée
***
déjà une infirmière me distribue
papiers à signer pilules et injection
je me déshabille en tentant de garder mes écouteurs
les brancardiers arrivent
je déteste être promenée dans les couloirs d’hôpital
couchée sur une civière silencieuse
dans la salle d’opération aux murs de carrelage vert
tout n’est que bips et perfusions
j’égrène les visages de mes amis
en récitant leurs noms en chapelet
on me pousse m’encourage me place
sous une immense lumière
je remets mon corps au ventre grugé
entre les mains d’inconnus masqués
qui me découperont 2 heures durant
pour extraire ce fruit noirci
fertilité cancéreuse et finie
5 heures après
je lutte pour ouvrir les yeux
et aligner deux mots cohérents
13 heures après
je réussis
***
ligotée aux machines dans une chambre sombre
une pompe à morphine d’un côté
un soluté un antibiotique des comprimés de l’autre
divers tubes encombrent mes orifices
je suis clouée au lit dans une chambre commune
entre les déjections bruyantes de mon voisin
et ma tête qui se bat pour comprendre
la plus longue nuit de ma vie
effrayante à souhait
rien à voir avec les accouchements
les guerrilleros colombiens armés
les morsures du berger allemand
les chauffards complètements saouls
le boa de 2 mètres rampant sur mes épaules
les scorpions noirs dans mes souliers
rien à voir non plus avec la panique
(mon fils égaré dans un marché équatorien
ou mon autre fils avec la tête ouverte hurlant)
***
la plus longue nuit de ma vie
impuissante mais consciente
immobile suintant de partout
des liquides entrent d’autres sortent
dans le noir
entourée de gémissements de pas feutrés
complètement droguée mais LUCIDE
réveillée
seule
et muette
***
au matin
stagnante je suis nue
avec un préposé qui me demande en souriant
“Est-ce que tu t’es déjà faite laver par un homme?”
en me passant un savon sur les seins
puis partout
s’attardant avec sa débarbouillette
à mes lèvres
enragée mais sans aucune force
intubée pansée
j’endure
puis
je remets péniblement mes écouteurs et pèse sur Play
en tâchant de ne pas vomir
***
22 mars
alors que je ne fais même pas
deux pas seule
sans m’appuyer sur un mur
on me renvoie chez moi
***
depuis
blindée d’antidouleurs de bouillon de poulet et de musique
je me vautre dans le jello et les bandes dessinées
les organes reprennent leur place dans mon ventre
mes points de suture fondent au rythme de la neige
j’écris une lettre à l’hôpital concernant le préposé
je retrouve mes forces
le printemps arrange bien les choses
Texte: Anick Arsenault
Illustration: Laurine Lesaint
1 note
·
View note
Text
Lettre à Daria - Emmanuelle Riendeau

Dans le numéro 161 (printemps 2019) de la revue littéraire Moebius, la poète Daria Colonna écrivait une lettre à la poète Emmanuelle Riendeau. Nous partageons ici la réponse de cette dernière.
La première fois que je t’ai entendue lire, tu étais sur la scène du Quai des brumes. À cette époque, j’allais souvent dans les soirées de lecture, drunk as fuck, tellement imbibée que j’ai arrêté de tenir le compte de mes blackouts. L’ambiance de cette soirée était à l’écoute silencieuse et à l’applaudissement automatique, il ne fallait surtout pas parler, car les réprimandes venaient vite. C’était souvent le cas au Quai, je me souviens notamment d’une fois où j’étais saoule et loud, me plaignant de la piètre qualité des performances à Vaincre la nuit. Une des spectatrices qui se tenait près de moi s’est permise de me prendre la face entre ses mains et de me suggérer de partir ou d’écouter, de façon plutôt dogmatique.
J’éprouvais et j’éprouve encore une risée de découragement dans ces micros libres qui manquent de spontanéité (sans compter qu’il faut s’y inscrire sur une liste et attendre son tour, processus scolaire et ordonné auquel je répugne, born and raised entre les murs du Bistro Ouvert). Je reste redevable à la scène du Bistro de Paris pour les real ass soirées de lecture auxquelles j’ai pu prendre part. C’est ainsi que je me suis construite comme poète, dans l’irrévérence et la sauvagerie, dans ces lieux où le public décide de se taire ou de parler, où il exerce sa liberté spectatoriale; là où l’état de la crowd devient une mesure d’appréciation des performances. Stéphanie Roussel a écrit un mémoire de maîtrise sur le sujet (1), je ne m’éterniserai pas là-dessus.
Lors de ce premier contact indirect avec toi, je n’avais jamais entendu ton nom, j’étais une backdoor woman calant ses double bloodys en attendant de me faire démolir par des textes qui me permettraient d’accepter une mort instantanée après les avoir entendus. J’ai trouvé ta lecture agaçante, ta tonalité hautaine, guindée, et j’avoue n’avoir pas compris si j’étais en train de me faire insulter ou interpeller, par qui, pourquoi. C’était bien avant d’emprunter ton recueil à la bibliothèque, avant sa lecture dans mon appartement de la rue La Fontaine.
Yolo, live fast die young, carpe diem baby. Le fameux soir où la CAQ a été élue, nous étions réunies autour d’un événement de poésie électorale organisée par les Goonies, dont je fais partie. Tu y as lu des textes sur la maternité, des textes inédits qui font écho à la lettre que tu m’as envoyée. Cette lecture n'était pas encombrée par la tonalité pesante que j’avais entendue auparavant, elle était plus incarnée, plus habitée.
Quand tu m’as vue au Salon du livre, c’était pour moi une fierté, une franche rigolade en perspective de venir trasher la place Bonaventure pour entendre lire des poètes que je respecte (les auteurs de Del Busso). Savoir qu’ils écrivent tous au sein d’une maison jeune et vigoureuse – what’s up la poésie québécoise – et pouvoir dire yessir on est là, on est en vie, on fait partie de ce renouveau de la littérature où tout est possible, est un motif suffisant pour me donner envie de boire. Sans être blasée, sans se prendre pour acquis, owner le fait qu’on assiste à une lecture drette à côté de la cantine à sandwichs et eau Perrier, et qu’on s’en câlisse, parce que la poésie est là, au moins. J’étais dans un mood de conquérante, occupy le salon du livre avec ma flasque toute crottée, mon habillement inapproprié, les accolades et les kisses d’amis retrouvés. Je vis pour ce genre de gathering, pour effrayer les gens du public venus chercher une bande dessinée, un livre de croissance personnelle, no matter what, j’adore la proposition ; une bande de poètes lâchés lousses là où on ne les attend pas, juste pour foutre le trouble. At least on se soutient mutuellement si les autres ne veulent pas de nos sales gueules.
Tu y étais aussi, comme tu l’indiques au début de ta lettre :
La dernière fois que je t’ai vue, tu allais écouter des ami-es de Del Busso lire sur la scène du Salon du livre placée en plein milieu de la cafétéria, en plein néon, en plein bruit, en plein best-sellers �� la scène la plus glauque que j’ai vue de ma vie. (2)
Pour toi c’était glauque, il faisait trop clair, il y avait trop de best sellers, alors que pour moi c’est un accomplissement d’avoir publié et de voir mes amis poètes infiltrer l’institution et les réseaux officiels. C’est une fierté de souiller les tapis normatifs avec nos godasses habituées aux planchers gommeux et crasseux des tavernes où il fait bon passer un tiers de la soirée à l’intérieur, l’autre aux toilettes et l’autre dehors. Comme spectatrice ou comme lectrice, je ne peux pas m’exclure des scènes qui ne conviennent pas à mes goûts personnels, refuser des occasions en fonction du contexte; j’assiste à assez d’ostracisation et de censure de même. Occuper la scène, toutes les scènes, peu importe le public, peu importe le lieu, fait partie de mes convictions les plus solides. Occuper les micros, prendre la parole au milieu des poussettes et des baby boomers, prendre la parole dans les tavernes, dans les soirées guindées et restrictives ne sachant pas comment me gérer, n’importe où. Je ne sais pas faire de distinction, de classement, je crois en mes textes, je sais les défendre partout, comme j’encourage la libre circulation de la poésie, fuck les lieux poétiques, la poésie n’habite nulle part.
Je t’ai tendu ma flasque à la Place Bonaventure comme je la tends à ceux et celles qui écrivent, un beau mélange de salives et de bactéries tuées par la force de l’alcool, et tu as pris une gorgée. Je partage la booze, l’utilise comme une insulte et une bénédiction, j’asperge mes lecteurs avec, fais éclater des cannettes pour protester. L’alcool est un lubrifiant social dont j’abuse, c’est une panacée qui amplifie la douleur après trop de verres. En buvant on accélère l’inévitable, on planifie le saccage à venir. Enivrez-vous bande de fuckers, Baudelaire remastered.
Tu m’écris :
Je me demande si je peux me compter dans le on qui est le tien, le on de la colère. Ce n’est pas une question simple. Life vs paper. J’ai une vie privilégiée. Je n’ai pas grandi dans la pauvreté. Il y a peu d’années, je croyais savoir ce qui avait créé ma colère, mais aujourd’hui, comment dire, ce n’est plus si clair. Je ne sais pas exactement ce qui m’a rangé du côté de la mort. Je n’ai pas été escorte, je n’ai pas gratté ma peau sur le papier des hommes, je connais ma ouate. Je la détourne avec l’écriture. (3)
Je n’ai pas fait les calculs, mais j’imagine que j’ai dû grandir dans la pauvreté. Mes parents volaient des sacs de couches à l’épicerie en les laissant sous le panier quand les temps étaient moins prospères, nos épiceries se faisaient religieusement au Maxi, on mangeait toujours la même affaire, on ne faisait aucun voyage. Je ne suis obviously pas une fille de bourgeois. Dans son premier livre, Édouard Louis écrit : «Nous n’étions pas les plus pauvres» (4). La comparaison permet d’alléger ou d’alourdir l’état de nos existences matérielles. Auparavant, je ne me trouvais vraiment pas si pire, puis j’ai fini par me comparer à d’autres, à du monde qui écrivent des livres à la suite de leurs parents écrivains, qui ont eu l’éducation culturelle facilitant leur insertion dans la chose littéraire. J’ai fini par comprendre pourquoi je détonnais dans les colloques et dans les salles de cours de la maîtrise. Moi qui me perdais encore à Montréal, dont la famille éloignée disait encore à la blague que j’étudiais dans du «pelletage de nuage», moi qui me reconnaissais étrangement dans les mots d’Édouard Louis : «Si mes parents étaient en butte à l’incompréhension face à mon comportement, mes choix, mes goûts, la honte se mêlait souvent à la fierté quand il était question de moi» (5). Mon père me demandait, «Tu vas faire quoi, tu vas écrire des livres?», je ne savais pas quoi lui répondre à part «Peut-être que oui». En lisant Miron, j’ai catché qu’on peut embrasser l’écriture même si on vient d’une lignée d’analphabètes. Ils ne savaient pas quoi faire de moi là-bas, et je me suis ramassée ici, jusque dans cette lettre.
Ta «ouate» est métaphorique, peu explicitée, je l’associe à la classe moyenne aisée, riche, aux gens de bonne famille, éduqués à l’école privée, heureux légataires d’une histoire familiale avantageuse. Je précise que ce «life vs paper», que tu cites sans donner la référence exacte, est un extrait tiré d’un texte que j’ai écrit en réponse à l’hommage à Josée Yvon du 2 juin 2018 à la Maison des écrivains, où j’ai éclaté ma cannette de Molson Dry par terre au lieu de me la faire en shotgun avant de lire mon texte comme je l’avais planifié. Je ne peux jamais rien prévoir, il y a toujours quelqu’un ou quelque chose pour faire resurgir ma colère:
life vs paper scarification documentée vs radiographies d’ennui
poètes : A incohérentes sur papier attaquantes honorifiques dans la vie
universitaires : D doctorantes sur papier étudiantes libres dans la vie
il leur manque l’expérience de la domination subie, l’étrangeté première à la culture savante, scolaire, la conscience de son arbitraire, l’épreuve de la violence symbolique. - Pierre Bergounioux, «Esquisse d’un idéal-type transversal: le bon garçon» , dans Pierre Bourdieu L’insoumission en héritage, sous la direction de Édouard Louis, p. 151. (6)
Tu fais donc appel à un texte dans lequel j’essaie d’exprimer la dichotomie entre celles qui vivent cette «domination subie» et celles qui en parlent sans la vivre concrètement pour finalement me donner le rôle de l’«escorte», et te donner celui de l’écrivaine connaissant sa ouate. Mon départ de la soirée Hommage à Josée Yvon du 2 juin 2018 est une réaction directement suscitée par la posture intellectualisante et distante, confortable, prise par deux intervenantes lors de la soirée. C’est exactement cette posture que tu endosses dans ta lettre, ce qui me fait considérer ton texte comme une fausse main tendue, une fausse envie de solidarisation.
Je ne crois pas que tu peux te compter dans le «on» qui est le mien dans Désinhibée. Je n’écris pas pour faire consensus, pour universaliser, j’écris pour souligner les divisions qui suscitent ma rage et mon exclusion, les humiliations subtiles et les évitements qui me rentrent dedans constamment. Je ne demande à personne d’endosser mes épreuves pour moi, ni de me consoler, ni d’adhérer à ma poésie. Cette manière énonciative est un choix esthétique circonscrit dans un projet précis, qui comporte une possibilité de reconnaissance pour la lectrice se sentant interpellée, ou qui demande de prendre du recul et de listen to the life story, pour une fois, de ne PAS prendre la parole pour les filles fucked up, pour les guédailles écartées.
Dans la lettre que tu m’as écrite, tu parles souvent d’amour, tu me demandes de m’exprimer sur le sujet dans ce passage:
Si ce on que tu écris existe, et si je peux m’y sentir incluse d’une étrange manière, dis-moi le mot qui à lui seul parlerait de l’ambivalence, de la joie et de la terreur, de l’oubli et de la vivacité sensuelle, ce mot qui décrirait nos visages souriants d’amour sincère. (7)
Ce «on» que j’utilise dans Désinhibée, c’est le «on» des femmes qui vivent comme elles le peuvent, qui dealent avec les circonstances qui s’imposent à elles, qui prennent la parole en leur nom propre. Ce n’est pas le «on» abstrait qui exclut la personne qui parle, le «on» de la langue française correcte. C’est le «on» concret de l’usage populaire qui risque une prise de parole, rassemble les exclues et leur permet d’exprimer leur différence, leur marginalité, soit pour que d’autres s’y reconnaissent et se sentent moins isolées, soit pour que celles qui ne s’y identifient pas puissent entrer en contact avec des réalités différentes des leurs.
Le mot que tu cherches, je ne peux pas le trouver. Je connais les mots scandale, perversion et polémique. L’amour est une thématique que je peine à aborder de front dans mes textes. Je te laisse l’amour et l’enfantement, je garde la haine et l’autodestruction.
Plusieurs savent que je suis extrémiste, quand j’aime j’adhère, quand j'exècre je repousse. Mes désavouements varient, ma rancune ne dure pas. Mes éclats, mes colères suscitent la discussion et la discorde, d’ailleurs, tu sembles fort intéressée par mes impulsions réactives, comme tu en parles dans une entrevue sur ton travail d’écriture:
J’éprouve de la frustration à l’égard d’une certaine garde en poésie québécoise qui est à la fois super pop et super hermétique. Heureusement, il y a aussi des gens qui ont une colère, qui est intéressante et qui veut dire quelque chose. Emmanuelle Riendeau (Désinhibée, Les Éditions de l’Écrou), par exemple, qui a jeté sa bière sur [l’écrivaine] Roxanne Desjardins [le 2 juin dernier lors d’une soirée hommage à Josée Yvon au Festival de poésie de Montréal], en lui criant ‘T’es pas en colère’. Ça a révolté beaucoup de gens, mais moi j’ai trouvé que c’était vraiment intéressant comme geste, du moins dans la question qu’il soulève. Je la trouve importante cette colère là, je voudrais qu’on cherche à savoir d’où elle vient, quelles sont ses ruses et sa raison d'être.» dit celle qui affirme toutefois ne se reconnaître dans aucune des scènes du milieu poétique québécois. «Je pense que la poésie pop gagne à être en colère», ajoute Colonna, «sinon, elle est constamment menacée de devenir le pastiche d’elle même, une genre d’esthétique de la colère, autrement dit, du trash qui n’en est pas vraiment, une sorte de mensonge qui fini par écraser les vies vraies. (8)
Cet extrait est antérieur à la lettre que tu m’as écrite, mais il prépare déjà le terrain. En fait, je ne sais pas si tu y étais, à cette soirée, puisque que j’ai éclaté ma bière par terre, pas sur Roxane. To be honest j’aurais eu du trouble avec les flics, ces flics dont tu parles tout le temps, symboliques ou réels, français ou québécois, c’est pas trop clair. L’affaire, c’est que je ne me suis pas rendue à ce point de criminalité ce soir-là. Si ma colère t’intéresse à ce point, prends donc le temps de la circonscrire correctement. Elle s’enflamme avec l’alcool, et la majorité de mes mises en danger se sont déroulées sous son influence. Comme le fait de devenir escorte.
J’apprécie que tu te soucies de mon vécu comme tu le fais publiquement, ce qui est dommage c’est que j’ai l’étrange impression que tu fais du name dropping quand ça ne te convoque ni te concerne, que tu décides soudainement de t’impliquer dans le débat, puisque tu dois être solidaire. Alors tu te mêles de la garnotte des autres, même si tu n’as «pas été escorte» (9), même si tu n’as jamais couché avec des dudes pour payer ton loyer. Apparemment je fais partie de ces femmes dont on aime bien raconter la vie, en ayant l’option de l’éviter soigneusement. J’écris pour rétablir les faits, j’écris parce que je n’accepte plus que d’autres parlent à ma place.
Tu écris: «Il y a peu d’années, je croyais savoir ce qui avait créé ma colère, mais aujourd’hui, comment dire, ce n’est plus si clair » (10). J’ai envie de te répondre que si tu ne sais plus ce qui a créé ta colère, c’est que ta colère n’est pas fondée. Ta colère semble tourner à vide, elle se définit par des formules abstraites derrière lesquelles tu ne te commets pas viscéralement, c’est une colère de marqueurs de relations, la colère de celles qui s’indignent la bouche en trou de cul de poule, la colère de celles qui s’ennuient et qui n’ont jamais connu «l’expérience de la domination subie» nommée par Bergounioux. Tu emploies le mot colère à plusieurs reprises dans ta lettre, mais tu évites de la nommer, de la détailler. Comment se manifeste-t-elle? À qui s’adresse-t-elle? Dans quel contexte surgit-elle? Quelques lignes plus loin, tu écris :
Écrire en regard de la ouate. Comme la mort jouée par une comédienne. Par vengeance, je crois.
Écrire. En regard de cette colère née d’on ne sait où. En regard de ta colère à toi. Dans l’écriture, je ne sais pas, je crois que je serais plus précisément sombre. C’est pour ça que ce n’est plus de la colère. C’est une honte, le rétrécissement de ma colère. (11)
Tu as besoin de moi pour te rappeler ce qu’est la colère, parce que ma colère est fracassante, cyclothymique et imprévisible. On la croit toujours injustifiée parce qu’on la met sur le compte de mon alcoolisme, or je bois parce que je ne supporte pas le monde sober, trop d’inégalités, de fake, de mesquinerie, d’hypocrisie, d’usurpation de la douleur. Ozzy chante The way I feel is the way I am, j’écoute la toune en boucle en te répondant, Too many people advising me/But they don't know what my eyes see, j’essaie de comprendre pourquoi tu souhaites écrire en regard de ma colère; The anger I once had has turned to a curse on you/ Yeah, curse you (12). Je souhaite qu’on me laisse m’arranger avec ma colère, ses implications et ses répercussions. Concentre-toi sur ce qui t’appartient, dévoile-toi, fictionnalise, peu m’importe, mais cesse de vouloir prendre le poids de la honte des autres sur ton dos, ça ne sert à rien.
Je n’ai pas les repères qu’il faut pour éprouver la honte que tu convoques dans ton livre, ni celle dont tu parles dans ta lettre : «c’est une honte, le rétrécissement de ma colère» (13). C’est une autre forme de honte que je connais, la honte d’Annie Ernaux et d’Édouard Louis, cette honte qui se propage parmi les universitaires qui se donnent un beau programme de lecture, Geoffroy de Lagasnerie (que j’appelle affectueusement et familièrement Geoffroy de la lasagnerie, shout out aux lasagnes de la Taverne du Pélican), Didier Eribon, Pierre Bourdieu, etc. Cette honte, plusieurs se plaisent à l’utiliser à toutes les sauces, ils possèdent (étant donné qu’un diplôme est un avoir, that’s where we stand right now) une formation de cycle supérieur leur permettant de comprendre une lecture et de la résumer, de la situer. Ils maîtrisent des propositions théoriques, pensent abstraitement, élaborent vocalement, relient tout à eux-même. Mais ils ne comprennent pas que certains combats ne sont juste pas les leurs. Ils parlent par-dessus celles qui tentent de reprendre leur air, expliquent, dissertent, pendant que l’aspect pratique de leur déblatération se joue ailleurs. Et quand les principales concernées tentent de parler, elles se font museler, ça sort les menaces de diffamation. Personne ne veut les diriger, sauf vers la porte de sortie.
Tu fais intervenir Édouard Louis à la fin de ton texte,
La colère nous a rendues sobres dans l’écriture, toi et moi, d’autres nous disent tranchantes, j’ai envie de répéter sobres. J’hésite encore : est-ce par l’alcool ou par l’écriture que nous nous reconnaissons ? C’est au moins dans l’un de ces vastes territoires que nous brûlons sur nos bûchers en nous faisant des signes, Emmanuelle, en invitant qui pourra s’y tenir aux exigences du feu, aux exigences de la terrible sobriété des femmes qui écrivent en buvant. (14)
Dans Qui a tué mon père, Édouard Louis écrit sur le corps de son père, il exprime ses douleurs, le travail qui brise, les politiques qui empêchent la guérison. Cette exigence du feu, elle relève d’une forme de devoir, elle est vitale, c’est une prise de parole pour ceux dont dont la famille est usée par l’alcool et la violence, dont le corps est un dommage collatéral. L’emploi de cette fameuse citation demande une mise en contexte, une explication, le déploiement d’une relation intertextuelle cohérente. Je me permettrai de convoquer le texte, de le greffer à ma lettre:
Ça aussi je l’ai déjà raconté – mais est-ce qu’il ne faudrait pas se répéter quand je parle de ta vie, puisque des vies comme la tienne personne n’a envie de les entendre? Est-ce qu’il ne faudrait pas se répéter jusqu’à ce qu’ils nous écoutent? Pour forcer à nous écouter? Est-ce qu’il ne faudrait pas crier?
Je n’ai pas peur de me répéter parce que ce que j’écris, ce que je dis ne répond pas aux exigences de la littérature, mais à celles de la nécessité et de l’urgence, à celle du feu. (15)
Édouard Louis s’adresse ici à son père, à ceux qui lui diront qu’il aborde toujours le même sujet. Il les met en garde; il ne navigue pas par des voies littéraires, mais par un canal s’imposant à ceux dont les voix sont toujours mises sur mute, tamisées et expulsées avant même d’avoir pu résonner publiquement. Fais-tu partie de celles qui ont dû quitter leur milieu familial, s’extraire de leur ville natale pour accéder au savoir, à la culture, pour trouver enfin quelqu’un à qui parler? La condition matérielle de tes parents a-t-elle mis en jeu tes chances de make it? Fais-tu partie de celles qui étaient vouées à un emploi à l’usine, un emploi de second niveau, vendeuse, caissière? Ton propre corps est-il sujet à des cassures précoces, ton avenir dépend-il de politiques publiques? Laisse moi en douter. Écrivons-nous réellement à partir des mêmes exigences? Obviously, le feu est pogné. Qui l’a mis, qui tente de l’éteindre, qui le rallume, qui l’avale qui le recrache? I don’t know. Nos impulsions sont destructrices, mais ne visent pas à détruire le même objet.
L’assimilation des concepts, leur partage et leur mise en circulation participent à la démocratisation des savoirs universitaires. Sauf que dans certains cas, la limite entre l’utilisation et l’appropriation inadéquate est mince. Des outils intellectuels construits par des opprimés pour des opprimés ne peuvent appartenir à tous. Ce jeu cérébral coupé de toute implication concrète avec le «vrai» monde, ce manque de recul critique, cette rigidité analytique, les manipulations excessivement nichées des idées, l’attitude décomplexée et narquoise de certains étudiants et professeurs, tout ça m’a fait dropper out du 2e cycle. On enseigne à citer, quand citer, comment appliquer les théories, mais jamais on ne pose la question du positionnement individuel, existentiel face à ces travaux qu’on convoque et utilise allègrement.
Y a-t-il un nom pour ce processus d’auto-association gratuite, erronée à la honte des transfuges? Je ressens parfois le sentiment d’une appropriation de classe quand j’observe certaines personnes parler, agir et créer comme s’ils appartenaient à une classe sociale dont ils ne proviennent pas. La honte est à la mode, et tout le monde se cherche une raison d’avoir honte, même l’absence de honte devient honteuse. Des transfuges artificiels, qui choisissent de descendre «vers le bas», de casser l’image propre inculquée par leurs parents, leur milieu, pour porter le masque des paumés. Alors que pour les transfuges, dont je suis, il n’y a que la possibilité de stagner, ou de tenter un move de libération; devenir une «étudiante de première génération», déménager, essayer n’importe quoi pour ne pas passer sa vie à regretter. Et, une fois rendue, on finit toujours par se faire remettre à notre place, on tolère notre présence, on nous paye des shots et on nous fourre.
Mais qu’est-ce que ça peut ben faire Si j’veux pas vivre la vie de mon père (16)
Tu m’interpelles ainsi: «Je n’ai pas été escorte, je n’ai pas gratté ma peau sur le papier des hommes, je connais ma ouate. Je la détourne quand même avec l’écriture» (17). Pour ton information, la peau des hommes n’est pas faite en papier, peut-être que pour toi elle l’est puisque que tu n’as probablement jamais couché avec des hommes à l’hygiène douteuse pour collecter le cash et aller le boire ensuite. Le seul papier impliqué dans cette opération-là c’est l’argent. Le travail du sexe est un travail concret et physique, il modifie la vie de celles qui s’y accolent. Je suis ravie pour toi que tu n’aies pas à dealer avec les répercussions de la vie d’escorte. Si j’en suis venue à considérer l’option de la prostitution, c’est parce qu’elle faisait partie de mes possibles, être une pauvre petite fille pactée aussi. J’ai eu le choix d’écrire, write or die. L’écriture est le seul lieu où je ne suis pas subordonnée à des oppressions, des dénivellements louches, des rictus exécrés. L’écriture est une option en ce sens qu’elle permet de produire une résistance concrète, de s’inscrire dans l’histoire, de rétorquer.
Tu ne détournes aucunement ta ouate en me shout outtant de la sorte. Tu ne fais que détourner mon vécu, même pas pour discuter de ce qu’est le travail du sexe, des difficultés et des réalités qui lui sont propres. Une phrase pour me mettre à nu, puisque tu sais si bien prendre en charge le débat, et t’en servir comme un exemple d’ouverture et de conscience sociale. Tu as eu le choix, probablement plus que moi, de faire ce que tu voulais dans la vie, tu as la possibilité d’affirmer ta ouate vs ma scarification. Tu choisis de make some noise on my back, et c’est pour moi une responsabilité de répondre à ta lettre publiquement.
Le fossé entre les poor little girls et les filles classes, correctes et souriantes devient de plus en plus étanche, et je pense que les milieux qui nous ont construites diffèrent, ça se lit dans cette correspondance. Nos deux backgrounds n’impliquent pas les mêmes possibilités et conditions d’existence, nos textes l’exemplifient. Ce n’est pas parce que nous sommes deux femmes qui écrivent et boivent que tout nous réunit. Tu supposes que j’ai connu l’alcool tôt dans ma vie, probablement parce que j’ai un rapport virulent à la boisson qui serait l’indicateur d’une consommation précoce:
Je l’ai découvert au secondaire, l’alcool. Pas si jeune, tu me diras. C’était une nuit de la Saint-Jean. Je sais tout de suite que c’est fait pour moi, dès que je pisse dans un buisson du parc Maisonneuve à côté de Félix, à côté du monde entier, je sais que c’est pour moi. Je vais dans ce genre d’école privée où on porte des uniformes et l’alcool aussi en est un, la drogue pareil. C’est comme être dans la gang des Italiens, des geeks ou des blacks à la cafétéria, il y a la gang des buzzés, ceux qui fument des clopes et des joints dans la ruelle pendant les pauses, j’en suis. C’est ça notre uniforme, par-dessus la jupe portefeuille dans laquelle je colle des feuilles blanches avec les réponses de mes examens à l’intérieur, aucun professeur n’aurait eu la folie de dire Qu’est ce que tu caches sous ta jupe, ma p’tite, je sais ça, déjà, je l’ai appris de partout, la mauvaiseté de certains hommes, et moi aussi je sais être mauvaise, j’égrène ma solitude comme un chapelet en cherchant des manières de gagner mon confort dans ce monde de couilles. (18)
L’alcool, comme tu dis, je l’ai d’abord connu de vue, sous sa forme brunâtre, des bouteilles rangées dans la caisse de Laurentide dans le garde manger de la cuisine à côté des cannes de soupe aux tomates Aylmer et des boîtes de petits gâteaux Vachon. Quand ton père boit du rhum dans la cour pendant que tu attends l’autobus le matin, tu as envie de n’importe quoi sauf de te saouler. Tu détestes l’alcool. J’ai été et je suis toujours plusieurs choses, plusieurs femmes. Je me suis responsabilisée jeune parce que lorsqu’on est un enfant de parents alcooliques, on apprend tôt à get our shits together. Ça me révulse et me donne envie de puker que tu te serves de ce rapport à l’alcool comme un pont entre nous deux quand nous ne buvons probablement pas pour les mêmes raisons, dans les mêmes contextes. Ma consommation d’alcool est un fait public, les raisons qui l’engendrent relèvent de la sphère personnelle. L’album Sabotage de Black Sabbath joue toujours en background, la toune «Mégalomania» is ON:
I hide myself inside the shadows of shame The silent symphonies were playing their game My body echoed to the dreams of my soul It started something that I could not control Where can I run to now, the joke is on me No sympathizing God, it’s insanity, yeah
Why don't you just get out of my life, now? Why doesn't everybody leave me alone, now? […] The ghost of violence was something I’d seen I sold my soul to be the human obscene (19)
Mon père est décédé à 72 ans des suites du syndrome du glissement, résultante finale d’une vie d’alcoolisme dont les dernières années furent consacrées à mon éducation – en garde partagée avec ma mère – et celle de ma sœur cadette, avec un revenu d’environ 19 000$ par année. J’ai fait mon secondaire dans une des écoles publiques de la ville de Drummondville, où je ne portais pas d’uniforme. De secondaire un à secondaire trois, j’étais inscrite au programme d’éducation internationale, dont j’ai drop out. Je ne trichais pas dans les examens, j’étudiais, je prenais mon éducation au sérieux, bonne élève mésadaptée, qui skinnais trop de cours pour fuir la bêtise des groupes d’adolescents. En secondaire cinq, je suis allée voir la conseillère en orientation pour mon inscription au Cégep du Vieux Montréal en création littéraire et elle m’a dit que je n’avais qu’à inscrire le revenu de mon parent le plus pauvre dans la demande d’aide financière. J’ai inscrit le revenu de mon père, et j’ai pu étudier à temps plein sans travailler. J’ai fly out à Montréal, puisqu’«[i]l fallait fuir. Mais d’abord, on ne pense pas spontanément à la fuite parce qu’on ignore qu’il existe un ailleurs» (20). L’exil géographique, l’exil culturel, l’exil ou le suicide.
Je ne buvais pas à cette époque, je gérais l’alcoolisme de mes parents. J’ai commencé à boire à 19 ans avec mes collègues téléphonistes à Drummondville, du vin rosé cheap et sucré. L’alcool et la littérature se combinent sur scène, au milieu des autres, quand il faut avoir le guts de lire ce qu’on écrit out loud, avoir le courage d’être transparente malgré le backlash que ça risque d’engendrer. Lana Del Rey chante Life imitates art (21) [citation d’Oscar Wilde], et j’ose croire que ma pratique d’écriture se résume à ce verse. Je ne sais plus si mon écriture imite ma vie, si ma vie crée le texte, au fond l’interpénétration rule le shit, c’est un DP, double penetration, diffraction des événements réels, retranscription constante, scarification textuelle, again & again.
Mes études en littérature me permettent de comprendre les opérations langagières que tu accomplis dans ton travail, mais elles ne m’aident pas à relate quand tu écris:
au début on se touche dans les maisons montréalaises de nos parents qui partent dans leurs chalets « à distance raisonnable », on parle sans cesse, toute la nuit durant, parce que c’est la première fois qu’on se confie sur nos vies mortes, nos parents méchants ou nos peurs les plus violentes, première fois qu’on se raconte avec une sorte de rage mêlée à de l’amour – c’est une affaire d’enfant, c’est de la pure folie. Où étais-tu, toi, à cette époque-là ? À l’époque des raves, le Red Light surtout, à Laval, les chambres d’hôtel, c’est le moment où je commence à fréquenter les dealers, avec eux on ne manque jamais de rien. (22)
Quand j’étais plus jeune, j’avais honte, honte de mes parents en public, honte de ne pas avoir une vie normale, honte de savoir que je ne pourrais jamais me faire passer pour l’enfant prodige inscrite à des cours de violon à cinq ans. On vivait dans une maison qui était un chalet à l’origine, agrandie progressivement par mon père. Personne n’avait de résidence secondaire. Quand j’allais dans la maison de mes amies pour jouer, je comprenais que je n’avais pas rapport là, mais elles me trouvaient drôle et divertissante, je finissais par oublier les cadres dans le sous-sol avec les images des voyages dans le sud des années passées, je finissais par oublier que le plus loin où je m’étais rendue c’était sur la Côte-Nord en visite chez une tante. Ça devait être à l’époque de tes trips de drogue à Laval, je ne sais pas trop.
La honte que j’éprouve, que l’ai souvent transformée en waste, en abus, en vomissures sur la place publique, en overdrama, en action revendicatrice. Je ne l’ai pas souvent nommée. Je ne pensais pas que je pouvais le faire. Je tentais de l’oublier en accédant à des stages supérieurs d’éducation, en déménageant à chaque année, en soupant avec des dudes de seeking arrangement. Essayer de se dire je vaux plus qu’une job de secrétariat en région, je vaux plus qu’une psychose familiale, je trouverai une façon de rembourser les dettes d’études. Ça me purge en tabarnak d’assister à cette confusion totale entre la honte individuelle éprouvée face à une situation personnelle et la honte communément partagée par les individus subissant l’exclusion propre aux classes prolétaires et pauvres.
Les parcours, les difficultés subies systématiquement et systémiquement par les classes prolétaires et pauvres deviennent ainsi l’objet d’une appropriation par des acteurs plus favorisés socialement, qui décident de devenir les défendeurs de la violence subie par les autres. Les drames de ces privilégiés deviennent ainsi plus intéressants, ils prennent le visage de ceux qu’ils étouffent pour finalement parler d’eux à leur place, quand il suffirait seulement de reconnaître qu’ils ne seront jamais confrontés à la même honte, à la même violence, et que de toute façon ils possèdent déjà les outils qui leur permettraient de s’en affranchir ou d’en dévier plus aisément. Cela n’enlève rien à leurs sentiments humains, à leurs difficultés toutes personnelles. Chaque parcours est unique, mais il faut savoir admettre qu’on ne peut appartenir à toutes les classes et être de toutes les batailles. La «ouate» et le «privilège» ne peuvent pas se substituer sur commande pour faire place à la «pauvreté», à une origine «prolétaire».
Certaines croient qu’elles aussi ont droit à leur part de honte, de douleur, de souffrance, qu’après avoir triché au secondaire et avoir eu l’aide financière parentale nécessaire pour aller à l’université sans s’endetter de 20 000 piastres elles méritent leur part du gâteau, leur place dans le débat. Elles croient que personne n’osera les questionner, les replacer, puisque c’est si difficile pour les transfuges de ne pas se saboter, s’auto-exclure, se réduire à néant. Comme si jamais on allait remarquer le subterfuge, le show de boucane intellectuel, le manque d’authenticité dans leurs textes, l’absence de naturel dans leurs performances. Je pourrais utiliser ta formulation et te pasticher; «Vous venez d’Outremont, vos parents vous ont inscrits à l’école privée, vous vous ennuyez, vous cherchez des raisons d’être en criss», cette formule est étrangement proche d’ailleurs, comme le soulignait une femme de mon entourage, de la manière d’Hélène Monette dans Montréal brûle-t-elle (23). Mais ce ne serait qu’un jeu littéraire, qu’un exercice de style ; une autre façon de brasser les cartes en se cachant derrière un «vous» qui ne se commet pas véritablement.
Je ne connais pas ta ouate, et je commence à peine à reconnaître ma garnotte, à force de me la faire remettre dans la face, je finis par avaler, par comprendre que je détonne. As-tu ressenti l’ostracisation perpétuelle par inadéquation sociale, l’auto-exclusion, le manque d’estime, le sabotage personnel? I don’t know. J’imagine que tu as fait le party dans ta jeunesse parce que tu voulais vivre quelque chose d’intense, pendant ce temps-là je regardais mes parents boire et ne pas se coucher, pleurer d’ivresse, parler seuls en fumant des clopes, j’étais le party pooper par excellence. J’ai vécu mon adolescence en retard, j’ai fait le party quand mon père est mort parce que je voulais mourir aussi. Quand le lien est coupé, on se sent encore plus seule dans les couloirs de l’université, on s’ennuie en criss de nos roots inadéquates et prolétaires.
Cette réponse est crue, je sais, je ne suis que La Riendeau, je suis votre drunk ass bitch, la «fille qui a été escorte», la «fille qui a été pauvre et qui le sera toujours», la fille «de Drummondville», la fille qui est trop saoule dans les soirées et qui met tout le monde mal à l’aise dans les lancements, qui trouble si bien l’ordre naturel des choses, les discours rassurants aux tonalités calmes et posées, les bises et les coupes de vins bues juste au bon rythme, la poésie rimée lue par des vieilles femmes fermées d’esprit, les choix logiques et les demandes de bourses dûment remplies, les résidences d’écriture à l’étranger qui finissent en texte sur la «difficulté d’être», l’habitude de ceux qui se savent à leur place dans le milieu et qui nous regardent de haut, qui nous ignorent constamment de leur beau dédain officiel, qui pensent qu’on ne se rend pas compte qu’ils attendent qu’on quitte la pièce pour soupirer, espérant définitivement que nos lubies d’écriture se réduiront à néant lors de notre prochaine épreuve existentielle. Je suis la fille dont on dit «elle va finir par disparaître», «la saveur du mois», la «trash queen future has been». Pour moi, tu es la fille dont la place sera toujours assurée dans cette game-là.
On sait les deux ce que c’est que de commencer à boire et de ne juste pas arrêter, on le sait différemment, comme on sait quand il faut écrire et cracher ce qui est intenable autrement, même si on ne crache pas la même substance. C’est peut-être la chose qui nous rapproche le plus. Si tu craches ton fiel dans tes textes, moi, j’évacue ma bile. Je ne suis pas mère, je n’aurai jamais d’enfant. Je prends la pilule, si je tombe enceinte, j’avorte, je prend les aiguilles à tricoter, je ne me reproduirai pas. Je n’ai pas assez d’amour pour ça, je n’ai pas assez de patience pour ça, je suis trop en criss et je suis épuisée de me faire dire «tu vas voir tu vas changer d’idée».
J’en ai assez donné, du care. J’essaie de me supporter moi-même. Tout ce qui me reste, c’est l’amour pour ceux qui écrivent, qui connaissent les struggles implicites de la création, de la combinaison entre l’écriture et la subsistance matérielle. J’ai care pour mes parents, pour ma sœur, pour mon petit frère, pour mes amis; j’ai care pour mon cul, j’ai passé les dernières années avec un poivre de cayenne dans ma sacoche, des bouteilles de vin de dep dans la récup et des envies de tout démolir, des envies de bailler quand je lis certaines de mes contemporaines, des envies de gueuler quand j’entends les universitaires parler de leurs expériences «difficiles» alors que je n’ose même pas me plaindre et parler de ma vie aux personnes les plus proches de moi. Quand je finis par parler, par donner des détails, on m’accuse de vouloir m’accaparer l’attention, on me demande de me taire et d’écouter les trauma des autres. Soudainement je prends trop de place, mon épistolarité n’est pas assez généreuse, pas assez douce. Je ne serai jamais adéquate, peu importe la posture dans laquelle je me positionne, on me reprochera toujours d’être trop rude, trop directe. Je mets mes tripes dans cette lettre parce que je crois qu’il est nécessaire de répondre à cette exigence dont parle Édouard Louis. Cherchez-vous des bobos tant que vous voulez, sortez vos mots grandiloquents, vos discours de justice sociale pendant que je chauffe ma Chevrolet Malibu broke as fuck, avec l’envie de me crisser dans la rivière Saint-François. Le flow de Cardi B. me sauve le cul, maintient les roues sur le bitume:
They know I'm the bomb, they ticking me off Saying anything to get a response I know that mean they traffic is low Somebody just gotta practice to launch So fuck being tamed, I'd rather be wild (24)
Je n’ai plus rien à perdre, et quand j’écris, je me sacrifie. Je n’ai pas peur de perdre un quelconque capital symbolique, je n’ai pas peur qu’on ne m’invite plus dans les événements, dans les collectifs, je n’ai pas peur qu’on retire mes livres des tablettes, je n’ai pas peur de ne pas avoir de prix littéraires, je n’ai pas peur que mes demandes de bourses soient refusées. Je bois pour m’autodétruire, je bois pour retrouver ce qui a été perdu, j’écris parce que je ne donnerai pas naissance, j’écris pour témoigner, pour ne pas gaspiller. C’est lourd, mais la mort tire vers le bas, deep down, et j’aurais voulu ne pas exposer les faits et gestes qui m’ont menée ici pour que tu comprennes qu’entre toi et moi, il y a énormément de différences. J’aurais voulu parler d’écriture uniquement, mais quand on est hors casting comme moi, on se fait ramener dans la face notre parcours de débauche, nos affects de prolétaires, on oublie les mots. Alors je dois répondre, dire: voici ma vie, voici mes scars, voici pourquoi j’écris, devinez à qui je m’adresse, ce que je dénie. But who cares. Nous sommes distordues et lointaines, c’est ce qui permet une rencontre, une confrontation.
Je rejette l’idée d’une écriture abstraite, coupée du réel, coupée de la main qui l’engendre, je refuse la distanciation intellectualisante, je préfère l’incorporation monopolisante, le déversement des fluides in your face. Je me fous de ce qu’on pense de moi dans les événements, qu’on me trouve déplacée et inconvenante. La seule chose qui me permet de ne pas devenir totalement loko c’est d’écrire. C’est un échange qui permet de toffer la run tant qu’il reste something to say, something to tell, quelque chose à murmurer. J’oppose mon corps et ma parole à ceux qui tentent constamment de policer l’espace public, qui s’auto-censurent par peur de perdre la face. Je suis née un jour d’émeute et j’espère que le jour de ma mort sera révulsif. J’ai assez perdu, j’ai assez capoté pour savoir que rien ne menacera jamais ma liberté d’écriture. Je me fous qu’on me lise vivante ou morte, qu’on prenne mes organes à des fins exploratoires, qu’on fourre mon cadavre,. Il n’y a personne à qui montrer patte blanche. Je n’ai pas d’excuses, sauf celle de l’indignation et du dégoût.
Tu dis que tu n’écris plus de la même façon depuis que tu as donné naissance, depuis que tu a porté un enfant. Je ne connaîtrai pas cette transformation, mais je connais celle du deuil. Je pourrais dire que je ne peux plus écrire comme avant depuis le décès de mon père. C’est une autre forme de naissance, une réappropriation de mes moyens, de mes potentialités. Je ne peux plus qu’être on my own, face to face avec la page. Je ne fais plus d’allers-retours à l’hôpital, de courses à l’épicerie, de ménage dans sa maison; je n’ai plus à le regarder partir en ambulance au milieu de la nuit, je n’ai plus à nettoyer la salle de bain après ses accès de diarrhée incontrôlables.
Puis, il y a l’avancée dans le temps, le problème de la fertilité. Je refuse d’accoucher, je refuse d’engendrer, parce que ça signifierait soumettre un être aux enfermements de la reproduction sociale, aux déjections humaines. Je ne fais pas ça. J’utilise mes organes reproducteurs à des fins récréatives, c’est une forme de sabotage très divertissant. Ce que je choisis d’engendrer, c’est le refus des suites naturelles et aléatoires du fait existentiel. Je suis de celles qui savent que la littérature est une forme de legs, de don de soi, de filiation choisie, et même si ce que j’écris s’avère anecdotique et indiscernable, je préfère prendre le risque de cette scripturalité plutôt que d’expliquer à un enfant pourquoi il faudrait vivre, outre que par obédience à une suite de circonstances matérielles absurdes, insensées, hasardeuses. Mes actions et mes mots sont gouvernés par l’irrévérence et le dégueulis.
On se retrouve dans un renversement étrange, car au fond je suis peut-être plus près de ton enfant que de toi, en ce sens que je ne connaîtrai pas les imbrications d’être mère, je resterai toujours du côté des kids. Je fais partie de ceux qui ont vu leurs parents consommer, ceux qui connaissent plus tôt que les autres enfants les marques de bière vendues au dépanneur, ceux qui décèlent les effets de l’ivresse de façon aussi rigoureuse que le barman le plus expérimenté du quartier, ceux qui savent que les rôles sont inversés. Tu peux parler d’enfantement mieux que moi. J’ai vécu ma parentalité différemment, hors du matriciel.
Tu m’avais mentionné au Cheval Blanc que tu espérais que je ne ponctue pas ma réponse à ta lettre d’anglais. Tu souhaitais probablement que je cesse un instant d’endosser ce personnage de la drunk ass bitch, que je me révèle dans ma fragilité, tu projetais cette attente sur moi. Je me suis ouverte avec les skills que j’ai, en restant real. Tu optes pour une prose durasienne, plus française, tu choisis une écriture qui veut s’élever sans trop se salir les mains, tu joues ton rôle comme je joue le mien. Je cherche ma forme impropre, hybridée, j’écoute XXXtentacion, Post Malone, Jean-Pierre Ferland, Lil (name em all), Corbeau, Van Halen, ça teinte mon écriture. Je fuck le chien de la référence littéraire pure, j’écris comme d’autres rappent, je prends le mic et break mon back, étends mes bones sur la page, je ne sais pas me cacher, je ne sais pas mentir, j’utilise mes influences pour graver noir sur blanc ce qui relève de l’indicible. Quand le beef prendra toute la place, je me convertirai en rappeuse et mon premier verse sera Can you tell where I come from, can you tell.
À ceux qui me demandent où je me vois dans cinq ans, je dis: encore devant cette page, ce livre, ce système de son, cette bouteille de Hennessy, encore en train de rire quand il ne le faut pas, de manger des sandwichs à la baloney aux cerises avec de la mayo Miracle Whip, d’applaudir le malaise, d’enculer le silence, de flasher mes boules, de fuir ceux qui m’empoisonnent par leur petitesse et leur bassesse salement pratico-pratique, et tout le monde connaîtra ma vie, puisqu’elle est si plaisante à dévoiler, qu’il est plaisant de m’apostropher pour me prendre en contre-exemple et me demander où j’en suis dans cette partie de self-marketing de réseautage infini, je dirai que je suis encore cette anarchiste sensuelle qui crache ses gorgées sur ceux qui réduisent la littérature à des élans égotiques, because this is bigger than us, je serai cette old cunt qui croit encore à la communauté artistique, et qui pense que ceux qui ne font pas d’enfants peuvent at least se retrouver entre eux pour se frencher pendant que les parents survivent à la naissance de leur progéniture.
Texte: Emmanuelle Riendeau
- Références: 1 Stéphanie Roussel, Expériences poétiques des micros-libres : enjeux de lecture, enjeux de sociabilité, Mémoire, Maîtrise en études littéraires, Université du Québec à Montréal, 2018. 2 Daria Colonna, «Lettre à la Riendeau», Moebius, Numéro 161, Printemps 2019, p. 95. 3 Daria Colonna, «Lettre à la Riendeau», Moebius, Numéro 161, Printemps 2019, p. 95-96. 4 Édouard Louis, En finir avec Eddy Bellegueule, Paris, Seuil, 2014, p. 95. 5 Ibid., p. 109. 6 Emmanuelle Riendeau, «Même la fée des étoiles boit de la molson», Spirale Web, 12 octobre 2018, http://magazine-spirale.com/article-dune-publication/meme-la-fee-des-etoiles-boit-de-la-molson, consulté en ligne le 12 septembre 2019. 7 Daria Colonna, «Lettre à la Riendeau», Moebius, Numéro 161, Printemps 2019, p. 98. 8 Jules Tomi, Daria Colonna : «La littérature est une discipline du désir», Ricochet, 3 décembre 2018, https://ricochet.media/fr/2443/daria-colonna-la-litterature-est-une-discipline-du-desir, consulté en ligne le 8 septembre 2019. 9 Daria Colonna, «Lettre à la Riendeau», Moebius, Numéro 161, Printemps 2019, p. 96. 10 Ibid, p. 96. 11 Ibid. 12 Black Sabbath, «The Writ», Sabotage, Warner Bros, 1975. 13 Daria Colonna, op. cit., p. 96. 14 Ibid., p. 104-105. 15 Édouard Louis, Qui a tué mon père, Paris, Éditions du Seuil, 2018, p. 23-24. 16 Jean-Pierre Ferland, «Qu’est-ce que ça peut ben faire», Les vierges du Québec, 1974, Audiogram. 17 Daria Colonna, op.cit., p. 96. 18 Ibid., p. 101. 19 Black Sabbath, «Megalomania», Sabotage, Warner Bros, 1975. 20 Édouard Louis, En finir avec Eddy Bellegueule, Paris, Seuil, 2014, p. 165. 21 Lana Del Rey, «Gods and Monsters», Born To Die – The Paradise Edition, Interscope-Polydor, 2012. 22 Daria Colonna, op. cit., p. 101-102. 23 Hélène Monette, Lecture d’extraits de Montréal brûle-t-elle?, Bistro de Paris, Cabaret de la pègre, animé par François Guerrette. Caméra : Gisela Restrepo, 26 mai 2011. Vidéo mise en ligne par Jonathan Lamy, https://vimeo.com/132138602, consulté le 12 septembre 2019. 24 Offset feat. Cardi B., «Clout», Father of four, Quality Control Music, UMG Recordings, INC., 2019.
2 notes
·
View notes
Text
Lettre à Christian Desmeules

par Sara Hébert et Daphné B
Cher Christian Desmeules,
Nous avons ressenti une grande colère en lisant votre critique du livre Chienne de Marie-Pier Lafontaine, une autofiction coup de poing qui retrace une enfance vécue « sous le joug d’un père monstrueux, libidineux [et] violent ». Vous insinuez que l’œuvre « a sa force », mais qu’il s’agit en somme d’un récit « décousu et affaibli ». Selon vous, sa forme segmentée relève « d’une certaine facilité ». À cause de son écriture « par fragments », Chienne serait « un projet inabouti ». Or, il se trouve que cette forme rend mieux que toutes autres formes les expériences traumatiques vécues et racontées par les femmes victimes de violence.
Sachez que bien loin d’être une tare, la forme de Chienne alimente son propos. Rappelez-vous que la mémoire est fragmentaire. C’est d’ailleurs ce que bon nombre d’auteur·trices du 20e siècle se sont évertué·es à souligner depuis les 70 dernières années. De surcroît, le trauma n’est pas linéaire. À ce sujet, Amy Berkowitz écrit dans Tender Points que « L’histoire de [l]a douleur n’est pas facile à raconter. Et je ne parle pas de la difficulté émotionnelle que représente son écriture ; je veux dire que l’intrigue elle-même est déroutante. L’expérience traumatique est non linéaire. On a des flashbacks et on en perd des bouts. » Ainsi, le trauma peut difficilement se représenter dans un récit conventionnel. Ce n’est pas une histoire avec un début, un milieu et une fin. Et c’est précisément ce que nous dit la forme de Chienne : il n’y aura pas de fin. Le trauma se répète, il paralyse, il nous brise en petits morceaux et on ne se « recolle » jamais tout à fait. Voilà l’impact sournois, insidieux et incalculable de l’abus. Ainsi, une narration linéaire n’aurait pas été plus forte; elle aurait tout simplement été incohérente avec le propos.
Votre discours idéologique et gratuit au sujet de l’écriture fragmentaire instaure une hiérarchie factice entre la forme courte (que vous jugez plus facile) et la forme longue. Cela nous rappelle les gamins qui comparent la taille de leur sexe en pensant qu’elle est gage de virilité. Comme l’a si bien expliqué l’autrice américaine Sarah Manguso dans 300 Arguments, le fait d’affirmer qu’une œuvre est « inaboutie et décousue » parce qu’elle n’adopte pas la forme traditionnelle longue, c’est supposer que tous les « morceaux de texte » qui nous sont donnés à lire ont déjà constitué un tout, dans un passé imaginaire. Finalement, le mot fragment est utilisé à tort pour décrire de petits objets, par opposition aux plus gros. Celleux qui l’emploient supposent que les romans sont plus complets, plus vrais, plus entiers que les poèmes, que les formes brèves. Vous confondez le volume d’une œuvre avec son intégrité, comme dirait Manguso.
Le problème, c’est peut-être que Chienne s’inscrit dans un pan de la littérature qui vous est inconnu, ou pour lequel vous avez visiblement des préjugés : c’est un livre féministe. Vous condamnez ce livre, comme vous avez auparavant jugé grossièrement Thelma, Louise et moi, de Martine Delvaux et nombre d’autres livres de nos consœurs.
Nous pensons qu’il est important que vous élargissiez vos horizons de lecture et d’analyse. Nous vous rappelons, comme l’a fait Louky Bersianik avant nous, que votre rôle est de jauger nos œuvres et celles de nos consœurs, c’est-à-dire d’en « prendre la mesure » et non d’y porter vos jugements de valeur. Ainsi, comme Louky Bersianik, nous n’attendons pas de vous que vous encensiez nos livres, mais que vous sachiez vous attarder à ce qu’ils essaient de dire, dans le fond comme dans la forme.
Cela nous semble très maladroit, voire insouciant ou cruel, d’employer le mot « facilité » pour parler du livre de Lafontaine. S’il est à nos yeux ficelé avec justesse et habileté, nous avons peine à imaginer le courage et la difficulté qu’a dû commander l’écriture de ce récit. Nous déplorons que les atrocités et la violence vécues et décrites par l’autrice se retrouvent minimisées par le poids d’un jugement aussi réducteur.
Pour nous, Chienne EST un grand livre qui a nécessité un investissement total et absolu de la part de son autrice. C’est une œuvre aboutie, à l’esthétique percutante, mais jamais choquante. Marie-Pier Lafontaine est notre championne de boxe et elle vient de remporter le plus difficile de tous les matchs : celui où on prend la parole, celui où on dénonce, celui où on refuse de perpétuer le cycle de la violence.
S.H. & D.B
#marie-pier lafontaine#chienne#daphné b#sara hebert#martine delvaux#christian desmeules louky bersianik Sarah Manguso ledevoir
3 notes
·
View notes
Text
Clowne et des poussières - Annab

Je suis clowne. Est-ce par défaut? Est-ce parce que j'ai échoué à être autre chose? Par capitulation? Suis-je une incapable heureuse?
Dans l'imaginaire collectif, le clown est essentiellement triste. S'il se démène, c'est pour créer des diversions. Enserré dans la camisole du cliché, du premier degré et des steppettes à deux piastres, on éprouve aisément de la pitié pour lui, comme une flaque d'eau sur la chaussée.
Mais la flaque d'eau émoustille, avive les sens et écarquille le possible. Elle crée une sorte de ravissement inversé, parfois invitant jusqu'à l'explosion. On retrouve le même phénomène chez les clowns. Le sentiment de pitié touche sans doute à la nécessité d'un événement inouï. Il y a là un appel.
Pareil à un exercice d'incendie qui survient, un jour de ciel bleu pétant à la petite école, les clowns ont la faculté de ravir. De varger dans l'obtus des attentes.
La clowne, c'est l'enfant coupable et broussailleuse. Celle qui te tend une invitation : viens-t'en vite, saute sur ton bécycle, un événement inouï s'amène. L'enfant frétille comme un poisson de rivière. Une minute plus tôt, elle déclenchait l'alarme dans un angle mort du corridor, mais sans arrière-pensée aucune, simplement parce que la couleur rouge de la poignée de métal était irrésistible. Il y a une fanfare de pompiers qui débarque et les nerfs du personnel de l'école ont sorti leur gros attirail. C'est beau à en baver, à s'en rouler par terre, c'est la grosse récolte du rire écarlate. Comme le dit mon amie Shally, les enfants sont des clowns naturels – les uns comme les autres, d'une générosité sans pareille.
*
La clownerie relève [...] d'un savoir-être-défait, et ce savoir même est un non-savoir, quelque chose comme un mystère de l'accident, la foi en je ne sais quelle providence de la déconvenue. [...] Le vrai clown n'est pas seulement non programmable, il est involontaire. Il advient à soi en dépit de soi, comme l'existence elle-même.
- Fabrice Hadjadj (Être clown en 99 leçons. Guide (pas très pratique), essai (raté), récit (peu romanesque). Paris : La Bibliothèque. 2017.)
Je suis clowne, mais je pourrais tout aussi bien dire: « je suis lunatique » ou « je viens de la planète poésie ». D'autres appelleraient ça un trouble de l'attention, un dysfonctionnement social ou un pétage de plomb. Je me laisse entraîner par mes abstractions faramineuses, par ma poésie de clavicule-colère et d'infime panache. Je pars en apprentie spéléologue dans mes grandes chamailles irrationnelles. Je me pitche dans la matière de mes scrupules et je mendie l'espoir à même le tremblement qui m'irrite.
Quand j’étais petite, je rêvais de devenir danseuse, chanteuse, ou bien princesse... comme bien d'autres petites filles ordinaires, en fait. Mais j’étais toujours trop grande, trop bancale; trop ci ou pas assez ça.
- Propos de Anna De Lirium, clowne (de scène) autrichienne, recueilli lors d'une table-ronde au Festival de l'Auguste.
Je pense qu'on devient clown-e quand on tourne le dos à nos ambitions. (Il serait plus juste de dire: les ambitions des autres et celles du siècle, qu'on a intériorisées.) On vire clowne quand on commence à puiser, à même nos maladresses, la promesse d’un jardin. Nos impuissances viennent alors s'auréoler d’un nez de caoutchouc rouge. On abdique, déclarant : « D’accord, oui, je suis une grande innocente. »
Un jour, j’ai arrêté de chercher à être belle. J’ai réappris à grimacer, à m’ensauvager. Je me suis autorisée à pleuvoir, en quelque sorte, avec tout ce que je connaissais de la force désarmante. Quoi que j'y fasse, ma cabane restera croche, habitée de coups de vent. Je m'applique à jouer avec mes fissures comme on joue aux legos ou à cache-cache. Je les assemble; je les prends par surprise. Je les affectionne, même que parfois je les mange. (Car oui, c'est tout l'habitacle de l'âme qui est comestible, y compris les parties ravagées.) Alors là, on dirait que ça m’a sauvée. C'était devenu plus simple d'être aimée.
Bien sûr, il y a des jours où le sens du drame me rattrape au galop. Je deviens monstrueuse tellement je peux stiquer. Chercher la cohérence. Une issue. Me gonfler de colère parce que telle action que j'entreprends ne marche visiblement pas. Me braquer. Prendre mes désirs à la lettre. M'obstiner longtemps avec ma mère qui parle à l'intérieur de moi. M'en tenir à la fonction principale d'un objet. Calculer ce qui manque, méticuleusement. Sculpter le pourquoi du comment dans l'angle fier ma volonté, tête dure.
J’oublie l’élégance du clown, son habileté à l’échec. (Échouer avec élégance, voilà le projet du clown selon Olivier-Hugues Terreault.)
Puis, j’y reviens. Gamine fantasque, délire titanesque. Je ne cadre plus. De nouveau brusque, nerveuse (les mauvais jours) et vigoureuse (les meilleurs), fugitive lorsque ça devient trop laborieux, imprévisible pour de bon. Mes désirs sont obliques, la scène fera feu de tout bois. Je n’officialise plus le territoire de ma douleur. De la fulgurance et du trouble laissés par la sensation de l'échec, je retiens un élan.
*
L'espace scénique rend possible une jouissance imprévisible qui transmet le goût de vivre. Il suggère de jouer avec ses plaies comme avec des poèmes fous furieux. La deuxième phrase n'annule pas la première.
*
Je danse mes petites morts, toutes ces miettes qui autrement cherchent à se battre. Il y a les manuscrits non publiés, les amoncellements de tendresse sous-utilisée et un sens de la panique omnipotent. Je danse dans la barboteuse. Absolument désorientée, mais absolument honnête avec ça. Un jour, j'aimerais glisser mes diplômes dans une bouche d'égout. Je verrais, tiens, mon personnage Boucane réaliser ce tour de malice. Un acte poétique, comme les aime Alexandre Jodorowski.
Comme je l'écrivais dans un poème de boules à mites : Ne m'apaisez plus, laissez frayer le monstre. Apprenez-moi à pleurer devant vous. Je n'ai pas envie de terminer ce texte. Je suis clowne, j'aime la poussière de garnotte.
Texte et image: Annab http://www.lanabclowne.com // www.facebook.com/lanabclowne
2 notes
·
View notes
Text
Extrait de “Humans of Late Capitalism"- Alycia Dufour

sur mon dos
la douceur coule
imperméable à la caresse
mon corps est las dans ses jointures
j’attends encore la permission
pour me glisser
derrière cette peau
*
Ozone-mascara
sur Grande-Allée
tout l’monde tousse creux
une fille attend son drink
un barman l’ignore
les faveurs du temps sont aux peaux les plus lisses
*
le temps
est parti
faire ses courses
et moi
je grelotte
en public
texte: Alycia Dufour / Instagram @clovis.lomoiso.poesie
image: Élise Provencher / http://www.eliseprovencher.com/
1 note
·
View note
Text
De quoi meurt-on à 20 ans?
Merci à toutes les autrices qui ont participé à notre soirée dans le cadre du Festival de la poésie de Montréal. Ce billet est pour celleux qui voudraient en savoir plus sur elles et/ou les lire.
LULA CARBALLO est originaire de l’Uruguay, elle a complété une maitrise en création littéraire à l’UQAM. On retrouve ses poèmes et ses traductions dans les revues Estuaire, Moebius et dans Poesia México-Quebec, tomo 1. Elle travaille comme interprète de l’espagnol au français à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. Elle a récemment publié Créatures du hasard, un très beau récit paru chez Cheval d’août.
https://ici.artv.ca/blogue/lula-carballo-et-ses-creatures-du-hasard/

MARCELA HUERTA est l’autrice de Tropico, publié chez Metatron en 2017. Son travail est paru dans: vallum, Leste, ALPHA, Bad Nudes, Montreal Review of Books, spy kids magazine, CV2, et Lemon Hound. Pour en savoir plus: http://www.metatron.press/alpha/work/marcela-huerta/

LUCILE DE PESLOUAN est autrice et éditrice à Montréal. C’est sous le nom de Shushanna Bikini London, qu’elle a commencé à publier ses textes sous forme de fanzines en 2012. Ses textes sont intimes, directs, poétiques et engagés. Son manifeste féministe Pourquoi les filles ont mal au ventre ? illustré par Geneviève Darling, paru au Québec chez Isatis en 2017, est publié en France, au Canada anglais, aux États-Unis, en Corée, en Espagne et en Amérique du Sud. Elle a également publié Les histoires de Shushanna Bikini London, aux Éditions Rodrigol et J’ai mal et pourtant, ça ne se voit pas… chez Isatis. Écrivaine en résidence pour la revue Moebius, elle écrit aussi pour le magazine Curium et continue toujours de confectionner des fanzines. Plus sur elle ici: http://leseditionsrodrigol.com/html/CMS/index.php?page=lucile-de-peslouean
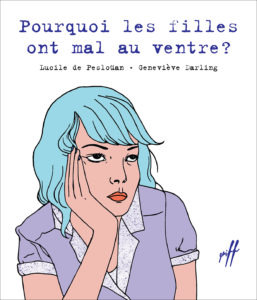
GABRIELLE BOULIANNE-TREMBLAY est écrivaine et comédienne. Reconnue pour son rôle dans le film coup de poing « Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau », elle obtient une nomination aux Prix Écrans Canadiens comme meilleure actrice de soutien: une première pour une femme trans au Canada. Cette aventure l’ammène à Tout le monde en parle pour démystifier la réalité des personnes trans. En 2018 est paru le recueil de poésie: Les Secrets de l’origami chez Del Busso Éditeur. Elle est également une des co-porte parole d'Interligne (anciennement Gai Écoute). Elle est également co-éditrice au côté du romancier et poète Betrand Laverdure de la revue Poèmes pour Saturne et on peut lire son Manifeste de la femme trans qui est publié dans la revue Zinc du mois de mai. Elle travaille actuellement sur un roman d’autofiction. Pour la suivre: https://www.facebook.com/GabrielleBoulianneTremblay/

Kama La Mackerel est écrivaine, poétesse, conteuse, médiatrice culturelle et artiste pluridisciplinaire, basée à tio’tia:ke/Montréal. Son travail explore les pratiques esthétiques comme formes de résistance et/ou de guérison (“healing”) pour les communautés marginalisées. Utilisant la photographie, la poésie, les textiles, la performance et les arts numériques, le travail de Kama est à la fois profondément personnel et politique, articulant une pratique anti-coloniale à travers la production culturelle. Kama est la cofondatrice de Qouleur, un festival annuel d’arts et un espace communautaire pour les personnes queer et trans racisées, et elle est la fondatrice et l’animatrice de GENDER B(L)ENDER, le seul cabaret open-mic queer de Montréal. Kama est née à l'île Maurice et elle a d’abord émigré en Inde avant de s’installer à tio’tia:ke/Montréal en 2012. Kama a récemment lancé Our Bodies, Our Stories, un programme de formations et mentorat en arts et performance pour jeunes personnes queer et trans racisées de 16-24 ans. Kama travaille aussi sur son one-woman show de spoken word. Pour en savoir plus: https://lamackerel.net/

NATALIA HERO est une autrice de fiction et une traductrice basée à Montreal. Son premier roman Hum, est paru en 2018 chez Metatron et sera publié en français, en 2020, par Marchand de feuilles.
Elle a traduit du français vers l’anglais le livre de Laurence Leduc-Primeau À la fin ils ont dit à tout le monde d'aller se rhabiller, In the End They Told Them All to Get Lost chez QC Fiction en 2019. Pour en savoir plus sur elle: https://www.metatron.press/work/hum/

STELA STARCHILD est une artiste à tout faire qui aime les émotions fortes, écrire des horoscopes mièvres et peinturer des objets aux tonalités pastel. Pour la suivre: https://www.facebook.com/starchildstela/

#marcela huerta#lula carballo#lucile de pesloüan#gabrielle boulianne tremblay#kama la mackerel#natalia hero#stela starchild
1 note
·
View note
Text
Limite - Elisabeth Bergeron

Ça y est. 2018, terminé. J'ai survécu. Un gros pet accidentel, dans l’auto. Ne plus y penser. Je porte à ma langue l'élixir floral Folle avoine. D'ici cinq ans, je ne boirai plus. J'ai hâte de tout arrêter. Mon ventre crie au secours. Je suis une guerrière. J'aurais aimé être chanteuse. Entrer, tout bonnement, à la maitrise, en Création littéraire. J'ai médité une heure. Je réalise des choses. Tout s'imbrique. Incroyable. Hier, à l'Urgence, la soudaine sérénité. La jeune femme de dix-huit ans croyait que j'étais la psychiatre. Je stagne comme un crabe, vieux. J'écoute TRST. Ça me fait penser à la cocaïne. Je la déteste. Un peu moins, au huitième verre. C'est désolant. Je suis désolée. La neige éclate. Je vais aller marcher. Toutes ces baises voraces. Ces hommes, que j'ai peur de croiser, sur le trottoir, moite. Ces frissons d'extase, toute sourire, dansante. Après, l'attaque, je suis agonisante. Écervelée. Tant de manteaux fluorescents à franges. Ces appels chez SOS Suicide. La crainte d'être démasquée, reconnue pour ce que je suis. Une bouilloire. Prête à sauter. Rien. Tout. Tout le monde m'adore. Tout le monde me déteste. Cet autre, désiré. Quelques semaines plus tard, le jeter à la dompe. Adorez-moi ou tuez-moi. En temps de crise les veines doivent s'ouvrir. C'est impératif. Soudainement, un chant d'oiseau. Alors sauvée, béante, chaude. Somme toute, précieuse. Un cristal cher ou celle sur qui l'on crache. Étourdissements. Je ne me cache plus. La chimie du cerveau. Le souffle court. Je dis au médecin que j'ai une phobie sociale. Il rit. Phobie sociale? Tu te pavanes au Pérou, putassant. L'amant ne s'attendait pas à ce que je sois aussi aggressive. C'était à même le sol terreux du temple chamanique. Cette sensation. Le vide intérieur. Être la demie d'une personne. Il est grand. Il me pile dessus. Toutes ces années à l'écrire, le trouble. Tout s'arrangera. Mon poids, déreglé par les antipsychotiques. Ne pas y penser. Je serai une personne-ressource. À tout prix, ne plus être la Fille-Missile. Saturée. Respirer à la limite.
Texte: Elisabeth Bergeron Image: Sara H
2 notes
·
View notes
Text
Tentatives roses




Photos par Tentatives Roses (Instagram: @tentativesroses)
1 note
·
View note
Text
Café froid - Anick Arsenault

J’ouvre la porte de la voiture
m’installe au volant
personne sur le banc arrière
ni sur le siège passager
je suis une tasse de café froid*
je vais à la bibliothèque
je prends 20 livres
besoin de vêtements plus grands
plus rien ne me va
ni la famine ni l’injustice ni le racisme
je suis contre tout comme ça pour rien
les gens passent sans s’arrêter
me frôlent sans me remarquer
je suis une tasse de café froid
j’embarque dans ma voiture
je vais faire de la raquette
le soleil descend
les oiseaux tirent sur l’écorce
je m’enfonce dans le bois
je n’ai ni eau ni téléphone et j’ai froid
je marche dans la piste
pendant que les ombres s’allongent
j’ai de la misère à avancer
rebrousse chemin
pour aller boire du vin chaud
je rejoins ma voiture
seule dans le stationnement
j’ai soif tout est figé
fille lourde et seule
à la maison je lis assise
à reprendre des livres
j’effeuille le temps
il ne se passe rien
tout remue mais rien ne se passe
je suis une tasse de café froid
tout bouge dans ma tête
comme sous une croûte de lait tiède
je ne sens presque rien
je suis presque immobile
* Merci Clarice Lispector. Citation originale: Ninguém olhava para ela na rúa, ela era café frió.
Texte: Anick Arsenault Image: laballoune, Instagram
0 notes
Text
appel d’air - Mathilde Contant-Joannin

filles : missing girls manquantes voici le signe de nos vies, notre poésie testimoniale l’amitié au radical
*
tranquillement nous nous déballons parce que personne ne nous a jamais ouvertes bonne fête nous voilà clous du spectacle points sur les i
objets perdus d’avance nous nous sommes trouvées
nos corps flottants dans le web profond la peur s’incruste je crains le pire et le meilleur tu me maries avec le diable pour nous ramener dissoutes sur le rivage de nos pactes
la nuit inspire le froid et les compromis dorénavant nous nous nivellerons par le bas nous ne serons la menace que de notre propre intégrité à l’aube inépuisable la rosée mouillera nos cernes d’une vieille chanson tu la siffleras mettras ton air dans mes poumons nous finirons à la tête d’un trafic de boutures et d’espoir
de la mélancolie germe la crise
-- Texte: Mathilde Contant-Joannin Image: via GIPHY
0 notes
