#guerre d'algérie
Explore tagged Tumblr posts
Text


F.L.N. (National Liberation Front) soldiers, 1954-1962, France - Algerian War of Independence.
#Algerian War#1950s#1960s#france#guerrillas#freedom fighters#الجزائر#حرب الجزائر#independence#wars#war history#Algerian#algeria#Guerre d'Algérie#photography#tumbler#حرب#المقاومة#تاريخ#history
26 notes
·
View notes
Text

turn back the traitors We want to stay in France (OAS,French Algeria 1961)
4 notes
·
View notes
Text
25 septembre : hommage aux harkis
Les harkis sont des Algériens qui ont combattu aux côtés de l’armée française pendant la guerre d’indépendance de leur pays. Certains avait pris en conscience le parti de la France ; d’autres n’ont pas vraiment eu le choix. Capturés les armes à la main, c’était la collaboration ou la mort. À la fin de la guerre, il étaient 210 000, perçus comme des traîtres à leur patrie. En dépit de sa promesse, le président De Gaulle n’en a fait rapatrier que 42 500 (90 000 si ont compte les familles), les autres ont été abandonnés à leur sort, c’est à dire le plus souvent une exécution sommaire. En Algérie, le sujet demeure totalement tabou. Les terroristes et assassins des années 1990 ont été amnistiés, pas les harkis, qui sont toujours victimes de discriminations légales (y compris leurs enfants) et d’insultes régulières de la part des autorités.
En France, beaucoup ont passé des années, voire des décennies, dans des camps : Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), Saint-Maurice-l’Ardoise (Gard), Bias (Lot-et-Garonne) ou dans les 70 hameaux de forestage dans lesquels ils travaillaient pour l’Office national des forêts. Certains vivent encore dans ces camps qui ont été établi pour eux en 1962, après les accords d’Évian.
Pendant quatre décennies, ils ont été totalement oubliés. Après une première loi de reconnaissance des services rendus en 1994, sous le président Mitterrand, Jacques Chirac a reconnu officiellement leur drame et leur sacrifice, c’était le 25 septembre 2000, date qui a été retenue ensuite pour établir une Journée nationale d’hommage aux harkis, en 2003. Une initiative qui les a laissés très insatisfaits car ils attendaient aussi la reconnaissance de l’abandon volontaire dont la majorité d’entre eux ont été l’objet, ainsi que celle de la co-responsabilité française dans les massacres de 1962-1963. Jacques Chirac avait bien reconnu la responsabilité de l’État français dans les déportations de juifs, les harkis n’en attendaient pas moins. Nicolas Sarkozy qui en avait fait la promesse en 2007, ne fera finalement rien. Il faudra attendre, la déclaration du président Hollande en 2015 : « les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis, des massacres de ceux restés en Algérie, et des conditions d'accueil inhumaines des familles transférées dans les camps en France ». Lundi 20 septembre 2021, Emmanuel Macron a demandé pardon aux Harkis et à leurs enfants, annonçant un projet de loi de réparation pour ces Algériens qui ont combattu aux côtés de l’armée française pendant la guerre d’Algérie, entre 1954 et 1962. Celle-ci a été voté en février 2022, juste avant le cinquantenaire du 19 mars 1962. La loi du 23 février 2022 reconnaît la responsabilité de la France dans les conditions indignes du rapatriement et de l'accueil des harkis et de leurs familles, rapatriés d'Algérie après les accords d'Évian de 1962.
La loi ouvre également un droit à réparation pour les harkis et leurs familles qui ont séjourné dans des camps de transit et des hameaux de forestage. Selon le gouvernement, 50 000 personnes pourraient bénéficier de cette indemnisation, pour un montant d'environ 310 millions d’euros sur six ans.
Aujourd’hui, les harkis et leurs descendants représenteraient entre 500 000 et 800 000 personnes en France. Des enfants et même des petits-enfants de harkis continuent de s’identifier comme tels. Leur situation reste difficile, d’autant que le terme « harki » demeure une véritable insulte dans la diaspora algérienne comme elle l’est encore en Algérie.
Des cérémonies d’hommage sont organisées dans la majorité des villes de France chaque 25 septembre.
Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde
0 notes
Video
youtube
Ankylose
#youtube#Cela se passe sur la plage du Havre dans les années soixante au temps de la guerre d'Algérie et du retour de de Gaulle au pouvoir. La pubert
0 notes
Text

Ph. La bouquiniste
Il y a quelques jours en arrière, j'ai mis les pieds pour la première fois dans le Camp de Rivesaltes. Oui, ce type de camp-là. Parce qu'on n' a pas fait que boire du Muscat à Rivesaltes en dansant la sardane, à une trentaine de bornes de chez moi...
Sur ces plus de 600 hectares non clôturés, il y eut d'abord l'armée française, puis les réfugiés espagnols, ensuite les juifs, les gitans, les manouches, les gens du voyage enfin tous ces "indésirables" comme ils se faisaient appeler en transit la plupart du temps vers Auschwitz-Birkenau. Puis à la fin de la guerre, les "collabos" y furent parqués en attendant d'être jugés et pour finir les harkis lors de la guerre d'Algérie.
Toute cette souffrance et toute cette force, ce courage aussi ...
Au bout de plus de deux heures, je ne pouvais plus regarder alors je reviendrai. Plus tard. C'est important pour moi, personnellement, de dévisager chaque être qui s'est battu ici. Chacun, chacune est important. Tous ont une histoire singulière.

Ph. La bouquiniste - Acheté au camp
"Jusqu'ici, nous étions encore des êtres humains. Nous ne sommes plus rien."
P.22
"J'espère que vous ne pensez pas que j'ai exagéré, au moins?"
P.91
Ginette Kolinka "Retour à Birkenau" Livre de Poche




Ph. La bouquiniste - Achetés au camp
8 notes
·
View notes
Text


Le premier uniforme militaire Français n'apparaître que lors de la moitié du XVIIe siècle et il faudra ainsi attendre la personne de François Michel Le Tellier de Louvois pour que l’apparition de l’uniforme militaire obligatoire arrive en France.
Uniforme des Zouaves. Infanterie Légère de l'Armée Français active de 1830 à 1962. Le nom de l'unité provient de la confédération tribale Kabyle du nom de Zouaoua, qui en août 1830 seront recruté par Louis Auguste Victor de Ghaisne, chef de l'Expédition d'Alger, comte de Bourmont suivant les conseils de Louis-Philibert d'Aubignosc. Ainsi, une première unité de 500 Zouaves sera recrutée parmi ceux ayant servi l'Empire Ottoman. Officieusement, cette unité est donc créer en Août 1830, mais ça ne sera que quelque mois plus tard sous la demande du successeur du Comte de Bourmont, le Général Clauzel que le Général Gérard, alors Ministre de la Guerre sera par arrêté, prescrit officiellement la création d'un "Corps d'Arabes Zouaves" répartie en deux bataillons et qui seront placé sous les ordres du Capitaines Duvivier et Maumet. Un des critères est que le soldat doit être tous indigène. En Mars 1831, l'ordonnance royale confirmera bel et bien la création de cette formation, mais aussi de deux escadrons de zouaves à cheval qui seront connus comme les "Chasseurs Algérien", mais elle sera éphémère car intégré dés 1832 aux "Chasseurs d'Afrique". Ils seront finalement dissous en 1962 après le départ de la France d'Algérie.
Uniforme de la Garde de Paris, composante de Garde Nationale Française de 1789 à 1868. La Garde Nationale Française est historiquement l'ensemble des milices de citoyens formées dans chaque commune au moment de la Révolution française, à l’instar de celle de Paris et placés sous le commandement de La Fayette. Cette garde sera créée en même temps que soixante District divisant Paris par l'Ordonnance de Jacques Necker en 1789, résultat d'une convocation des états généraux. Cette unité sera ainsi divisée en soixante bataillons qui porteront le nom de leur district d'origine. Elles ont existé (Garde de Paris et Garde Nationale Française) sous tous les régimes politiques de la France jusqu'à sa dissolution en juillet 1871 (La Garde de Paris ayant été entièrement intégré à la Garde National Français en 1868), aux lendemains des insurrections communalistes qu'elle a soutenues et de la répression de la Commune de Paris. Elle sera une milice citoyenne chargée du maintien de l'ordre et de la défense militaire de Paris, elle sera active dans de nombreuses batailles et sera finalement dissoute après l'épisode de la Commune.
5 notes
·
View notes
Text


Plaque en hommage à : René Coty
Type : Lieu de résidence
Adresse : 5 quai aux Fleurs, 75004 Paris, France
Date de pose : Inconnue
Texte : René Coty, Président de la République, 1954-1959, a habité cette maison avec son épouse Germaine Corblet d'octobre 1936 au 16 janvier 1954
Quelques précisions : René Coty (1882-1962) est un homme politique français, qui fut notamment, de 1954 à 1959, le dernier Président de la Quatrième République. Républicain modéré, il occupe différents mandats avant d'accéder à la magistrature suprême, dont celui de sénateur puis de député de la Seine-Inférieure et de ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme sous la présidence de Vincent Auriol. Élu au terme d'une élection particulièrement longue à laquelle il n'était même pas initialement candidat, il doit cohabiter avec les forces de la SFIO qui ont remporté les élections législatives. Son mandat est particulièrement marqué par la gestion de la Guerre d'Algérie, qui le pousse à faire appel à Charles de Gaulle, lequel lui succèdera en tant que Président de la République. Il meurt d'une crise cardiaque à 80 ans. Il est connu du grand public pour les références incessantes à sa personne dans le film OSS 117 : Le Caire, nid d'espions. Une avenue de Paris porte son nom. Cette plaque commémorative est située en dessous d'une autre honorant le poète Edmond Haraucourt, qui fut contemporain de Coty et mourut dans le même immeuble.
2 notes
·
View notes
Photo

Algérie. Mériem Bouatoura, surnommée Yasmina, combattante de l'ALN (Armée de libération nationale) lors de la guerre d'Algérie, en Algérie, circa 1960
29 notes
·
View notes
Text
(J) DERRIDA.éd_Galilée.2006.(op.cit) 81p:"[...]dans ce qui donne son ton au ton, un rythme.[...]contracté à l'école, ce goût hyperbolique pour la pureté de la langue. Et partant pour l'hyperbole en général. Une hyperbolite incurable. Une hyperbolite généralisée. Enfin, j'exagère. J'exagère toujours." & (81-82p):"parler en bon français, en français pur, même au moment de s'en prendre, de mille façons, à tout ce qui s'y allie et parfois à tout ce qu'il habite. Cet hyperbolisme (《plus français que le français》, plus 《purement français 》que ne l'exigeait la pureté des puristes alors même que, depuis toujours, je m'en prend à la pureté et à la purification en général, et bien sûr aux 《ultras》d'Algérie), cet extrémisme intempérant et compulsif, je l'ai sans doute contracté à l'école, oui, dans les différentes écoles françaises où j'ai passé ma vie. (Tiens, est-ce fortuit, les institutions qui m'ont hébergé, même dans l'enseignement dit supérieur, se sont appelées 'écoles', plus souvent que 'universités')."※
Mais je viens de le suggérer, cette démesure fut sans doute plus archaïque en moi que l'école . Tout avait du commencer avant la maternelle ; il me restait donc à l'analyser plus près de mon antiquité [...]j'ai [..] besoin de me reporter à cette antiquité pré-scolaire pour rendre compte de la généralité de cet 'hyperbolisme' qui auras envahie ma vie et mon travail.(83p)Les choses changèrent plus vite qu'au rythme des générations.[..] Mais il y eut un moment singulier dans le cours de cette même histoire. Pour tous les phénomènes de ce type, la guerre précipite la précipitation générale. [...] la guerre reste un formidable 'accélérateur'.[..] juste après le [D]ébarquement des Allié[(e)]s en Afrique du Nord, en [N]ovembre 1942, on assiste alors à la constitution d'une sorte de capitale littéraire de la France en exil à Alger. Effervescence culturelle, présence des écrivains 'célèbres', prolifération de revues et d'initiatives éditoriales. Cela confère aussi une visibilité plus théâtrale à la littérature algérienne d'expression, comme on dit, française, qu'[eILe] s'agisse d'écrivains d'origine européenne (Camus et bien d'autres) ou, mutation très différente, d'écrivains d'origine algérienne. Quelques années plus tard, dans le sillage [..]de cet étrange [..]gloire, j'ai été comme harponné par la littérature et la philosophie française, l'une et l'autre, l'une ou l'autre 『sugg.: 'l'une <&> l'autre-』: flèches de métal ou de bois, corps pénétrant de paroles enviables, redoutables , inaccessibles alors qu'elles entraient en moi, phrases qu'il fallait à la fois s'approprier, domestiquer, 〔italic;'amadouer'〕, c'est-à-dire aimer en enflammant, brûler[..], peut-être détruire, en tout cas marquer, transformer, tailler, entailler, forger, greffer au feu, faire venir autrement, autrement dit, à soi en soi." & (85p.:) ' Mais le rêve qui devait commencer alors de se rêver, c'était peut–être de lui faire 『arriver』quelque chose, à cette langue.[...]."
#DERRIDA#grammatologie#FLE#francophonie#post_#modernism#philosophy#language#idiom#musicality in speech#Albert CAMUS#minorité francophone#(m)other_tongue
4 notes
·
View notes
Text
Pauline Lecomte : Vous avez publié naguère une biographie intellectuelle consacrée à Ernst Jünger, figure énigmatique et capitale du XXe siècle en Europe. Avant de se faire connaître par ses livres, dont on sait le rayonnement, cet écrivain majeur fut un très jeune et très héroïque combattant de la Grande Guerre, puis une figure importante de la "révolution conservatrice". Comment avez-vous découvert l’œuvre d'Ernst Jünger ?
Dominique Venner : C'est une longue histoire. Voici longtemps, quand j'écrivais la première version de mon livre Baltikum, consacré à l'aventure des corps-francs allemands, pour moi les braises de l'époque précédente étaient encore chaudes. Les passions nées de la guerre d'Algérie, les années dangereuses et les rêves fous, tout cela bougeait encore. En ce temps-là, un autre écrivain allemand parlait à mon imagination mieux que Jünger. C'était Ernst von Salomon. Il me semblait une sorte de frère aîné. Traqué par la police, j'avais lu ses Réprouvés tout en imaginant des projets téméraires. Ce fut une révélation. Ce qu'exprimait ce livre de révolte et de fureur, je le vivais : les armes, les espérances, les complots ratés, la prison... Ersnt Jünger n'avait pas connu de telles aventures. Jeune officier héroïque de la Grande Guerre, quatorze fois blessé, grande figure intellectuelle de la "révolution conservatrice", assez vite opposé à Hitler, il avait adopté ensuite une posture contemplative. Il ne fut jamais un rebelle à la façon d'Ernst von Salomon. Il a lui-même reconnu dans son Journal, qu'il n'avait aucune disposition pour un tel rôle, ajoutant très lucidement que le soldat le plus courageux - il parlait de lui - tremble dans sa culotte quand il sort des règles établies, faisant le plus souvent un piètre révolutionnaire. Le courage militaire, légitimé et honoré par la société, n'a rien de commun avec le courage politique d'un opposant radical. Celui-ci doit s'armer moralement contre la réprobation générale, trouver en lui seul ses propres justifications, supporter d'un cœur ferme les pires avanies, la répression, l'isolement. Tout cela je l'avais connu à mon heure. Cette expérience, assortie du spectacle de grandes infamies, a contribué à ma formation d'historien. A l'époque, j'avais pourtant commencé de lire certains livres de Jünger, attiré par la beauté de leur style métallique et phosphorescent. Par la suite, à mesure que je m'écartais des aventures politiques, je me suis éloigné d'Ernst von Salomon, me rapprochant de Jünger. Il répondait mieux à mes nouvelles attentes. J'ai donc entrepris de le lire attentivement, et j'ai commencé de correspondre avec lui. Cette correspondance n'a plus cessé jusqu'à sa mort.
P. L. : Vous avez montré qu'Ernst Jünger fut l'une des figures principales du courant d'idées de la "révolution conservatrice". Existe-t-il des affinités entre celle-ci et les "non conformistes français des années trente" ?
D. V. : En France, on connaît mal les idées pourtant extraordinairement riches de la Konservative Revolution (KR), mouvement politique et intellectuel qui connut sa plus grande intensité entre les années vingt et trente, avant d'être éliminé par l'arrivée Hitler au pouvoir en 1933. Ernst Jünger en fut la figure majeure dans la période la plus problématique, face au nazisme. Autour du couple nationalisme et socialisme, une formule qui n'est pas de Jünger résume assez bien l'esprit de la KR allemande : "Le nationalisme sera vécu comme un devoir altruiste envers le Reich, et le socialisme comme un devoir altruiste envers le peuple tout entier". Pour répondre à votre question des différences avec la pensée française des "non conformistes", il faut d'abord se souvenir que les deux nations ont hérité d'histoires politiques et culturelles très différentes. L'une était sortie victorieuse de la Grande Guerre, au moins en apparence, alors que l'autre avait été vaincue. Pourtant, quand on compare les écrits du jeune Jünger et ceux de Drieu la Rochelle à la même époque, on a le sentiment que le premier est le vainqueur, tandis que le second est le vaincu. On ne peut pas résumer des courants d'idées en trois mots. Pourtant, il est assez frappant qu'en France, dans les différentes formes de personnalisme, domine généralement le "je", alors qu'en Allemagne on pense toujours par rapport au "nous". La France est d'abord politique, alors que l'Allemagne est plus souvent philosophique, avec une prescience forte du destin, notion métaphysique, qui échappe aux causalités rationnelles. Dans son essais sur Rivarol, Jünger a comparé la clarté de l'esprit français et la profondeur de l'esprit allemand. Un mot du philosophe Hamman, dit-il, "Les vérités sont des métaux qui croissent sous terre", Rivarol n'aurait pas pu le dire. "Il lui manquait pour cela la force aveugle, séminale."
P. L. : Pouvez-vous préciser ce qu'était la Weltanschauung du jeune Jünger ?
D. V. : Il suffit de se reporter à son essai Le Travailleur, dont le titre était d'ailleurs mal choisi. Les premières pages dressent l'un des plus violents réquisitoires jamais dirigés contre la démocratie bourgeoise, dont l'Allemagne, selon Jünger, avait été préservée : "La domination du tiers-état n'a jamais pu toucher en Allemagne à ce noyau le plus intime qui détermine la richesse, la puissance et la plénitude d'une vie. Jetant un regard rétrospectif sur plus d'un siècle d'histoire allemande, nous pouvons avouer avec fierté que nous avons été de mauvais bourgeois". Ce n'était déjà pas mal, mais attendez la suite, et admirez l'art de l'écrivain : "Non, l'Allemand n'était pas un bon bourgeois, et c'est quand il était le plus fort qu'il l'était le moins. Dans tous les endroits où l'on a pensé avec le plus de profondeur et d'audace, senti avec le plus de vivacité, combattu avec le plus d'acharnement, il est impossible de méconnaître la révolte contre les valeurs que la grande déclaration d'indépendance de la raison a hissées sur le pavois." Difficile de lui donner tort. Nulle part sinon en Allemagne, déjà avec Herder, ou en Angleterre avec Burke, la critique du rationalisme français n'a été aussi forte. Avec un langage bien à lui, Jünger insiste sur ce qui a préservé sa patrie : "Ce pays n'a pas l'usage d'un concept de la liberté qui, telle une mesure fixée une fois pour toutes est privée de contenu". Autrement dit, il refuse de voir dans la liberté une idée métaphysique. Jünger ne croit pas à la liberté en soi, mais à la liberté comme fonction, par exemple la liberté d'une force : "Notre liberté se manifeste avec le maximum de puissance partout où elle est portée par la conscience d'avoir été attribuée en fief." Cette idée de la liberté active "attribuée en fief", les Français, dans un passé révolu, la partagèrent avec leurs cousins d'outre-Rhin. Mais leur histoire nationale évolué d'une telle façon que furent déracinées les anciennes libertés féodales, les anciennes libertés de la noblesse, ainsi que Tocqueville, Taine, Renan et nombre d'historiens après eux l'ont montré. A lire Jünger on comprend qu'à ses yeux, à l'époque où il écrit, c'est en Allemagne et en Allemagne seulement que les conditions idéales étaient réunies pour couper le "vieux cordon ombilical" du monde bourgeois. Il radicalise les thèmes dominants de la KR, opposant la paix pétrifiée du monde bourgeois à la lutte éternelle, comprise comme "expérience intérieure". C'est sa vision de l'année 1932. Avec sa sensibilité aux changements d'époque, Jünger s'en détournera ensuite pour un temps, un temps seulement. Durant la période où un fossé d'hostilité mutuelle avec Hitler et son parti ne cessait de se creuser.
Dominique Venner, Le choc de l'histoire (Via Romana, 2011)
15 notes
·
View notes
Text
Eh jcomprends rien du cours d'hggsp sur la partie avec la guerre d'Algérie jpp IL EST OÙ LE FIL DIRECTEUR ?!?!?
Le thème histoire et mémoire va m'achever kdjzlfleb
#seriously#how do we go from a speech from macron to a small timeline to ??? to talking about the evolution of the treatment of the memory of the war#-in both countries#well in both countries mostly france mais bon#the part on ww1 was clearer rip#mes blogs
2 notes
·
View notes
Text
Euh bon, j'ai faillit mourir 2 fois en 48h.
Vendredi la fumée de cacahuètes grillées. Et la nuit de dimanche de fumée d'incendie.
On est allés chez mes grands parents dimanche pour fêter mon anniversaire, ça se passait bien. Avec ma sœur on a traîné un peu, elle s'endort.
1h du mat je vais au toilettes, et au moment de me brosser les dents j'entends un énorme BOUM. Un deuxième. Et au troisième, je descend en trombe avec mon père (réveillé par le bruit).
Dans le salon, mes grands parents paniqués, de la fumée qui sort d'on ne sait où et qui tentent d'ouvrir toutes les fenêtres pour aérer (très mauvaise idée si feu il y a car appel d'air)
On réveille ma mère, mon oncle et ma sœur, l'électricité saute et on sort dehors en veillant à tout fermer derrière.
On a appelé les pompiers qui sont intervenus en 20min (on est au milieu de la campagne en bordure de village).
Au total il y a eu 5 camions et une quinzaine de pompiers. Pas tant que ça de dégâts (enfin si un peu quand même).
Le voisin a pu nous hébergés, et un autre est venu le lendemain pour brancher les congelos au central électrique de la maison de sa mère à côté. (Partie en vacances sinon c'est pas drôle)
Toute la maison est couverte de suie et pue la fumée (probablement des merdes et du plastique).
Après investigation des pompiers c'était le sechoir à champignons (bricolé par mon grand père dans une vieille table de chevet) qui a cramé.
Il y avait la voiture vraiment pas loin des flammes, des bidons d'essence pour la tondeuse à gazon à 2m, et les pompiers ont trouvé in extremis 2 balles de carabine (j'ai plutôt envie de dire des obus) datant probablement de la guerre d'Algérie (brûlantes selon ses dires).
Donc on a échappé à pire.
Heureusement que toute la famille était là ce week-end, car mes grands parents n'auraient pas eu tous les réflexes et lucidité qu'on a eu.
Ils tenaient (pendant et après l'incendie) à retourner dans la maison investiguer, récupérer des affaires durant l'intervention, et surtout NOUS AFFIRMAIENT que "mais non vous exagérez ça sent plus dans la maison et il n'y a pas de suie. On veut dormir dans nos lit" alors que ça puait de l'extérieur.
(Sur la 1ere photo on peut voir les interstices de la porte de garage devenir noires tellement la fumée était épaisse)








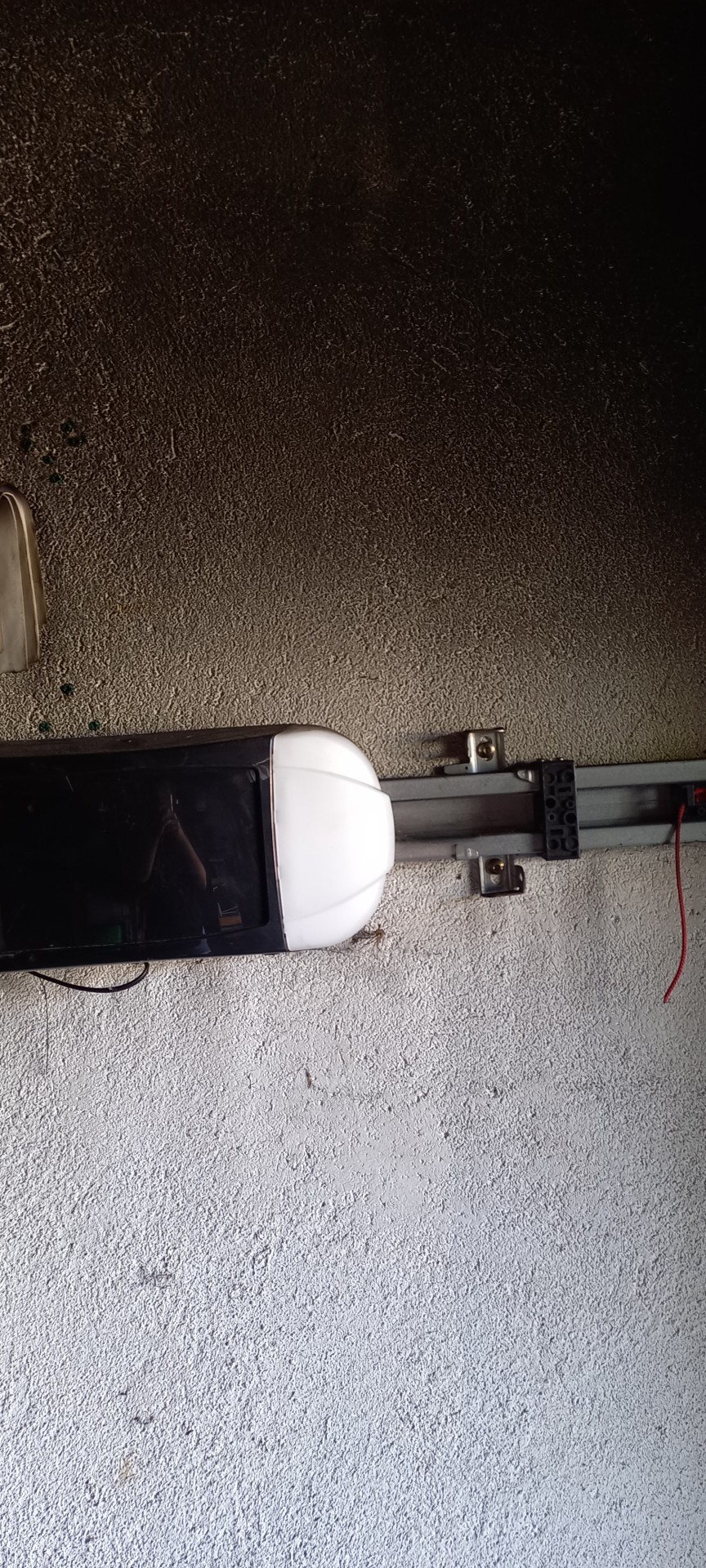

Pour rassurer, tout le monde va bien. Mes grands parents sont un peu chamboulés. Il n'y a que le sous sol/garage qui a cramé (sur 3m²).
Les assurances et techniciens sont tous passés. Encore merci à la quinzaine de pompiers volontaires qui se sont déplacés et au voisin de nous avoir hébergés.
Avec ma sœur on est rentrés en car, elle car elle travaille demain, moi car j'ai les poumons qui me piquent encore. Nos parents et mon oncle restent pour veiller sur nos grands parents et aider à gérer toute la paperasse.
Ce que j'en retiens : Je n'oublierai jamais la semaine de mes 26 ans. J'espère que ça ne présage rien pour mon pvt...
#jezatalks#photo#famille#sorry des fautes de grammaire et ortho#vous pouvez vous en douter j'ai peu dormi#l'état du plafond et des murs#c'est ce qui m'a le plus impressionné#et la suie au sol du garage...#j'ai pas pris de photo du rdc mais il y avait des suies sur tous les meubles#même à l'étage/chambres
4 notes
·
View notes
Text

Biographie.
La première génération de Fhima née à Oran.
C'est mes tantes paternelles. Mon père se pose a coté de ma grand-mère. Il est habillé en costume noir.
Ma grand-mère était de Tlemcen. Issue d'une famille Juive locale. Une juive berbère. Ses origines se perdent dans l'histoire de l'implantation juive en Afrique du Nord.
Mon grand-père né à Tétouan, est arrivé à Oran à l'age de 17 ans - c'était un Juif Espagnol. Sa famille est venue en Algérie fuyant la guerre Maroco-Espagnole. Il est devenu Français par naturalisation individuelle dans le cadre du Sénatus Consulte de 1865.
Il se maria tardivement avec ma grand-mère aux origines sociales modestes, sans se soucier du mépris et de l'incompréhension que ce mariage ci allait générer au-près des autres juifs espagnols d'Oran, qui étaient beaucoup plus familiers avec la culture des Européens présents dans cette ville que les autres Juifs indigènes. Ma grand-mère s'est énormément impliquée dans la francisation de ses enfants, elle supplanta sa langue maternelle l'arabe par le français et la tenue traditionnelle des Juives de l'Oranie par la tenue Européenne. Son idéal était de faire de ses enfants de vrais Français dans le geste et dans le verbe! L'assimilation signifiait pour les juifs de tout rang l’ascension sociale et tourner la page du passé Islamique. L'intégration et la dissolution des Juifs au sein de la population française se faisait a une vitesse qui en a surprit plus d'un. C'était la tendance chez les Juifs d'Oran beaucoup plus marqués par la France que les autres Juifs d'Algérie. L'école républicaine et la volonté des Juifs à être de Parfait citoyens Français finit par résulter. Dés lors toutes les générations Fhima nées sur le sol algérien étaient pleinement françaises de droit et de culture.
La totalité de la famille Fhima d'Oran qui venue du Maroc pour s'installer en Algérie est rapatriée en France en 1962 à la fin de la guerre d'Algérie comme tous les autres Pieds-Noirs. Les descendants de ces Juifs français d'Oran vivent désormais en métropole et un peu partout dans le monde notamment en Israël, au Canada, et en Amérique Latine. C'est la biographie d'une famille qui s'est inscrite dans l'histoire d'un peuple sans terre pour une terre sans peuple. C'est l'histoire du peuple juif.
0 notes
Video
youtube
Viols pendant la guerre d'Algérie, un scandale occulté • FRANCE 24
0 notes
Text

Biographie :
Mostefa Ben Boulaïd est né le 5 février 1917 à Arris au sein d'une famille chaouia aisée des Aurès, région montagneuse du nord est algérien. En 1939, il accomplit le service militaire obligatoire et est mobilisé durant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la campagne d'Italie, en 1944, il se distingue par son courage, ce qui lui vaut la médaille militaire et la croix de guerre.
Démobilisé au grade d'adjudant, il regagne sa ville natale, il milite dans les rangs du Parti du peuple algérien (PPA). Il joue un rôle important dans l'Organisation spéciale (Algérie) l'(OS), à l'intérieur de laquelle il mène une intense activité de formation politique et militaire des jeunes. Il commence à se procurer des armes en les achetant avec ses propres deniers et participe à l'hébergement des militants pourchassés par les autorités. Il supervise personnellement la distribution des armes à ces militants. En 1948, il participe aux élections de l'Assemblée algérienne et obtient une large victoire. Cependant, les résultats sont falsifiés par les autorités françaises.
Membre du comité central du PPA-MTLD. Il rompt avec les membres de ce comité lors de la crise qui a opposé les centralistes à Messali. Il est l'un des fondateurs du Comité révolutionnaire d'unité et d'action (CRUA). Il préside la « réunion des 22 » du 25 juin 1954 à Alger, qui vise à établir une vision uniforme autour de la question du déclenchement de la lutte armée. Il est responsable de la zone I des Aurès, lieu qui mobilise fortement l'armée française et connu pour avoir payé un lourd tribut pendant la guerre d'Algérie. Il est l'un des membres du « Comité des six » chefs insurrectionnels. Il est à la direction des opérations du déclenchement de la Guerre d'Algérie du 1er novembre 1954 dans la région des Aurès.
En 1955, il se rend en Libye pour approvisionner les militants en armes. Il participe aux deux batailles d’Ifri el blah et Ahmar Khaddou.
Il est arrêté le 11 février 1955 en Tunisie et est condamné à mort par le tribunal de Constantine, puis emprisonné à la prison centrale de Constantine. Il s'en évade en novembre 1955 avec plusieurs autres détenus dont Tahar Zbiri et ce grâce à la complicité d'un gardien de prison, Djaffer Chérif, issu de sa région natale. Au cours de cette évasion un de ses compagnons chute, se blesse et sera par la suite guillotiné.
Mostefa Ben Boulaïd décède le 22 mars 1956 avec Abdelhamid Lamrani — un de ses proches collaborateurs — dans le maquis à la suite d'une explosion durant une réunion à laquelle prenaient part plusieurs chefs de maquis.
1 note
·
View note
Text

La municipalité de Nommay et les Anciens Combattants invitent le jeudi 5 décembre 2024 à 16h00 pour commémorer la Journée nationale d'hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, devant le parking du lavoir. infos > www.nommay.fr Read the full article
0 notes