#déterministe
Explore tagged Tumblr posts
Text
Libre arbitre ou interdépendance ?
Hand touching virtual world with connection network. Global data information and technology exchange. Nous avons du contrôle sur quoi ? Notre naissance ? Non. Notre culture d’origine ? Non. On pourrait penser que je suis déterministe, c’est-à-dire que je ne crois pas que nous ayons réellement un libre arbitre. Je me définis comme quelqu’un qui trouve du sens à la notion d’interdépendance…

View On WordPress
#voie de passage#c ontrôle#choix#déterministe#humanité interépendance#interdépendance#interdépendance conditionnée#liberté#libre arbitre
0 notes
Text
"Jamais je n'oublierais son corps, sa peau ni son visage, et jamais je n'avais non plus ressenti avec autant d'évidence que les relations humaines naissent, évoluent et meurent de manière parfaitement déterministe, aussi inéluctable que les mouvements d'un système planétaire, et qu'il est absurde et vain d'espérer, si peu que ce soit, en modifier le cours."
– La Possibilité d'une Île
11 notes
·
View notes
Text

Les musulmans préfèrent Dubaï à La Mecque. La mondialisation en a fait des zombis à l’image des occidentaux. On pourra leur ôter comme à nous le «trouble de penser et la peine de vivre». Guénon s’est trompé comme Nietzsche et tous ceux qui sont assez lunatiques-sic pour annoncer de grandes choses (par exemple le transhumanisme). Seul Tocqueville aura été implacable et déterministe jusqu’au bout. L’Etat et le confort détruisent tous les hommes.
Nicolas Bonnal
3 notes
·
View notes
Text

Le cycle sisyphéen des paniques technologiques
L'article The Sisyphean Cycle of Technology Panics explore les paniques récurrentes face aux nouvelles technologies, un phénomène historique qui se répète depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, concernant des outils aussi divers que l'écriture, la radio, la télévision et les médias sociaux. Ces paniques, motivées par des craintes pour la jeunesse et la société, sont alimentées par des perceptions déterministes de la technologie et des réactions morales amplifiées par des figures d'autorité.
Points principaux :
Cycle historique : Chaque nouvelle technologie suscite des craintes similaires, centrées sur ses effets perçus sur la santé mentale, les comportements sociaux et les valeurs morales, notamment pour les enfants et adolescents.
Rôle des sciences : Les chercheurs, souvent sollicités par les politiques, redémarrent leurs investigations pour chaque nouvelle technologie, faute de cadre théorique unificateur. Cela engendre des recherches répétitives, peu efficientes, et parfois en décalage avec les besoins politiques et sociétaux.
Enjeux politiques : Les panique technologiques servent souvent d’outil aux politiciens pour démontrer leur engagement, détourner l'attention des enjeux complexes et justifier des interventions parfois inefficaces.
Absence de consensus scientifique : Le manque de cadre théorique cohérent conduit à des débats méthodologiques et des résultats conflictuels, ralentissant l’élaboration de politiques informées.
Adaptation lente aux innovations rapides : Les changements technologiques rapides rendent difficile une régulation efficace et en temps voulu.
0 notes
Text
L'Accident
La Solution finale, c'est la mort.
La mort est l'eros à l'envers.
« Si l’on envisage globalement la vie humaine, elle aspire jusqu’à l’angoisse à la prodigalité, jusqu’à la limite où l’angoisse n’est plus tolérable. Le reste est bavardage de moraliste… Une agitation fiévreuse en nous demande à la mort d’exercer ses ravages à nos dépens. »
« La mort et la sexualité, au lieu de s’affronter comme principes antagonistes (Freud), s’échangent dans le même cycle, dans la même révolution cyclique de la continuité. »
« Pas de différence entre la mort et la sexualité. Elles ne sont que les moments aigus d’une fête que la nature célèbre avec la multitude inépuisable des êtres, l’une et l’autre ayant le sens du gaspillage illimité auquel la nature procède à l’encontre du désir de durer qui est le propre de chaque être »
« La mise à nu érotique est égale à la mise à mort, dans la mesure où elle inaugure un état de communication, de perte d’identité et de fusion. »
« Procréer, c’est susciter la génération suivante qui innocemment, mais inexorablement, repousse la précédente vers le néant… »
L’accident et la catastrophe
« Il y a un paradoxe de la rationalité moderne et bourgeoise sur la mort. Concevoir celle-ci comme naturelle, profane et irréversible constitue le signe même des « Lumières » et de la Raison, mais entre en contradiction aiguë avec les principes de la rationalité bourgeoise — valeurs individuelles, progrès illimité de la science, maîtrise de la nature en toutes choses. Neutralisée comme « fait naturel », elle devient aussi de plus en plus un scandale. C’est ce qu’Octavio Paz a très bien analysé dans sa théorie de l’Accident (Conjonctions et Disjonctions) : « La science moderne est venue à bout des épidémies et nous a fourni des explications plausibles des autres catastrophes naturelles : la nature a cessé d’être la dépositaire de notre sentiment de culpabilité ; en même temps la technique a étendu et élargi la notion d’accident, et lui a conféré un caractère tout à fait différent… L’Accident fait partie de notre vie quotidienne et son spectre hante nos insomnies…
Le principe d’indétermination en physique et la preuve de Gödel en logique sont l’équivalent de l’Accident dans le monde historique…
Le principe d’indétermination en physique et la preuve de Gödel en logique sont l’équivalent de l’Accident dans le monde historique… Les systèmes axiomatiques et déterministes ont perdu leur consistance et révèlent une faille inhérente. Cette faille n’en est pas une en réalité : elle est une propriété du système, quelque chose qui lui appartient en tant que système. L’Accident n’est ni une exception ni une maladie de nos régimes politiques, il n’est pas non plus un défaut corrigible de notre civilisation : il est la conséquence naturelle de notre science, de notre politique et de notre morale. L’Accident fait partie de notre idée du Progrès… L’Accident est devenu un paradoxe de la nécessité : il possède la fatalité de celle-ci et l’indétermination de la liberté. Le non-corps, transformé en science matérialiste, est synonyme de la terreur : l’Accident est un des attributs de la raison que nous adorons… La morale chrétienne lui a cédé ses pouvoirs de répression, mais en même temps toute prétention morale a disparu de ce pouvoir surhumain. C’est le retour de l’angoisse des Aztèques, quoique sans présages ni signes célestes. La catastrophe devient banale et dérisoire, parce que l’Accident, en fin de compte, n’est qu’un accident. »
« Comme la société en se normalisant fait surgir à sa périphérie les fous et les anomaliques, ainsi en s’approfondissant la raison et la maîtrise technique de la nature font surgir autour d’elles la catastrophe et la défaillance comme irraison du « corps organique de la nature » — irraison insupportable, car la raison se veut souveraine et ne peut même plus penser ce qui lui échappe — insoluble car il n’y a plus pour nous de rituels de propitiation ou de réconciliation : l’accident, comme la mort, est absurde, un point c’est tout. C’est du sabotage. Un malin démon est là pour faire que cette si belle machine se détraque toujours.
Ainsi cette culture rationaliste est-elle atteinte, comme nulle autre, de paranoïa collective. Le moindre incident, la moindre irrégularité, la moindre catastrophe, un tremblement de terre, une maison qui s’effondre, le mauvais temps — il faut qu’il y ait un responsable — tout est attentat. »
« Car nul ne sait jusqu’où la « pulsion de mort », amorcée par l’accident ou la catastrophe, peut se déchaîner à cette occasion et se retourner contre l’ordre politique. »
« Il est remarquable que nous soyons revenus, en plein système de la raison, et en pleine conséquence logique de ce système, à la vision « primitive » d’imputer tout événement, et la mort en particulier, à une volonté hostile. Mais c’est nous, et nous seuls qui sommes en pleine primitivité (celle justement dont nous affublons les primitifs pour l’exorciser), car cette conception chez les « primitifs » correspondait à la logique de leurs échanges réciproques et ambivalents avec tout ce qui les entourait, si bien que même les catastrophes naturelles et la mort étaient intelligibles dans le cadre de leurs structures sociales — alors que chez nous elle est franchement paralogique, c’est la paranoïa de la raison, dont les axiomes font partout surgir l’inintelligible absolu, la Mort comme inacceptable et insoluble, l’Accident comme persécution, comme résistance absurde et méchante d’une matière, d’une nature qui ne veut pas se ranger sous les lois « objectives » où on l’a traquée. D’où la fascination toujours plus vive pour la catastrophe, l’accident, l’attentat : c’est la raison elle-même traquée par l’espoir d’une revanche universelle contre ses propres normes et ses propres privilèges. »
« Nous sommes tous des otages, c’est là le secret de la prise d’otages, et nous rêvons tous, au lieu de mourir bêtement à l’usure, de recevoir la mort, et de donner la mort. »
La mort vient punir la culpabilité impardonnable
« Le désir de tuer coïncide souvent avec le désir de mourir soi-même ou de s’anéantir » — « l’homme désire vivre, mais il désire aussi n’être rien, il veut l’irréparable, et la mort pour elle-même. »
Le poétique, c’est l’insurrection du langage contre ses propres lois.
— L'échange symbolique et la mort, Jean Baudrillard

EDIT - 16/11/24 (pour toi)
0 notes
Text
Quel est le point commun entre les gènes et les mèmes ? À un degré d’abstraction suffisante, ils sont tous les deux de l’information. C’est-à-dire qu’ils vont mettre en forme une entité. Autrement dit, l’information ne peut pas être strictement séparée de la matière puisqu’elle va justement mettre en forme cette matière et n’aurait aucun sens sans elle. Les gènes donnent la forme d’un organisme et les mèmes donne la forme d’une culture. Un organisme et une culture peuvent alors être vus comme des systèmes cybernétiques qui vont traiter l’information. Il existe cependant deux écueils à éviter quand il est question de cybernétique.
Premièrement, il serait faux d’imaginer, comme le font souvent les nerds, que la cybernétique ne s’applique qu’à des systèmes informationnels virtuels. La cybernétique est en fait la science du comportement d’un système qui va acquérir de l’information sur lui-même lui permettant de réduire son entropie et elle est évidemment pertinente pour tout système du monde matériel.
Deuxièmement, il serait réducteur de concevoir la cybernétique comme un système déterministe se contentant d’effectuer des tâches prédéfinies, ou un système conservateur cherchant seulement à maintenir une homéostasie. Un système cybernétique est en fait producteur d’information, de singularité faisant apparaître de nouvelles entités dans le monde.
Produire de l’information sur lui-même, cela rejoint l’idée du “connais-toi toi-même” de Socrate, mais surtout, en considérant l’aspect productif conduisant au dépassement, la cybernétique devient une lentille épistémologique idéale pour penser ce que les Grecs nommaient la phusis (φύσις), souvent traduit par “nature”. Le terme phusis désigne l’ensemble des caractéristiques essentielles et intrinsèques des êtres et des choses, ainsi que le principe de leur croissance et de leur développement. Dans la philosophie antique, la phusis est souvent étudiée pour comprendre les lois fondamentales et les processus naturels du monde.
Nimh
0 notes
Text
Pierre Guillaume de la Vieille Taupe et l’antisémitisme

Extrait du livre Les « antisémites » de gauche de Roland Gaucher et Philippe Randa paru en 1998, et repris sur le site d’Arthur Sapaudia.
***
Nous avons demandé à Pierre Guillaume un point de vue plus complet sur ses activités, aussi nous a-t-il fait parvenir la réponse ci-après que nous reproduisons intégralement.
***
Messieurs,
Vous me demandez si j’accepterais de répondre à vos questions dans le cadre d’un livre que vous envisagez sur « L’antisémitisme et la gauche ». Le sujet est effectivement très important et il règne dans ce domaine une désinformation totale. Mais il serait peut-être nécessaire de s’interroger préalablement sur ce que signifient ces deux mots : « antisémitisme » et « gauche ».
Le judaïsme, en tant que religion mono-ethnique du peuple hébreu, puis « les Juifs », ont fait l’objet de critiques de tous ordres et de toutes natures, et le peuple d’Israël, dans sa longue histoire, a rencontré l’adversité sous des formes très diverses […].
Amalgamer toutes les critiques de diverses natures, et toutes les adversités qu’ont pu rencontrer les Juifs sous le vocable d’antisémitisme constitue une escroquerie intellectuelle, à laquelle se livrent allègrement non seulement les zélotes du sionisme, mais une bonne partie des Juifs de toutes tendances, au point d’avoir réussi à créer un climat intellectuel irrespirable, puisqu’il est devenu maintenant pratiquement interdit d’évoquer tel ou tel aspect du judaïsme, ou telle pratique juive, ou telle personnalité juive autrement que laudativement, sous peine d’être suspecté d’antisémitisme. La construction du mot lui-même est absurde. Il existe un ensemble de langues sémitiques comme l’hébreu, l’arabe, et diverses langues du Moyen-Orient ancien, comme l’araméen. Il n’existe pas de peuples sémites qui puissent correspondre à une entité identifiable, en dehors des peuples d’origines ethniques et historiques très diverses qui parlent des langues sémitiques.
Mais le mot a été créé en Europe au XIXe siècle pour désigner spécifiquement une attitude d’hostilité envers les Juifs, dont plus aucun, en dehors d’une très petite minorité de rabbins, ne parlait l’hébreu. De plus, dans l’ambiance des débuts de l’anthropologie au XIXe siècle, la science était « raciste », unanimement « raciste ». Ce qui ne doit pas être interprété à travers les fantasmes hystériques de l’idéologie « antiraciste » actuelle, mais signifie simplement que, confronté à l’extraordinaire diversité humaine, la science d’alors affirmait l’unité de l’espèce, et tentait de rendre compte néanmoins de la diversité, le polymorphisme humain comme on dit maintenant, par le concept de « race », dont on a cherché à préciser les contours de toutes sortes de manière, en privilégiant d’abord l’anthropologie physique.
L’ambiance scientiste, matérialiste, déterministe de l’idéologie scientifique de l’époque conduisait tout naturellement à rechercher aussi dans le substrat biologique (la race) l’explication des non moins extraordinaires diversités culturelles et de civilisation. Cette ambiance « raciste » dominait donc à l’époque où commençait à se manifester un mouvement d’hostilité d’une nature nouvelle à l’égard des Juifs. Le mot « antisémitisme » a été créé pour désigner ce mouvement-là à cette époque-là. Les causes de la montée d’une hostilité à l’égard des Juifs à ce moment-là sont de natures très diverses, et j’incline à croire que la prétendue race des Juifs n’était pas la cause opérante du conflit, mais l’explication « raciste » de cette hostilité caractérise et différencie nettement le mouvement « antisémite » qui culmine avec l’hitlérisme, des autres formes de critique du judaïsme et d’hostilité à l’égard des Juifs.
La différence essentielle tient tout simplement au fait que personne n’est responsable de sa « race », et personne ne peut en changer. Cette interprétation raciste des sources de la conflictualité débouche soit sur une politique de statut différencié, soit sur une politique d’apartheid, soit sur une politique d’expulsion, soit sur une politique d’extermination, selon l’intensité et la radicalité de l’antagonisme. Ce qui n’est nullement le cas de l’antijudaïsme chrétien, à l’intérieur duquel il faut distinguer l’antijudaïsme catholique, qui, tout au contraire, a toujours entretenu des relations extrêmement complexes avec le judaïsme, et a protégé les juifs, y compris pendant la Deuxième Guerre mondiale des persécutions que les juifs suscitaient et subissaient pour toutes sortes de causes et de raisons.
Pour des raisons évidentes, la propagande sioniste tire un avantage majeur d’un amalgame de toutes les formes d’antijudaïsme avec l’antisémitisme raciste. D’abord cela lui permet de développer une vision de l’histoire juive, complètement paranoïaque, où les Juifs sont les perpétuelles victimes innocentes d’un ostracisme universel qui débouche inéluctablement sur leur persécution et sur leur extermination. La constitution d’un État juif, nécessairement surpuissant pour ne pas dire tout puissant, devient la seule solution pour sauver les Juifs du génocide qui les menace. Puis dans un deuxième temps, il faudra organiser à l’échelle mondiale la chasse et l’extermination des criminels contre l’humanité, qui ne comprennent pas que l’alpha et l’oméga de la politique mondiale doit consister avant tout à protéger les Juifs… de leur propre fantasme !
C’est bien là le mensonge idéologique parfait : le mensonge qui créé par lui-même les conditions de sa propre vérification ! (Comme souvent les délires paranoïaques !)
Cela permet surtout à la propagande sioniste de stigmatiser tous ses adversaires comme de prétendus « racistes », de mobiliser sous sa direction toutes les victimes ou prétendues victimes du « racisme » ; et cela permet surtout de culpabiliser, de déboussoler et de déstabiliser ceux qui sont victimes de cette accusation. À partir des années trente, avec la fondation par Bernard Lecache de la LICA (qui deviendra la LICRA), l’antiracisme deviendra le fond de commerce de tous les activismes juifs, et du plus important d’entre eux : le sionisme. On retrouve pareillement des activistes juifs derrière la création du MRAP, de SOS racisme et derrière la mise en spectacle systématique du « racisme des Français » dans tous les médias. Il existait même à la fin des années soixante-dix, une section du Betar spécialement destinée à faire monter cette mayonnaise-là. Dans toute cette agitation « antiraciste », les Arabes et les Antillais n’ont jamais eu qu’un rôle de figurants, ou pour certains d’idiots utiles, et de goyim du Shabbat, tant cet « antiracisme » n’a rien à voir avec une lutte réelle contre des préjugés raciaux ou une discrimination réelle, mais ne sert essentiellement qu’à pourchasser des adversaires, accusés de « racisme », c’est-à-dire non pas de pratiques ou de comportements discriminatoires, mais de crime de la pensée par non-conformisme idéologique.
Il n’est d’ailleurs pas nécessaire de développer ce point puisque c’est dans cette ambiance idéologique qu’a été élevée toute la nouvelle génération, depuis une trentaine d’années : les Juifs ont été victimes du « racisme » et sont à la pointe de la lutte contre le « racisme ».
Mais à y regarder de plus près, le sionisme politique, né à la fin du XIXe siècle, comme ses ancêtres religieux messianiques, réclamait également une politique de séparation et d’apartheid. Le judaïsme, tel qu’il se dévoile dans la Torah, est fondamentalement et radicalement raciste, et fait de l’extermination des ennemis d’Israël un devoir sacré ! La fête religieuse la plus populaire parmi les Juifs, la fête de Pourim, célèbre et commémore le massacre (mythique) systématique des ennemis d’Israël, accusés (déjà) d’avoir voulu exterminer les Juifs. Comparé au racisme incandescent qui s’exprime dans la Torah, au bellicisme, au terrorisme systématique qui y sont revendiqués, et dont le seul critère moral est le triomphe et la gloire d’Israël, le Mein Kampf de Hitler apparaît bien modéré… C’est évidemment la chose qu’il ne faut pas dire… mais qu’il est aisé de vérifier par une lecture attentive de La Bible et de Mein Kampf.
D’ailleurs, à l’origine du sionisme, dans le yiddishland germanico-russo-polono-ukrainien d’Europe centrale, le mouvement sioniste naissant se définit lui-même comme un mouvement « « völkisch » . Ce mot en allemand signifie « du peuple » ou « populaire » (Volk = le peuple), mais avec la connotation culturelle allemande de ce mot, différente de la connotation française. Le mot peuple est pris dans son acceptation ethnique et naturaliste. Dans Mein Kampf, Hitler définit également son mouvement comme un mouvement « völkisch ». Mais la traduction française, (financée avant-guerre par la LICRA aux Éditions Sorlot, devenues Nouvelles Éditions Latines, donc l’édition actuellement disponible) traduit völkisch par « raciste ». Mais quand il s’agit de traduire les textes des précurseurs sionistes, le mot völkisch est simplement traduit par « populaire » ou « du peuple ». On évite soigneusement d’utiliser le mot « raciste ».
Le judaïsme en général et le sionisme tout spécialement sont parvenus à dissimuler au public les conceptions profondément racistes qui les animent en profondeur, dans un effort de dénégation remarquable, et en prenant la tête de l’idéologie antiraciste. « Ce n’est pas moi qui suis raciste proclame le judaïsme, c’est Hitler qui me contraint de l’être ! » L’antiracisme judaïque débouche dès lors sur une impasse, et cette rhétorique a permis de justifier toutes sortes de pratiques profondément racistes et agressives dont la situation en Palestine actuellement est la résultante et le révélateur.
Force est de constater que, depuis 1945, cette rhétorique a parfaitement fonctionné, et le judaïsme s’est acquis une véritable juridiction morale, et même une juridiction légale, dont le procès Papon est la dernière manifestation. Le génocide-Holocauste-Shoah est le seul événement de toute l’histoire de l‘humanité qui soit dogmatiquement affirmé par la loi. Et les ligues commémoratives ont le pouvoir sans précédent d’accuser rétroactivement. Jadis on apprenait l’histoire sainte au catéchisme et l’histoire à l’école. Désormais c’est à l’école laïque que l’on apprend l’histoire sainte des Hébreux, et l’extermination des Juifs à Auschwitz a remplacé comme événement fondateur de l’ère nouvelle (postmoderne disent-ils) la mort du Christ sur la croix.
La droite en général a été d’abord la principale victime de cette instrumentalisation de l’accusation d’antisémitisme à tort et à travers. On comprend donc la réaction pour un homme de droite qui consiste à dire « C’est pas nous, c’est la gauche », ce qui, historiquement, n’est pas faux, mais cette réaction, compréhensible, a l’inconvénient de constituer l’antisémitisme en référent, à l’aune duquel chacun doit être jugé, et sans s’interroger sur la signification de ce mot. « L’antisémitisme », ce serait le mal qui relève d’une pulsion irrationnelle, injustifiée, injustifiable, voire pathologique. Or, ce mot en lui-même est un mot valise, et le contenu de la valise est piégé. Pour la raison que j’ai déjà indiquée, ce mot réalise l’amalgame de toutes les oppositions, obstacles, critiques, persécutions, injustices ou atrocités auxquelles les Juifs ont eu à faire face.
Mais le judaïsme, la religion juive, proclame que Dieu, dans une sorte de contrat synallagmatique, a promis au peuple d’Israël, en échange de sa soumission et de l’accomplissement des mitsvot, qu’il finirait, au terme de l’histoire, par exercer sa domination mondiale. L’histoire, qui voit la chute, et la destruction successive de toutes les nations et de tous les empires, dans sa dialectique, assure et réalise le triomphe final d’Israël, les temps messianiques.
Le projet messianique dont le peuple juif est porteur, disent les rabbins, est un projet explicitement politique, mondial et historique. La nation juive est la nation prêtre, la nation pédagogue, destinée à accomplir l’humanité par sa propre domination religieuse, et donc la domination d’une religion qui ne fait pas la différence entre le religieux et le politique !
Il existe certes d’autres interprétations judaïques de la Bible et de la mission historique théocratique du peuple juif, mais ce raccourci extrême et brutal correspond effectivement à l’interprétation sioniste majoritaire actuellement. Il en résulte qu’il suffit d’avoir un projet religieux ou politique ou social différent du projet judaïque pour être, un jour ou l’autre, taxé d’« antisémitisme ». Et ceux qui ne sont pas encore passés à la casserole ne perdent rien pour attendre. Jéhovah est un dieu jaloux qui ne tolère rien d’autre que lui-même et qui a passé un contrat avec Israël, grâce auquel Il existe (Il est adoré) et grâce auquel Il doit dominer la terre entière. Jéhovah a donc besoin d’Israël comme Israël a besoin de Jéhovah.
Comme cette alliance est inscrite dans la chair et dans le sang du peuple juif de façon irrémédiable (Brith’ Milah = circoncision, et B’nai Brith = fils de l’alliance) quiconque n’est pas Juif ou n’accepte pas la juridiction d’Israël est suspect. C’est du moins ce qu’on enseigne en latin à la Sorbo, oh, oh, oh…ne !
Le Christ a évidemment tout foutu par terre en déclarant « Notre royaume n’est pas de ce monde », et saint Paul a achevé d’anéantir le fondement raciste mono-ethnique du projet théocratique rabbinique en décrétant qu’il n’était pas nécessaire d’être circoncis pour entrer au royaume de Dieu, qui était ouvert également aux gentils.
Les quelques considérations qui précèdent suffisent à montrer que l’accusation d’antisémitisme n’a aucun sens, car en pratique un antisémite est simplement quelqu’un que les Juifs n’aiment pas, pour une raison ou pour une autre, et contre lequel ils s’apprêtent à mobiliser la grosse cavalerie de l’ « antiracisme » chevauchée par la Shoah. Il existe donc autant de formes d’antisémitisme qu’il existe de manière d’être au monde qui n’entrent pas immédiatement dans le projet faisant l’objet de l’Alliance.
L’accusation d’antisémitisme fonctionne comme un mécanisme de dénégation de la parole de l’autre : « Vous dites cela parce que vous êtes antisémite ! » Cela ne sera donc ni entendu, ni considéré, ni discuté.
… Et la Vieille Taupe dans tout ça ? Elle n’est absolument pas antisémite. Elle se revendique d’un antijudaïsme radical qu’elle a toujours proclamé urbi et orbi en se revendiquant du texte fondateur de Karl Marx, La Question juive, qui se termine par la phrase : « L’émancipation sociale du Juif, c’est l’émancipation de la société du judaïsme. » La Vieille Taupe milite en faveur de l’émancipation sociale du Juif. Nous avons publié dans cet ordre d’idée – outre le texte de Marx – L’Antisémitisme, son histoire et ses causes, de Bernard Lazare, Histoire Juive – Religion Juive, le poids de trois millénaires, d’Israël Shahak, et Judaïsme et Altérité, d’Alberto d’Anzul.
Au moins trois des quatre auteurs responsables des textes programmatiques de La Vieille Taupe dans ce domaine sont juifs : Karl Marx, Bernard Lazare, Israël Shahak. C’est dire combien nous n’avons rien de commun avec la tradition antisémite. Nous n’en sommes que plus libres pour constater que beaucoup d’auteurs « antisémites » ont été exagérément calomniés, et que des excuses sont dues à certains, dont nous ne partageons pas le point de vue, mais qui ont été traités comme de véritables monstres antisémites lorsqu’ils ne faisaient qu’énoncer des vérités incontestables, sur le contenu du Talmud par exemple.
La Vieille Taupe dénonce la métaphysique de la terre (d’Israël), et du sang (les fils de l’Alliance) en quoi se résume le judaïsme, dont le socialisme-national est idéologiquement une pâle imitation (une démarcation antagonique). Mais elle reconnaît la totale légitimité de l’attachement naturel à la terre et à la parenté, et lutte contre le déracinement de tout ce qui n’est pas lui-même auquel aboutit la logique totalitaire du projet judaïque.
La Vieille Taupe fait de la restauration de la liberté d’expression en Europe l’objectif majeur et immédiat de tous ses efforts. Elle fait du respect de la libre expression de l’autre, et donc de la libre expression de ses propres ennemis, le seul critère qui entraîne l’exclusion de son sein. La Vieille Taupe est donc en opposition avec la tradition antisémite, et combat l’antisémitisme, mais avec des arguments honnêtes, c’est-à-dire véridiques ; des arguments qu’elle est toujours prête à corriger si on lui montre qu’ils sont faux. Contrairement au judaïsme religieux et à la tradition antisémite, La Vieille Taupe considère que les Juifs sont comme tout le monde, mais que le judaïsme n’est pas une religion comme les autres.
Elle déplore seulement que la plupart ne le sachent pas encore !
Pierre Guillaume (1998)
1 note
·
View note
Text
Biographie
BIOGRAPHIE
‟À scruter la biographie d’un artiste, nous sommes bien aises d’aviser père et mère tous deux artistes se pencher sur le berceau. Voilà qui fournit une justification aux déterministes, un argument aux jaloux, alors même qu’il est ardu de se forger un prénom, Wilhelm Friedemann et Johann Christoph Friedrich en savent quelque chose.
Pour autant, un foyer où flamboient à cœur joie création, culture et humanisme atteint au creuset pour qui est habité d’une âme artiste. De ce milieu propice, il nous faut cerner de quoi Josef est-il redevable envers Jean-Michel, son père photographe. Si transmission il y eut bel et bien, elle remonte à l’enfance de Josef, à ce jour où – geste inéluctable – un appareil photo a été semé dans ses mains. L’initiation s’est cantonnée aux incontournables bases techniques. Pour le reste, c’est-à-dire l’essentiel, Josef a bâti son propre univers créatif en toute liberté.
La douceur naturelle de Josef ne bride en rien sa détermination. Très tôt il inscrit la trajectoire de son travail avec lucidité. Il bouscule sans vergogne l’idée du « métier » - dans sa facture traditionnelle du rendu photographique - en bouchant volontairement des ombres, en laissant la lumière brûler des parties de l’image. Sur et sous-expositions revendiquées au service d’options plastiques tranchées et qui ne manquent pas de provoquer des remous dans les échanges esthétiques avec son entourage initiateur…
Arrive le moment où s’impose la nécessité d’une distanciation plus franche encore.
Josef Guinzbourg invente alors la série Space Invaders, vaste échappée dans l’imaginaire fantastique de la science fiction, où l’inquiétant le dispute au cocasse.
Il est tentant d’y lire, claironnée par une manipulation outrancière de l’image, la rupture consommée entre argentique et numérique. Mais le fossé est bien plus profond. La strate technique à elle seule ne suffit pas à démarquer ce corpus des précédents. Sous elle se cache l’abyssal antagonisme de deux conceptions, la photographie viscéralement liée au réel et l’image totalement réinventée, augmentée, celle des jeux vidéo et des effets spéciaux du cinéma d’aujourd’hui.
Deux attitudes contradictoires qui coexistent cependant dans le travail de Guinzbourg. Il reste en effet fidèle à une approche simple, sans artifice, où le traitement numérique se borne à amplifier les données réelles captées à la prise de vue, dans les autres thèmes qu’il continue de traiter en parallèle : la photographie urbaine (aux accents de Nouvelle objectivité) et paysagère.
C’est ce dernier registre qu’il va choisir pour L’Image en dialogues. Il projetait initialement d’y poursuivre les photomontages, mais ce processus très long s’avère difficile à utiliser sans rompre le rythme régulier induit par la résidence. Avant tout, le paysage, plus simple, lui permet de garantir la cohésion du binôme, de faciliter l’échange et le partage avec son associé de père, de le rejoindre dans une autre passion qui les unit : l’escapade au cœur de la nature.
La résidence est aussi le prolongement de sa relation avec Claude Philippot, autre protagoniste de L’Image en dialogues, qui accompagne depuis longtemps son cheminement.
L’ampleur du projet, par son inscription dans la durée, offre à Josef Guinzbourg le temps d’une longue expérimentation avant d’arrêter son propos et de l’approfondir.
Il livre in fine des paysages variés par l’angle de vue (frontale, contreplongée) et la distance (gros-plan, panorama), réinterprétés par retouche numérique.
Des images de langueur et d’étrangeté dont le pseudo-vignettage et la couleur aux saveurs d’autochrome laissent émaner des fragrances de clichés anciens - un trait d’union entre balbutiements d’hier et aboutissements d’aujourd’hui -, chantant une ode à la Photographie, avec pour basse continue l’absolue créativité.”
Pierre Van Tieghen Historien et critique d'art
0 notes
Text
L’intelligence artificielle est-elle en train de changer la nature même de la recherche en physique ?
En se basant sur l’intelligence artificielle, la recherche en physique est-elle en train de passer d’un modèle déterministe à une méthode relativiste ?
0 notes
Text
Psychogénèse des maladies mentales
L’esprit scientifique, dans la mesure où il a une pensée déterministe, est incapable de compréhension prospective, il ne comprend que rétrospectivement. * Comprendre l’âme selon le principe de causalité signifie n’en comprendre qu’une moitié. * Dans la mesure où la vie réelle et actuelle est quelque chose de nouveau qui triomphe de tout ce qui est du passé, on ne doit pas voir la valeur…

View On WordPress
0 notes
Text
La vérité, à l’époque de Daniel1, commençait à se faire jour ; il apparaissait de plus en plus nettement, et il devenait de plus en plus difficile à dissimuler que les véritables buts des hommes, les seuls qu’ils auraient poursuivis spontanément s’ils en avaient conservé la possibilité, étaient exclusivement d’ordre sexuel.
Pour nous, néo-humains, c’est là un véritable point d’achoppement. Nous ne pourrons jamais, nous avertit la Sœur suprême, nous faire du phénomène une idée suffisante ; nous ne pourrons approcher de sa compréhension qu’en gardant constamment présentes à l’esprit certaines idées régulatrices dont la plus importante est que dans l’espèce humaine, comme dans toutes les espèces animales qui l’avaient précédée, la survie individuelle ne comptait absolument pas.
La fiction darwinienne de la « lutte pour la vie » avait longtemps dissimulé ce fait élémentaire que la valeur génétique d’un individu, son pouvoir de transmettre à ses descendants ses caractéristiques, pouvait se résumer, très brutalement, à un seul paramètre : le nombre de descendants qu’il était au bout du compte en mesure de procréer. Aussi ne fallait‑il nullement s’étonner qu’un animal, n’importe quel animal, ait été prêt à sacrifier son bonheur, son bien-être physique et même sa vie dans l’espoir d’un simple rapport sexuel : la volonté de l’espèce (pour parler en termes finalistes), un système hormonal aux régulations puissantes (si l’on s’en tenait à une approche déterministe) devaient le conduire presque inéluctablement à ce choix. Les parures et plumages chatoyants, les parades amoureuses bruyantes et spectaculaires pouvaient bien faire repérer et dévorer les animaux mâles par leurs prédateurs ; une telle solution n’en était pas moins systématiquement favorisée, en termes génétiques, dès lors qu’elle permettait une reproduction plus efficace. Cette subordination de l’individu à l’espèce, basée sur des mécanismes biochimiques inchangés, était tout aussi forte chez l’animal humain, à cette aggravation près que les pulsions sexuelles, non limitées aux périodes de rut, pouvaient s’y exercer en permanence – les récits de vie humains nous montrent par exemple avec évidence que le maintien d’une apparence physique susceptible de séduire les représentants de l’autre sexe était la seule véritable raison d’être de la santé, et que l’entretien minutieux de leur corps, auquel les contemporains de Daniel1 consacraient une part croissante de leur temps libre, n’avait pas d’autre objectif.
- La possibilité d'une île Daniel 25.8
2 notes
·
View notes
Text
Une partie de tric-trac après un bon dîner
“David Hume”. Le salon du baron D’Holbach à Paris fut un haut lieu du siècle des Lumières. Diderot, D’Alembert, Helvétius, Buffon, Adam Smith, Hume, Galiani, Beccaria, Priestley, Horace Walpole le fréquentèrent. D’Holbach affichait un athéisme et un matérialisme sans concessioni. Dans son Système de la Nature (1770) il défendit une conception résolument fataliste et déterministe du monde : « En…

View On WordPress
0 notes
Text
79
“Et pourtant, la persuasion, émotion rhétorique par excellence, est avant tout un effet d’évidence, souvent décrit comme un effet de validité : ce qui nous paraît indiscutable nous paraît aussi profondément vrai, juste, adéquat.”
‘Parmi les indices, l’un présente la relation de l’individuel à l’universel ; l’autre, de l’universel au particulier. Entre les indices, celui qui est nécessaire est le tekmerion ; celui qui n’est pas nécessaire n’a pas de nom répondant à cette différence. Par nécessaire, j’entends les propositions pouvant servir de prémisses à un syllogisme ; et c’est pourquoi, parmi les indices, celui qui a ce caractère est un tekmerion. Quand on croit qu’il n’est pas possible de réfuter la proposition énoncée, on croit apporter un tekmerion, que l’on tient pour démontré et achevé ; aussi bien les mots tekmar et péras (achèvement) ont-ils le même sens dans l’ancienne langue. Parmi les indices, l’un présente la relation du particulier au général, ainsi : un indice que les doctes sont justes, c’est que Socrate était docte et juste. C’est là, sans doute, un indice ; mais il est réfutable, bien que la proposition particulière soit vraie ; car on n’en peut tirer un syllogisme. Mais si l’on disait, par exemple : un indice qu’il est malade, c’est qu’il a de la fièvre, ou : un indice qu’elle a enfanté, c’est qu’elle a du lait, un tel indice serait nécessaire. Parmi les indices, c’est le seul qui soit un tekmerion ; car c’est le seul, à condition qu’il soit vrai, que l’on ne puisse réfuter. D’autres indices présentent la relation du général au particulier, si l’on disait, par exemple : un indice qu’il a la fièvre, c’est que sa respiration est rapide ; ce qui est réfutable, même si le fait est exact ; car on peut avoir la respiration haletante, sans avoir la fièvre. Nous venons de dire en quoi consiste le vraisemblable, l’indice et le tekmerion.”
Aristote, Rhétorique, I, 2, 1357b
“Cette culpabilité des émotions, caractéristique de la modernité, a donné lieu à de nombreux phénomènes rhétoriques, dont la propagande de masse représente peut-être le plus spectaculaire. Le discours de propagande utilise sans complexe les représentations intuitives, souvent de nature stéréotypée, en avançant l’argument imparable au regard de l’intuition : « Je dis haut et fort ce que chacun pense tout bas. » On peut en effet décrire sous cet angle l’extraordinaire efficacité rhétorique de la propagande. Dans le contexte général d’un bâillonnement des intuitions et d’une culpabilité des émotions, son effet d’authenticité n’est que plus puissant puisqu’il se présente, en somme, comme un soulagement, comme une réconciliation avec les intuitions. D’où le grand soin que prennent les rhétoriques de propagande à se construire sur le terreau encore fertile d’une pensée déterministe qui érige l’intuition en norme et l’authenticité en valeur.”
Danblon, Emmanuelle. « Sur le paradoxe de la preuve en rhétorique », Communications, vol. 84, no. 1, 2009, pp. 9-20. [en ligne] https://www.cairn.info/revue-communications-2009-1-page-9.htm
0 notes
Text
Approches de l'argumentation : 12 hommes en colère

Quand les jurés décident d'indiquer les raisons pour lesquelles il penchent pour la culpabilité, cela donne l'occasion d'inventorier quelques exemples de raisonnements fallacieux couramment utilisés.
- Un premier juré justifie sa position en estimant "qu'on n'a pas prouvé le contraire". (#Argument d'ignorance "on ne sait pas qu'il est innocent=>il est coupable"). Or la charge de la preuve revient à l'accusation.
- Un deuxième juré déclare "qu'il s'en tient aux faits". Toute la suite du film montrera que, s'il faut toujours tenir compte des faits, ceux ci sont souvent des constructions.
- Le troisième juré relève que le mobile du crime, la haine du fils à l'égard de son père qui l'avait souvent frappé, permet de retenir la culpabilité. La confusion entre bénéficiaire (direct ou indirect) et commanditaire/auteur d'un acte est fréquente et nourrit d'ailleurs souvent les diverses théories du #complot (ex : "Georges W. Bush a commandité les attentats du WTC pour se faire réélire")
– Le juré suivant conclut à la culpabilité du jeune homme parce que son passé et son milieu social l’ont amené à se battre fréquemment (« le taudis engendre des criminels »). Or, si les conditions socio-économiques doivent être retenues dans l’analyse du comportement, on ne saurait accepter une position déterministe (généralisation abusive, et/ou confusion entre corrélation et causalité)
On voit aussi comment les choix entre culpabilité et non-culpabilité relèvent parfois du conformisme, de l’esprit de contradiction, de l’identification à la victime, du souci de sauver la face, de l’idéologie, ou de la volonté d’écourter le débat.
La suite permet d’illustrer les méthodes de raisonnement logique par déduction, puis par induction...

3 notes
·
View notes
Photo
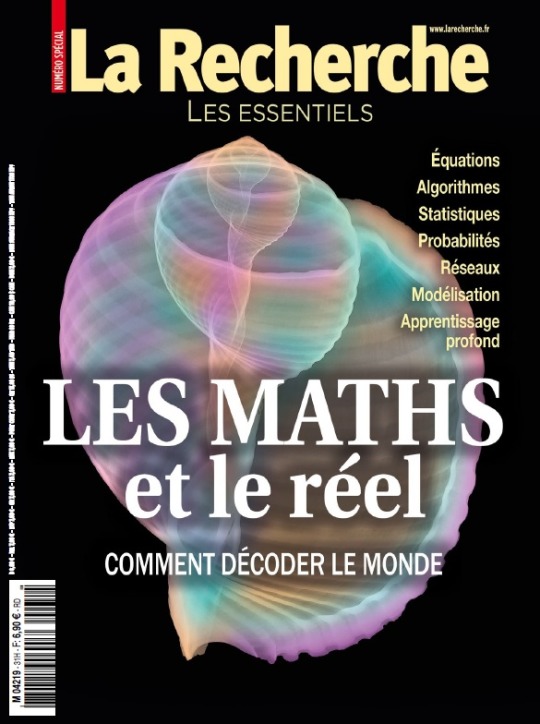
LES MATHS et le réel Explorer les frontières de l'aléatoire | larecherche.fr Hugo Duminil-Copin, mensuel 535 : Les trajectoires aléatoires sur un réseau, très proches des interfaces aléatoires de la physique, sont aujourd'hui étudiées grâce à de puissants outils de probabilités. Les mathématiciens commencent notamment à comprendre à quelle vitesse ces courbes s'éloignent de leur point de départ et à les dénombrer. La nature est riche en phénomènes à grande échelle trouvant leurs sources dans des interactions microscopiques. Qu'il s'agisse des changements de phase dans les matériaux, de la propagation d'une épidémie ou de celle d'un front d'incendie, de la conduction dans certains alliages, de la viscosité de matériaux polymérisés, de nombreux phénomènes sont régis par des lois microscopiques aléatoires, alors que leur comportement macroscopique paraît obéir à des lois globales déterministes. Avec comme cadre unificateur la physique statistique, les physiciens se sont emparés avec succès de ces problèmes dans la deuxième partie du XXe siècle, menant ainsi à une théorie relativement complète des transitions de phases. Depuis une quinzaine d'années, les mathématiciens disposent d'outils puissants pour étudier le comportement des courbes formées par la frontière entre deux phases d'un même système, comme le front de propagation d'un incendie, qui sont typiquement aléatoires. Trois objets qui ont de forts liens entre eux sont particulièrement étudiés : le mouvement brownien, les marches aléatoires et les marches aléatoires auto-évitantes, qui sont des chemins aléatoires sur un quadrillage qui ne se recoupent pas. Construire une théorie prédictive pour ces dernières représente un immense défi pour les probabilistes : de nombreuses conjectures sont pressenties, mais restent en suspens faute de démonstration propre. Dans le cadre d'un quadrillage hexagonal - comme un nid-d'abeilles -, nous avons obtenu avec Stanislav Smirnov, de l'université de Genève, une estimation du nombre de chemins aléatoires auto-évitants pour une longueur donnée. Ce n'est qu'un petit pas vers une théorie complète, mais qui nous ouvre une voie vers une meilleure compréhension de ces objets aléatoires, dont la première manifestation résulte d'une observation naturaliste. En 1827, le botaniste britannique Robert Brown observe au microscope l'agitation désordonnée de petits corpuscules présents à l'intérieur de grains de pollen. Il remarque que chaque particule rebondit continuellement, repartant à chaque instant dans une nouvelle direction. Pour l'observateur de l'époque, ces particules semblent suivre des trajets aléatoires, car imprévisibles. Brown en déduit qu'elles sont animées ! Bien que ce phénomène soit aujourd'hui expliqué sans référence à un caractère vivant, ce mouvement porte le nom de mouvement brownien en hommage à son découvreur. Un chemin au hasard Le mouvement brownien aurait pu rester un phénomène naturel isolé. Cependant, il prend une dimension théorique au début du XXe siècle. Tout d'abord, le mathématicien français Louis Bachelier suggère son usage en finance. Cette idée féconde mène, des années plus tard, au développement du calcul stochastique, outil principal pour l'étude des marchés financiers. Dans l'un de ses quatre articles fondateurs de l'année 1905, un certain Albert Einstein propose la plus spectaculaire des applications du mouvement brownien : prouver l'existence d'atomes. Ce que fait le physicien français Jean Perrin en 1908. Plus rien n'arrête alors la progression du mouvement brownien. Aujourd'hui, il est un objet fondamental en sciences expérimentales et théoriques. Le mouvement brownien est donc un chemin au hasard. Mais comment le construire ? Considérons d'abord des trajectoires modélisant un mouvement discontinu. Abandonnons l'interprétation d'une particule évoluant dans un liquide et imaginons plutôt qu'elle se déplace d'un sommet à un autre, le long des arêtes d'un réseau carré. Introduisons maintenant du hasard. Lorsque la particule atteint un sommet, elle change de direction aléatoirement en choisissant l'une des quatre directions avec une probabilité de 1/4. Cela revient à jeter un dé à quatre faces (les amateurs de jeux de rôles sauront qu'un tel dé peut être construit à l'aide d'un tétraèdre régulier), et à partir vers le nord (respectivement, l'ouest, le sud, l'est) si le résultat est 1 (respectivement 2, 3, 4). Ce modèle de trajectoire aléatoire est baptisé marche aléatoire. Notez que, pour l'instant, les trajectoires peuvent passer plusieurs fois par le même endroit, et que la particule peut rebrousser chemin lorsqu'elle atteint un sommet. Maintenant que nous sommes en mesure de tirer une trajectoire aléatoirement, que peut-on dire de sa géométrie typique ? Par exemple, si un segment entre deux sommets représente un mètre, à quelle distance de son point de départ la particule se situe-t-elle après avoir parcouru n arêtes sur le réseau ? Si celle-ci se dirige tout droit, elle finira à n mètres de son point d'origine ; mais si elle choisit au hasard son chemin, la probabilité qu'elle aille systématiquement dans la même direction sera très petite. En fait, il est possible de montrer, en se fondant sur la notion statistique de variance (*), que la distance typique après n pas sera de l'ordre de n arêtes. Les mathématiciens savent dire plus que cela : ils sont capables de décrire le comportement de la marche aléatoire quand le nombre de pas tend vers l'infini (son comportement asymptotique). Imaginons une carte à l'échelle 1/n autour du point d'origine, c'est-à-dire qu'un mètre est représenté par une distance de 1/n mètre sur la carte (notez que la taille de la carte grandit lorsque n croît). Lorsque l'on trace le chemin parcouru par la marche sur une telle carte, le tracé obtenu est très désordonné et fractal (*). Quand n est très grand (et donc la taille des arêtes toute petite), le tracé ressemble en fait à s'y méprendre au mouvement brownien. Au milieu du siècle dernier, le probabiliste américain Monroe D. Donsker donna un sens mathématique à cette observation : il montra que la marche aléatoire effectuée par la particule converge vers le mouvement brownien quand n tend vers l'infini. Ainsi, le mouvement brownien, qui est un mouvement aléatoire continu, peut être décrit comme une limite de marches aléatoires (dessinées sur des réseaux de plus en plus petits), qui sont des mouvements aléatoires discrets plus simples à introduire. Historiquement toutefois, il fut d'abord défini comme une courbe continue... ...Jusqu'ici, la marche peut repasser plusieurs fois quelque part. Ajoutons une condition supplémentaire sur la trajectoire : on lui interdit de repasser au même endroit. Il s'agit de trajectoires dites « auto-évitantes ». Ces dernières ont été très utiles pour démontrer des conjectures sur le mouvement brownien (notamment la conjecture de Mandelbrot). En physique, elles peuvent représenter de longs polymères ou de longues interfaces entre deux systèmes (partie rouillée ou saine d'un métal, deux liquides non miscibles, front d'incendie, etc.)... LA MARCHE AUTO-ÉVITANTE par Vincent Beffara École Polytechnique Journée de Mathématiques ... - Prepas.org Chemin auto-évitant — Wikipédia Hugo Duminil-Copin - IHES Marche aléatoire auto-évitante en auto-interaction Raconte-moi ... le processus SLE - Société Mathématique de ...
#LES MATHS et le réel#La Recherche#Explorer les frontières de l'aléatoire#LA MARCHE AUTO-ÉVITANTE#Vincent Beffara#Chemin auto-évitant#Hugo Duminil-Copin#GB Nguyen#Stanislav Smirnov#marche aléatoire#mouvement brownien#mensuel 535#Robert Brown#Louis Bachelier#finance#Albert Einstein#Jean Perrin#Monroe D. Donsker#conjecture de Mandelbrot#Mandelbrot
7 notes
·
View notes