Parlons politique et communautarisme #élections2018 #e18be
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
“Il faut trouver une nouvelle formule pour que les citoyens soient les élus”

- Zakia Khattabi, co-présidente d’Ecolo depuis 2015.
Zakia Khattabi joue le jeu: elle répond avec franchise. Elle prend son temps. Elle sait qu’elle parle d’un sujet sensible. Elle hésite. Elle se reprend, mais elle sait où elle se rend: après tout, on ne fait pas la leçon de communautarisme à Ecolo. Interview exclusive.
Comment ont évolué les listes électorales de votre parti ces dix dernières années ? Qui y retrouvait-on principalement ?
Il y dix ans, les listes étaient encore en grande majorité composées d’universitaires “blancs” très engagés dans des domaines relativement en dehors du monde politique, dans le monde associatif, dans des ONG : pas des professionnels. De plus en plus, les profils se diversifient. Les universitaires ne sont plus majoritaires.
On essaie au maximum de faire coller nos listes aux réalités sociologiques du terrain, mais la spécificité d’Ecolo est que son électorat ne correspond pas au public touché par sa politique. On sait, par exemple, l'électorat du PS ouvrier. Nos électeurs sont des altruistes progressistes qui ont une attention sur notre programme qui se soucient des publics que nous visons.
“Pour 2018-2019, on veut composer nos listes à partir d’un projet.”
Pour les listes de 2009 et 2014, il y a un équilibre dans les représentations, d’un point de vue géographique comme sociologique. Il y a une volonté d’amplification de nos électeurs à nos élus. Et pour 2018-2019, on veut composer nos listes à partir d’un projet. Sur Ixelles, par exemple, plutôt que de déposer une liste, on souhaite travailler en amont avec les Ixellois sur Ixelles 2025, par exemple.
Tout qui se retrouve dans ce projet peut nous rejoindre sur la liste. On veut suivre l’exemple de Grenoble. On voit bien le désamour entre les partis et leurs citoyens, donc il faut trouver une nouvelle formule pour que les citoyens soient les élus, que les listes ne soient plus des constructions artificielles.
Y a-t-il, dans vos listes, un espace pour les candidats d’origine étrangère ? Leur représentation a-t-elle suivi une certaine logique ?
En effet, il y a une ouverture, une perméabilité plus importantes qu’auparavant, et c’est plus lié au projet qu’à une pêche aux candidats. On ne se donne pas des quotas mais on a, en amont, la préoccupation de porter un discours et projet politique qui permettent de ramener à nous certains profils.
“On ne se dit pas qu’il nous faut trois Arabes, deux Turcs et un Africain.”
On ne fait pas du communautarisme. Trois semaines avant les élections, on ne se dit pas qu’il nous faut trois Arabes, deux Turcs et un Africain. À travers nos combats, certains nous rejoignent. On voit aussi dans ces publics que ceux qui nous rejoignent sont par exemple des cadres de la communauté musulmane : on touche ceux qui nous ressemblent.
Avec l’ouverture du vote (communal) aux étrangers, un parti traditionnel est-il obligé, aujourd’hui, de diversifier ses listes ?
Oui. En même temps, les publics issus de l’immigration évoluent aussi. Il ne leur suffit plus, pour voter pour quelqu’un, que celui-ci leur ressemble. Le vote communautaire est le fait de placer sur des listes des gens juste pour toucher une communauté. Ça marche de moins en moins parce que ces communautés sont elles-mêmes de plus en plus conscientes et politisées.
Est-ce un phénomène imputable à Bruxelles, où la population d’origine immigrée est plus importante, ou constatez-vous le même phénomène au niveau francophone ? Au niveau fédéral ?
C’est un processus normal et naturel, à l’image de ce qu’il se passe dans la société. C’est sûr que Bruxelles - ou non, plutôt les grandes villes connaissent une mixité sociale et culturelle plus importante. C’est par là que les changements arrivent et s’opèrent du point de vue du nombre.
Retrouvez toutes nos interviews.
3 notes
·
View notes
Text
Le vote obligatoire en Belgique? De la foutaise
On vous prévient tout de suite: le titre servait juste à attirer votre attention. Le vote, c’est une histoire très sérieuse. Et si les femmes n’en ont obtenu le droit qu’en 1948, le vote parait surtout comme une corvée: on hésite à dormir un dimanche de plus depuis la nuit des temps. Rétrospective.

Le devoir d’informer
L’exécutif belge s’accorde, depuis quelques années, sur la nécessité pour le citoyen d’être informé sur ses droits et devoirs, de la manière la plus évidente. Grâce au site internet du SPF Intérieur, les informations sur les conditions de vote sont clarifiées et vulgarisées. Tout le monde peut aussi consulter les résultats des trois dernières élections : celles, simultanées, du 25 mai 2014 ; celles, fédérales, du 13 juin 2010 et celles, européennes et régionales, du 7 juin 2009.

Le rôle que le citoyen joue dans l’engrenage de la représentation électorale est particulièrement important en Belgique, et ce grâce à plusieurs éléments.
D’abord, le vote est obligatoire depuis 1893. Le pays est le premier État actuel à avoir sacrifié le régime censitaire pour cette option nouvelle. Ce fait en implique un autre : le vote de protestation ou le vote extrémiste sont automatiquement minoritaires.
Ensuite, le vote est plural, dans le sens actuel du terme : le votant peut opter pour un candidat précis et son suppléant, ou voter en tête de liste.
Enfin, il y a une volonté politique certaine d’inclure le citoyen, peu importe son origine, dans le débat, du moins au niveau communal. Aujourd’hui, les immigrés y ont le droit de vote et d’être élu. Dans plusieurs autres démocraties, certaines catégories d’immigrés n’ont pas accès au vote, ni aux listes.
Le vote obligatoire a été instauré pour, au départ, lutter contre un fort taux d’absentéisme. Selon John Gilissen repris par Xavier Mabille, “les grandes distances à parcourir par certains électeurs, la durée des opérations électorales, le manque de formation politique des électeurs” représentaient les principaux facteurs justifiant cette situation, d’autant plus aux niveaux communal et provincial.

D’après Auguste Bernaert, les partis de droite y décelaient un moyen de modérer les résultats et d’inclure une frange de la population qui ne ressent pas le besoin de participer au débat. Cette nouvelle obligation justifiait, aussi, de coûteuses dépenses électorales.
Consultez aussi: Qui sont les principaux partis belges francophones?
Tous les autres pays du continent européen à avoir sauté le pas, avant de faire marche arrière, ont connu une nette diminution du taux de participation. Parfois considéré comme un paradoxe à la liberté d’élire, la Cour européenne des droits de l’homme jugea que le vote obligatoire ne l’était pas, dans une décision rendue en 1965.
En Belgique, les années 1980 voyaient les partis libéraux et écologistes adopter une position contre le vote obligatoire. Dans un article en ligne du CRISP, Xavier Mabille résume le débat comme suit : “Les adversaires (...) considèrent que le vote par obligation d’électeurs non informés et non intéressés a pour effet d’altérer les résultats au détriment des personnes qui font effectivement preuve d’intérêt pour la politique. Les partisans de l’obligation considèrent, eux, que cette dernière constitue un stimulant qui incite à s’informer ; (...) qu’il y a simultanément diminution du rôle de l’argent dans la politique.”

Il remarque que la jonction d’un certain taux d’absentéisme à un certain taux d’abstentionnisme a connu de beaux jours, en 1968 et 1974, avant de diminuer en importance, puis de reprendre, sans que l’on puisse établir des causes conjoncturelles.
Dans tous les cas, le pourcentage de citoyens qui expriment une opposition à cette obligation est relativement faible. Aussi, les sanctions contre un éventuel manquement, actées dans la Constitution, ne sont plus appliquées depuis 2003, ce qui a provoqué un débat lancé par l’Open-Vld Alexander De Croo, vice-Premier ministre du gouvernement Michel, en 2010.
“C’est une expression de liberté, d’aller voter. Ne pas aller voter est un signal aussi. (...) Le fait de dire: “C’est à vous de vous savoir si vous voulez aller voter; mais faites-le si vous êtes motivé”, c’est responsabiliser l’électorat.”

Photonews
3 notes
·
View notes
Text
“Communautarisme? Cela m’insupporte au plus haut point quand on le dit”

- Joëlle Milquet, parlementaire bruxelloise, cheffe de file à la Région et cheffe de groupe à la Ville, présidente du cdH de 1999 à 2011.
Joëlle Milquet est de ces papesses politiques qu’on approche difficilement. Des années d’expérience et d’influence, pour créer le cdH que l’on connait aujourd’hui. Mais quand on la décroche, et quand on la lance sur le sujet, on ne l’arrête plus. Interview exclusive.
Comment ont évolué les listes électorales de votre parti ces dix dernières années? Qui y retrouvait-on principalement?
Quand je suis arrivée, j’ai entamé une grande réforme pour ouvrir le cdH, en faire un parti proche des gens, pas technocratique, pour qu’il colle beaucoup plus à la sociologie en général des différents arrondissements.
C’était un parti plus de notables, assez masculins, très belgo-belges, plutôt du monde rural. J’ai pris des règles pour laisser de la place aux jeunes. Je me suis arrangée pour que des gens comme Maxime Prévot, Benoit Lutgen, Hamza Fassi-Fihri, Céline Fremault et autres puissent arriver par la suppléance.
“Je me suis battue pour avoir des femmes têtes, secondes de listes, suppléantes.”
Les femmes, en deux. Je suis de celles qui pensent qu’il faut une représentation de la femme en politique comme elle est dans la société : idéalement 50/50. Il y avait 12% de femmes dans les parlements francophones quand j’ai débuté. On s’est battus pour qu’il y ait des règles internes, obligatoires pour tous.
Je me suis battue pour avoir des femmes têtes, secondes de listes, suppléantes, ce qui n’est pas simple car elles sont moins attirées par la politique, croyant que c’est un métier d’hommes, qu’elles sont empêchées le weekend et le soir comme la vie politique le demande. Il y a pas mal de freins culturels mais une fois qu’elle prennent des responsabilités, elles sont évidemment excellentes et parfois même meilleures.
Le troisième impératif, pour moi, c’était notamment dans des régions où on a une proportion importante de personnes d’origine étrangère. C’est pas du clientélisme, c’est pas du communautarisme, tout cela m’insupporte au plus haut point quand on le dit. Il s’agit juste de donner une photographie de la société, de permettre à ceux qui la font de pouvoir se présenter et représenter.
On a besoin que le système représente tout le monde et pas uniquement le Belgo-belge bruxellois. À Bruxelles, le cdH n’était pas terrible et, surtout, il était représenté uniquement par un électorat assez bourgeois, très blanc et catholique du sud de la ville. Moi, j’ai des convictions sur la diversité qui sont très fortes. J’ai toujours combattu la discrimination. J’ai ouvert le cdH à l’interculturalité pour avoir des candidats d’origine africaine, marocaine, turque, autre : l’Afrique n’est pas que le Congo. Aussi les gens de l’Est, l’Amérique latine...
Leur représentation a-t-elle suivi une certaine logique?
Les listes doivent être ouvertes et au reflet de la population, en tout cas à Bruxelles mais aussi Charleroi, Liège (cette dernière est plus compliquée). À Bruxelles, il y a des communes entières qui sont à dominante d’origine étrangère.
“Mes listes bruxelloises sont à 50% de gens d’origine belge et à 50% de personnes d’origine étrangère. Pour certains, c’est trop.”
Vous connaissez ce que nous vivons dans notre société. Il y dans tous les partis des mentalités beaucoup moins ouvertes. Il y a des incompréhensions, les gens ne se connaissent pas, ont des a priori. Il y a des positionnements qui ne sont pas toujours simples, que ce soit sur le conflit israëlo-palestinien ou le port du voile. Ça vous oblige à aborder des sujets qui sont presque du domaine de la politique étrangère, comme le génocide arménien. Il faut bien se mettre d’accord sur un socle de valeurs communes. Ça demande tout autre chose comme organisation de parti.
Avec l’ouverture du vote (communal) aux étrangers, un parti traditionnel est-il obligé, aujourd’hui, de diversifier ses listes?
Il y a une grande différence : 85-90% des personnes d’origine étrangère sont belges. Le vote communal est le même. Par contre, le vote possible pour les ressortissants de l’Union européenne aux communales oblige à mettre un “Français français”, une “Grecque grecque”, des eurocrates peut-être moins intégrés.
C’est vrai qu’on va chercher des gens qui représentent des nationalités. Mais ce n’est pas du tout la problématique des Belges d’origine étrangère. Celle-là est réglée par la naturalisation. En Wallonie, énormément de gens ont gardé la nationalité italienne mais bon, ce sont des Belges, ils sont là depuis des années. À Bruxelles, pour les communales, il est important d’avoir des représentants polonais : ils y sont plus que les Flamands et c’est une très grosse communauté qui garde sa nationalité.
Est-ce un phénomène imputable à Bruxelles, où la population d’origine immigrée est plus importante, ou constatez-vous le même phénomène au niveau francophone? Au niveau fédéral?
À Bruxelles, c’est incontournable. Mais à Verviers, Liège, Charleroi, vous avez une communauté musulmane importante. En fait, c’est lié au pôle urbain. Dans les villes industrielles, ça oblige une diversification par soi-même. L’Europe a changé de visage. Le problème est que tous les Européens ne l’ont pas compris à temps, ce qui crée des réflexes nationalistes et parfois xénophobes. La natalité étant de quatre à cinq enfants dans les familles plutôt d’origine étrangère et d’1,3 de l’autre côté, l’augmentation de population se fera essentiellement dans ces milieux.
Quels risques comporte cette logique du “vote communautaire”, souvent dénoncée, pour la vie démocratique dans son ensemble?
Oui, il y a une logique mais pas dans la confection des listes. Nous interdisons les campagnes communautaires. J’ai toujours interdit que trois candidats d’origine marocaine fassent campagne ensemble. Il faut toujours que ce soit mixé.
“L’Europe a changé de visage.”
On s’assure aussi, quand il y a des tracts du gotha mondain, qu’il y ait sur les listes des personnes d’origine étrangère. Mais l’électorat peut avoir une réaction communautaire. Bon, vous avez des personnes d’origine belge qui reçoivent énormément de votes d’origines étrangères, c’est mon cas. Les personnes d’origine turque, c’est vrai, votent quoiqu’il arrive pour leur représentant d’origine turque, mais ils panachent avec d’autres qu’ils apprécient aussi. C’est une question générationnelle. Ça va évoluer. C’est encore un réflexe, qu’il faut éviter, mais sur lequel on n’a pas toujours de prise.
Retrouvez toutes nos interviews.
1 note
·
View note
Text
La com' politique selon Di Rupo: le caractère de Sarkozy face au parapluie de Hollande

Le mardi 4 octobre 2016, lors d'une Master class à l'IHECS organisée par le think tank Protagoras, l'ancien Premier est revenu sur plusieurs de ses stratégies de communication.
Le racisme des débuts
Elio Di Rupo commence son exposé avec un bref rappel de sa vie privée: son enfance, ses premiers pas dans le monde politique en tant qu’étudiant militant, ses premiers succès en tant que mandataire. Il revient, plus précisément, sur sa toute première affiche électorale, où il arbore un brushing d’époque.

“Signe particulier: j’avais une cravate”, ironise le numéro un du PS. Sur les listes communales, il décrocha la 24ème place. Comment se démarquer alors que personne ne le connaissait? “J’avais collé sur mes affiches le bandeau ‘Milieu de liste’, ce qui m’a valu beaucoup de problèmes en interne du parti.”
Consultez aussi: Un parti = une pub? L’exemple du PS belge
Une première stratégie osée, qui a fonctionné. “Mais c’est la première fois de ma vie qu’on m’a fait ressentir que j’étais d’origine italienne, avoue-t-il alors. On faisait des croix gammées sur mes affiches, on me traitait de ‘Sale rital’. On ne m’avait jamais considéré comme un 'rital', je ne connaissais pas cette expression.”
Pour s’habituer aux moqueries xénophobes, Di Rupo avance un remède, “l’énorme quantité de travail” sous-jacente à la communication, seule manière, selon lui, de prouver aux électeurs le bien-fondé d’un programme.

Le dossier politico-sensible: son affaire de pédophilie
“C’était en 1996”, se rappelle celui qui était vice-Premier. Son nom a défrayé la chronique lors de l’affaire Trusgnach, où un jeune homosexuel l’a accusé d’avoir eu des relations sexuelles alors qu'il était mineur. “Démontrer que l’on est innocent est quelque chose de très difficile. (...) Durant deux ans et demi, j’ai été pourchassé par des dizaines de policiers qui étaient bien entendu concentrés sur cette affaire délicieuse, puisqu’un vice-Premier ministre y était épinglé.”
Dossier sensible, qu'il se remémore aujourd'hui machinalement, mais qui lui sert de tremplin vers un nouvel aspect de son exposé: la gestion de sa propre communication.
Une affaire de "caractère"
“Encore aujourd’hui, lorsque je vais chez Pascal Vrebos, je ressens du stress (...) et je me prépare jusqu’à la dernière seconde.” Un stress qui touche n’importe quel homme politique avant un direct, pense Di Rupo. “Certains d’entre nous peuvent avoir l’air décontractés”, mais face à un journaliste, le mandataire n’est pas tenu informé des thèmes qui seront abordés.
Consultez aussi: Qui sont les principaux partis belges francophones?
“Cela demande une préparation minutieuse (...) sur les mots, car une phrase de travers peut avoir des conséquences que l’on n’imagine pas.” Un travail, mais aussi un caractère. Lorsqu’un étudiant de l’IHECS lui demande si le problème, chez de grands impopulaires comme François Hollande ou Hillary Clinton, n’est pas qu’ils apparaissent trop préparés, ou pas assez sincères, Di Rupo utilise un exemple étonnant: celui de Nicolas Sarkozy.

“La politique est une affaire de caractère. Regardez Nicolas Sarkozy. Encore aujourd’hui, lorsqu’il tient un meeting, on le reconnait (...), ses discours, c’est lui.” Jusqu’à sous-entendre que l’actuel président français en manque.
Soulignant l’intérêt d’une bonne équipe pour gérer la communication d’un représentant, Di Rupo sous-entend une certaine incompétence de la part de celle de François Hollande. “Quand vous devez tenir un meeting sous la pluie, vous prenez un parapluie, non? Ca me semble évident”, fit-il allusion à un discours tenu en 2014 sur l’île de Seing par Hollande.

0 notes
Text
Un parti = une pub? L’exemple du PS belge

En matière de politique belge, il ne faut pas chercher de poux au PS. Il est le parti-représentant wallon, historiquement. Aujourd’hui, il continue sur sa lancée, avec une histoire à 3 héros: Elio, Laurette et Mister Ceta : Paul.
Article tiré d’un grand-format réalisé avec Marine Vancampenhout, Caroline Beauvois, Laura Swysen, Anne Barrès et Zélie Dion.
Le parti socialiste belge revendique un rouge sang, vif et uni. Le rouge du socialisme, la parole du fédéralisme. Ainsi, il a régné en digne numéro un du pays durant 26 ans.
Consultez aussi: La com’ politique selon Di Rupo: le caractère de Sarkozy face au parapluie de Hollande
Mais la sentence tomba le 25 mai 2014 : en quelques semaines, une coalition de centre-droit coupa les ailes du parti. Il fallait réagir, vite, fort, voire maladroitement. L'opposition a adopté plusieurs tons qui ont été décidés en collectivité mais dans l’urgence.

Le PS est une institution. Il est, de loin, le parti le plus organisé du pays. Il emploie un centre de recherche reconnu nationalement, des professeurs, des cabinets régionaux. Pour ce qui est de leur communication, la moindre phrase est très préparée, réfléchie collectivement. Leur réputation s’est ficelée autour d’un branding politique reposant sur trois grandes figures. Dans l’ordre : Laurette, Paul, Elio.
Moulés pour convenir à n’importe quelle intervention, en fonction de l’info recherchée et du média invitant, la pièce se joue grâce aux trois personnages, tour à tour, selon une logique storytelling d’agression, puis de réflexion, enfin de retrait.



1 note
·
View note
Text
Alors, génocide ou pas génocide? Les plus gros couacs de nos partis

Un membre du PS qui rejoint le parti Islam. Des députés PS et cdH qui ne reconnaissent pas le génocide arménien. Et si les partis politiques organisaient une bonne fois pour toute un test d’entrée?
La politique s’adresse à nous par l’intermédiaire de communautés dans lesquelles nous sommes catégorisés, jusqu’aux listes. Ce n’est pas juste le résultat d’un agrégat de données miroitant une situation urbaine. Cela n’exprime pas juste une volonté politique de mixité. A l’instar de l’ouverture au droit de vote, à l’instar de l’octroi tantôt perméabilisé, tantôt atténué de la nationalité, c’est aussi l’expression la plus visible d’un projet stratégique.

Un tel projet engendre des retombées positives: une inclusion plus forte du Belge, indépendamment de ses positions sociale ou financière, la prise en compte d’un spectre citoyen sans cesse élargi et la coloration du paysage représentationnel qui, en soi, est le signal d’une évolution progressiste des mœurs.
Mais comme le prouvent les techniques empruntées à travers les époques pour s’adresser à la masse, ledit projet atteint parfois ses limites. Certaines fausses notes ont pris l’ampleur de polémiques, qui se multiplient.
Aucune famille politique ne semble épargnée par les éclaboussures, mais celles qui ont érigé la diversification en priorité stratégique sont celles qui doivent aujourd’hui essuyer les revers les plus médiatisés. La plus grande discorde est sans doute celle autour du socialiste Emir Kir, fils d’immigrés turcs venus prêter leur force de travail aux mines dans les années soixante.

Photonews
Kir se porte candidat sur les listes communales de Saint-Josse-ten-Noode, quartier de Bruxelles à forte population d’origine turque, pour la première fois en 2000. Quatre ans plus tard, il devient secrétaire d’État PS à la Propreté publique. Il héritera ensuite de l’Urbanisme et est, aujourd’hui encore, un représentant socialiste de premier ordre (et de premier succès) dans la capitale.

Tractothèque
En 2003, pour les élections législatives du 18 mai, Emir Kir est interviewé par le journaliste Mehmet Koksal. Abordant une campagne électorale s’adressant aux Turcs de Bruxelles, ils reviennent sur plusieurs éléments tels qu’un monument situé à Ixelles en mémoire du génocide arménien.
Consultez aussi: Les partis politiques sont-ils devenus des pubs?
Au cours de cet entretien, Kir avouera qu’il n’est “pas d’accord” avec le terme de génocide. “Vous savez, il faut comprendre les difficultés qu’on a rencontrées, comme immigré, durant notre enfance en Belgique. Je me souviens par exemple, dans les manuels scolaires et à l’école, que les profs commençaient toujours la leçon d’histoire en disant que c’était le premier génocide du siècle perpétré par les Ottomans et que si vous n’étiez pas d’accord ou que vous aviez d’autres arguments, on ne vous donnait pas vos points tout simplement...” Un an plus tard, il est aperçu dans une manifestation rassemblant des individus négationnistes.

Emir Kir intentera une action au civil contre Mehmet Koksal, mais l’huissier de justice conclura dans son jugement que l’élu politique en vient à nier le massacre.
Le Parti socialiste n’est pas le seul a avoir rencontré ce type de problèmes. Le 14 décembre 2015, le Bureau du parti cdH confirme l’exclusion de la députée d’origine turque Mahinur Özdemir. Ancienne investie au parlement bruxellois, elle fut la première parlementaire voilée d’Europe. En 2012, elle est en quatrième position sur la liste des candidats cdH lors des élections communales schaerbeekoises.

En juin 2009, elle est au centre d’une plainte déposée par le Comite de vigilance citoyen auprès du Centre de l’égalité des chances et de la lutte contre le racisme (CECLR) après avoir tenu, en novembre 2007 dans un média turc, des propos négationnistes sur ce même événement tragique. “Madame Ozdemir y parle à deux reprises d'un ‘prétendu génocide’ ou d'un ‘soi-disant génocide’ des Arméniens, estimant par ailleurs que l'Union européenne ne devrait pas se mêler du sujet”, expliquera Olivier Baum, du Comité de vigilance. Özdemir qualifiera ces propos “d’attaque désolante et vicieuse”, y décelant une tactique manipulatrice pour affaiblir une “mandataire politique qui porte un foulard”. Joëlle Milquet sera aussi visée.
Consultez notre interview exclusive de Joëlle Milquet

“Tout le monde, absolument tout le monde est d’accord pour dire qu’il y a eu génocide, sauf certains lurons, nous fulmine un journaliste en off sans citer Kir ou Özdemir. Nous sommes face à un problème d’ordre majeur. C’est une dissonance qui décrédibilise leurs partis respectifs.” Ces propos sont à relativiser, la notion même de génocide n’ayant vu le jour qu’après la deuxième guerre mondiale.
“Mes listes bruxelloises sont à 50% de gens d’origine belge et à 50% de personnes d’origine étrangère. Pour certains, c’est trop, avoue Joëlle Milquet. Vous connaissez ce que nous vivons dans notre société. Il y dans tous les partis des mentalitéss beaucoup moins ouvertes. Il y a des incompréhensions, les gens ne se connaissent pas, ont des a priori. Il y a des positionnements qui ne sont pas toujours simples, que ce soit sur le conflit israélo-palestinien ou le port du voile. Ca vous oblige à aborder des sujets qui sont presque du domaine de la politique étrangère, comme le génocide arménien. (...) Ca demande tout autre chose comme organisation de parti.”

Mais le souci n’est pas moins la reconnaissance ou non d’un génocide par ces personnalités politiques que l’utilisation politique qu’ils en font pour prouver leur appartenance a une communauté. Il sont des hommes et femmes de pouvoir : et s’ils favorisaient la communauté turque dans leurs décisions au détriment d’un bien commun, fondement démocratique?
En 2014, nouveau rebondissement sur les listes rouges : la députée bruxelloise d’origine marocaine Sfia Bouarfa quitte le PS pour le PTB-go !, association de trois partis d’extrême gauche à l’influence grandissante (il est aujourd’hui le troisième parti wallon selon le baromètre RTL-TVi/Ipsos/LeSoir). Présente dans les rangs socialistes depuis vingt ans, Bouarfa avait répété son désamour pour le parti, qu’elle considère acquis à l’austérité et aux politiques contre l’immigration. Elle lui reproche surtout, depuis longtemps, son communautarisme. En 2006, alors troisième sur les listes communales à Schaerbeek, elle dénonçait la présence de ���gens au comportement douteux”.

Photonews
Plus récemment encore, le PS est secoué par une polémique concernant Brahim Datoussaïd, assistant social d’origine algérienne et ancien collaborateur du Commissariat royal à la politique des immigrés.
En juin 2016, il quitte les rangs du parti pour rejoindre le parti Islam, dont il devient quasi automatiquement le secrétaire régional. Ce parti présentera des listes dans trois communes bruxelloises aux communales de 2012, année de sa fondation, et en organisera d’autres, timides, aux triples élections de 2014. Il compte deux conseillers communaux.

Il souhaite, à terme, établir un Etat islamique en Belgique selon son fondateur Redouane Ahrouch. “Islam” a compté dans ses rangs Laurent Louis jusqu’en octobre 2013.
Si vous ne le connaissez pas, voici le personnage.
youtube
Dans une lettre ouverte publiée le 28 juin 2016 sur son blog personnel, le membre du PS Merry Hermanus, connu pour ses relations conflictuelles avec Datoussaïd, revient sur plusieurs années de désaccords. “Ton passage au parti Islam est à mes yeux beaucoup plus qu’un simple changement de choix politique, y écrit-il. (...) Faire son « marché» pour tenter d’être élu démontre une absence totale de conviction politique, malheureusement de plus en plus répandue parmi ceux pour qui une élection n’est que l’ascenseur social, une sorte de jackpot, dénué de toute charge idéologique. Mais je le répète, choisir le parti Islam, c’est bien autre chose.”
0 notes
Text
Qui sont les principaux partis belges francophones?
Vous aviez du mal à choisir entre le boeuf et le poulet, ce midi? Attendez 2018.
Dans sa description de parti politique, le site officiel du Service public fédéral belge en identifie treize dans le paysage actuel, ceux qui sont représentés au parlement fédéral.
Sept sont francophones : le Centre démocrate humaniste (cdH), les Écologistes confédérés pour l’organisation de luttes originales (Écolo), les Démocrates fédéralistes indépendants (DéFi) encore appelés FDF sur le site, le Mouvement réformateur (MR), le Parti populaire (PP), le Parti du travail de Belgique Gauche d’ouverture (ptbgo!) et le Parti socialiste (PS).
Cependant, le SPF constate une “multitude” de partis actifs aux niveaux local et régional, “due au fait qu'un certain nombre [d ’entre eux], au départ unitaires, se sont progressivement scindés en des groupement francophones et néerlandophones.” Il ajoute que les années 2000 ont connu des “changements remarquables”, ces protagonistes optant tour à tour pour une logique de rénovation et de modernisation.

Dès lors, à partir de quand un parti peut-il être considéré comme traditionnel?
Mark Leonard, directeur du think tank European Council on Foreign Relations, clive le paysage européen en “partis pro et antisystème” (trad. libre) dans une tribune du Huffington Post. Les premiers seraient caractérisés par un besoin de renouvellement et un “vide” entre leur visée principale (maximiser le nombre d’électeurs) et celle de leurs électeurs (faire entendre leurs revendications), vide que les partis antisystème occupent progressivement.

Nous nous risquons à une définition personnelle de parti traditionnel : Tout parti présent depuis assez longtemps sur la scène politique pour avoir eu besoin de modifier profondément sa communication, au moyen d’un nouveau logo ou d’un nouveau nom, mais qui reste intrinsèquement prosystème.
Certaines familles politiques ont acquis assez d’influence et d’expérience pour être porteuses d’une aura, d’une voix dans le débat public porté par les médias. Au contraire, d’autres ne sont jamais prises en compte et leur réputation ne dépasse pas les frontières de la région où elles sont nées.
Au-delà de notre définition personnelle énoncée plus haut, les premières se différencient des autres pour leur importance en termes d’électeurs, mais aussi pour les stratégies qu’elles élaborent afin de conserver leur position de pilier politique. Nous en identifions cinq.
1. Le Parti socialiste (PS)
Mouvement socialdémocrate, le PS belge est l’un des plus importants négociateurs politiques du pays. Il acquiert ce nom en 1940 avant de vivre la scission en 1978 de son aile néerlandophone (de Socialistiche partij anders sp.a) et de l’ancien Parti ouvrier belge (POB), fondé en 1885, à une époque où le concept de socialisme était péjorativement connoté.

Affiche du POB pour les élections législatives de 1929, dessin de Rik, imprimerie Gossens, Bruxelles. Coll. IEV – Institut Emile Vandervelde, Bruxelles.
Le POB est le résultat d’une union entre différentes organisations ouvrières. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, il formait un gouvernement d’union nationale avec les catholiques et les libéraux. Aujourd’hui, il bénéficie d’un large filet de réseaux décentralisés : 14 fédérations régionales réunissant 259 unions socialistes communales (USC).
Le parti souhaite être “au plus proche des gens et des militants” , selon les déclarations de ses porte-paroles dans de nombreuses interviews. Son président est le Montois Elio Di Rupo. Certains personnages font souvent l’actualité pour leurs dérives en tous genres, ce depuis longtemps dans les journaux télévisés.
Consultez aussi: Un parti = une pub? L’exemple du PS belge
Aux élections triples de 2014, le Parti socialiste est éjecté du pouvoir fédéral pour la première fois depuis 26 ans. Il adopte, depuis, une communication musclée via plusieurs campagnes stratégiquement diffusées durant certaines manifestations ou lors de sorties politiques.
2. Le Mouvement réformateur (MR)
Il existe trois partis portant ce nom dans le monde et ils voguent tous sous l’étiquette libérale. Le nôtre a vu le jour en 2002 grâce à un regroupement chapeauté par Denis Ducarme de plusieurs familles (dont le Parti réformateur libéral, ou PRL).

Photonews
Il marque de très bons scores électoraux aux régionales depuis dix ans (31% en 2010) mais a connu plusieurs périodes sombres dans sa recherche d’identité.
Une de ses branches, les Fédéralistes démocrates francophones (FDF), actuelle DéFI, revendiquera son indépendance en 2011. Aujourd’hui, le MR est dans la majorité au parlement wallon et au gouvernement fédéral. Il est le seul parti francophone dans la coalition à quatre qui dirige la Belgique. Le Premier ministre, Charles Michel, en a été le président de 2011 à 2014, avant de laisser la place à Olivier Chastel.

Dans sa communication, le MR se revendique du “libéralisme social” et se situe lui-même plutôt au centre-droit de l’échiquier politique, alors que la majorité des spécialistes situe son programme à droite toute.
3. Le Centre démocrate humaniste (cdH)
Il acquiert son nouveau nom en 2002. Il était auparavant le Parti social chrétien francophone (PSC) apparu en 1968. À l’époque, les révolutions qui secouent l’université catholique flamande de Leuven et le déplacement de sa section francophone dans la ville de Louvain-la-Neuve sous la bannière UCL ont poussé à la création d’un nouveau parti.

En 1999, il perd tout pouvoir et veut se redresser sous l’impulsion de Joëlle Milquet. Il participe, dès 2007, au premier gouvernement Leterme.
Aujourd’hui, il est présent dans tous les gouvernements francophones mais a perdu de son influence à Bruxelles. Le parti s’est montré pionnier dans de nombreuses évolutions sociales comme la première introduction d’une femme voilée au Parlement bruxellois, en 2010 : Mahinur Özdemir.
Le cdH revendique une position centriste et a abandonné toute connotation religieuse dans sa communication. Il s’est mouillé dans de nombreux dossiers épineux comme, dernièrement, le dossier du survol de Bruxelles porté par Melchior Wathelet. Son président actuel est Benoit Lutgen.
4. Les Écologistes confédérés pour l’organisation de luttes originales (Ecolo)
Jeune, Ecolo existe depuis 1980. Il se revendique de plusieurs mouvements apparus en 1970, dont Démocratie nouvelle et Wallonie-écologie. Il fonctionne selon une méthode de coordination représentative. Il possède un parlement interne, le Conseil de fédération, qui permet à des représentants régionaux de débattre avec ceux issus des différents groupes où Ecolo siège.
C’est dans ce parlement que les procédures d’élaboration des listes électorales sont tracées. Sa présidence est assurée par un duo homme-femme, un(e) Wallon(ne) et un(e) Bruxellois(e), en ce moment Patrick Dupriez et Zakia Khattabi.

Photonews
En s’agrandissant, il pèsera sur les élections européennes de 1989, législatives de 1991, 1999 et communales de 2000. Son succès persiste jusqu’en 2010 et ses résultats décevants, avant de signer une défaite cuisante en 2014.
Ecolo s’est progressivement éloigné de son discours purement écologiste pour s’exprimer dans tous les domaines litigieux. Il a plusieurs fois orienté sa communication, son vert identitaire étant devenu plus flamboyant, moins naturel.

5. Les Démocrates fédéralistes indépendants (DéFI)
Longtemps imbriqué dans la coalition libérale unifiée du MR, le parti des FDF (Fédéralistes démocrates francophones, ex-Front démocratique des francophones) existe depuis 1964. La transition sémiologique de son sigle s’effectue en 2011, quand il s’est détaché du MR pour devenir un groupe politique isolé.
Consultez aussi: Les partis politiques sont-ils devenus des pubs?
Il reste cependant proche du Rassemblement wallon. Il a participé aux gouvernements régionaux Tindemans et Martens jusqu’en 1980, avant de voir son influence prioritairement dirigée vers Bruxelles et le Brabant wallon. En 2015, il devient DéFI sous la présidence d’Olivier Maingain, “le” visage historique du parti.

Photonews
DéFI emploie une communication divergente mais cinglante sur les dossiers où il a la légitimité pour s’exprimer. Il prône une idéologie progressiste et axée, depuis quelques années, sur le “libéralisme social”.
0 notes
Text
Les partis politiques sont-ils devenus des pubs?
Vous avez très, très envie de cette dernière barre chocolatée, vantée chaque soir lors de la page pub’ après le JT. Et si nos mandataires voulaient vous attirer de la même manière?

La politique ne s’est pas toujours adressée au public de la même manière.
Vers la moitié du XXe siècle est mis en branle un nouveau système à communication dite de masse, où différents types de messages se sont succédés, avec des technologies toujours mieux informées pour atteindre, correspondre avec l’électorat.
Durant les deux guerres mondiales, la technique de la propagande, qui consiste en un “entreprise organisée pour influencer et diriger l’opinion” (Jean-Marie Domenach, La propagande politique, 1950, Paris), devient inévitablement rattachée à un système de communication privilégié par les régimes totalitaires.
Le monde politique s’apprête à traverser une période de doute : comment s’adresser aux électeurs quand les événements récents ont nourri une rancoeur légitime envers les précédents régimes dirigeants? Comment respecter la démocratie tout en s’adressant au plus grand nombre?
La ‘nouvelle communication politique’ s’imposera vite comme la technique la plus souhaitable.
Au lendemain de la propagande utilisée par le régime nazi, puis les Alliés, plusieurs techniques de nature argumentative - et non plus manipulatrice -voient le jour. La ‘persuasion politique’, puis la ‘publicité politique’ ne durent qu’un temps. La ‘nouvelle communication politique’ s’imposera vite comme la technique la plus souhaitable.
Pour des spécialistes comme Philippe Maarek, sa première utilisation concrète est à retrouver durant les campagnes électorales de Dwight Eisenhower et de Richard Nixon, aux États-Unis, en 1952.

Les Républicains solliciteront un grand cabinet de relations publiques et un consultant en publicité audiovisuelle. Ils sont imités quatre ans plus tard par les Démocrates.
Comment un parti gagnera-t-il des élections en 2018?
Ceux-ci lancent la campagne de Kennedy , qui fera face à Nixon. À la télévision, les messages réduits et récapitulatifs remplacent les plaidoyers argumentés. Parmi les outils utilisés, on trouve les media trainings, leçons données par ces professeurs de communication pour aider le futur président américain à modeler son comportement en face-caméra.

En France, la première campagne puisant efficacement dans le même arsenal d’outils est celle de Jean Lecanuet, durant les présidentielles de 1965 face à un Charles De Gaulle qui se positionne contre cette innovation. Membre du Parti centriste, Lecanuet s’aidera du publicitaire Michel Bongrand pour dégager un slogan de campagne : “Un homme neuf, une France en marche”.

Source: Les sondages et l'élection présidentielle de 1965 par Jean Stoetzel
Alors que les sondages - dorénavant une nouvelle méthode de consultation de l’opinion populaire - ne lui attribuaient que 3% des intentions de vote, il récoltera 16% des suffrages. La campagne de 1974, opposant Valérie Giscard d’Estaing à François Mitterrand, marque une entrée franche dans l’ère du marketing politique avec l’utilisation systématique de sondages, ainsi que la succession de débats en face à face.
Un candidat politique n’est pas un produit, mais presque.
Le publicitaire Jean-Claude Boulet déclarera que le “candidat-produit doit conquérir un électorat-marché et déclencher des votes-achats”. Cet avis est peu partagé : des différences importantes subsistent entre la consommation et le vote. Pour Philippe Maarek, “le marketing politique ne peut (...) être une simple transposition du marketing commercial, lui doté d’une sanction nette et précise : l’achat et l’usage de l’objet de consommation” .
Il rappelle, par exemple, que tous les électeurs ont une voix égale, tandis que les consommateurs sont plus ou moins importants selon leur pouvoir d’achat.
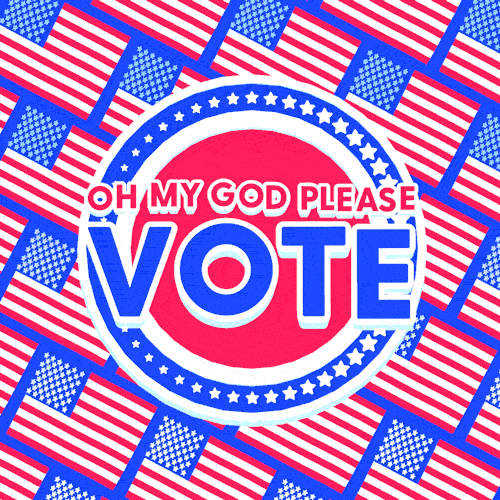
Aussi, la valeur d’usage, un concept marketing qui consiste en un panel d’arguments incitant à opter pour un produit, n’existe pas dans la démarche électorale. Un électeur ne pourra estimer qu’après coup s’il a fait le bon choix.
Pour Capelli, Sabadie et Trendel, “le vote et l’achat diffèrent sur deux critères. D’une part, le vote est gratuit (...), d’autre part, [il] est sanctionné par un résultat sur lequel il n’existe aucune clause permettant de revenir en arrière. La notion de ‘satisfait ou remboursé’ n’est pas de mise en démocratie !”
Consultez aussi: Un parti = une pub ? L’exemple du PS belge
En communiquant à la manière d’une marque commerciale, en arborant slogans et logos, les partis politiques ne font que suivre une mode répandue en tache d’huile chez ceux qui font entendre leur voix dans le débat public.
Aujourd’hui, le branding, aussi appelé ‘forme-marque’ par les spécialistes, est utilisé autant par les célébrités (le celebrity branding) que par les pays pour influer sur le tourisme (le nation branding). Un homme politique entretient désormais une image de marque : la manière dont il incarne la fonction est aussi importante que sa vie privée, voire plus importante que le programme politique qu’il porte.

Les similitudes abondent avec une communication dite corporate : utilisée par les entreprises pour valoriser leur réputation. En Amérique, le phénomène de cobranding est l’une des expressions les plus visibles de cette stratégie : à l’approche des présidentielles, les candidats s’entourent d’une armada de convaincus aux noms célèbres. Barack Obama affichait le soutien de personnalités comme Beyoncé, Eva Longoria ou le couple Angelina Jolie et Brad Pitt.

PhotoNews
En Belgique, les partis traditionnels ont usé de la technique du rebranding : la modernisation de l’image de marque, lorsque celle-ci est considérée désuète. On pense au PSC devenu cdH ou, plus récemment, les FDF devenus DéFI.
Un parti politique doit produire une marque respectable et dans l’air du temps. L’homme politique n’existe qu’après avoir engrangé une certaine notoriété, reflétée dans les sondages. Ceci prouve que le concept même de “marque politique” est appréhendé à travers différentes prises de positions épistémologiques.
youtube
0 notes